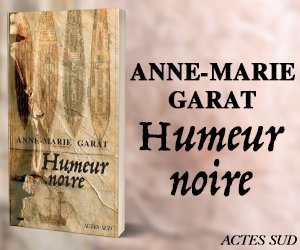Penser le « monde d’après » à partir de trois piliers du « monde d’avant »
Le coronavirus nous invite à réfléchir à ce qui, dans le monde d’avant, devrait être reconsidéré si on veut être mieux armé pour affronter d’autres catastrophes et rendre ainsi nos sociétés plus résilientes. Parmi les fondamentaux du monde d’avant à reconsidérer, il y en a au moins trois que met en lumière la question des vaccins contre le virus SARS-CoV-2 et ses variants.
Le premier des principes fondamentaux du monde d’avant, que montrent les vaccins, c’est à quel point les populations du monde sont, pour une part importante de leur survie, sous le pouvoir de quelques sociétés. Or ce pouvoir s’exerce non avant tout en fonction des intérêts de ces populations, mais plutôt en considération d’un marché profitable. Ce qui est en jeu, vu du côté de l’industrie pharmaceutique, c’est la force du pouvoir de l’offre face à une demande vitale, alors que, vu du côté de la population, c’est avant tout une question de ressources pour répondre à des besoins vitaux. Offre/demande et ressources/besoins ne sont pas du tout synonymes.
Lorsqu’on raisonne en termes d’offre et de demande, c’est le marché qui gouverne par le jeu de leur rencontre. Le fait que l’offre soit entre les mains de monopoles privés (en l’occurrence liés à des brevets) et que la survie de populations entières soit en jeu derrière la demande est indifférent. Aucune autorité publique n’ose actuellement s’opposer à ces monopoles pour ne pas risquer d’être « sanctionnée » par une réduction des livraisons de doses de vaccins.
Lorsqu’on raisonne en termes de ressources et de besoins, et ici de besoins vitaux, il ne s’agit plus de les laisser se « rencontrer » spontanément sous la forme d’une offre et d’une demande. Il s’agit de les « ajuster » par des politiques publiques appropriées. Et ces politiques, qui légitiment l’action des pouvoirs publics, supposent de gouverner à partir de principes qui devraient redevenir pleinement démocratiques.
Pour cela, on devrait avant tout poser en principe que nul ne puisse disposer d’un monopole sur un bien vital pour la population.
Il en résulte que la mise à disposition et la distribution des biens essentiels à la vie ne devraient pas être soumises à la seule loi du marché. Dans le monde d’avant, s’agissant des vaccins, soit on entre dans une logique de prix, soit dans une logique de nombre de doses livrées. On accepte de payer plus cher pour en recevoir davantage, ou on limite le plus possible le coût, au risque de ne pas être approvisionné en priorité. Mais dans les deux cas, alors que le libéralisme repose sur une concurrence entre des offres, en présence de monopoles, la concurrence se fait entre les demandes. Et tant pis pour les peuples pauvres, et tant pis pour ceux qui privilégient l’économie par la négociation du prix au lieu de privilégier la santé par la négociation de l’approvisionnement. Le caractère vital des besoins pervertit le marché en substituant ainsi une concurrence entre les demandes à une concurrence qui est faussée par la prééminence de monopoles industriels. Et ce même caractère vital des vaccins pervertit le rôle social que devrait avoir la « propriété ».
La propriété, telle qu’elle est conçue, ne garde pas la mémoire de tout ce qui a contribué à son établissement.
La propriété, individuelle et privée, est en effet le second des principes fondamentaux du monde d’avant. On peut partir de l’idée selon laquelle la société qui industrialise un vaccin (ou un médicament ou un autre bien essentiel) est rarement légitime à concentrer la totalité de la valeur ajoutée entre ses mains. Le vaccin est certes dû à cette société industrielle. Mais il est aussi dû à l’inventeur qui lui-même doit aussi à ses collaborateurs, à toutes celles et ceux qui l’ont formé, le plus souvent avec des fonds publics et l’effort de tous. Il est dû aux aides publiques, aux subventions versées, à la défiscalisation par le crédit impôt recherche, etc. Or la propriété, telle qu’elle est conçue, ne garde pas la mémoire de tout ce qui a contribué à son établissement. Dans la question des vaccins, comment se manifeste cette part importante qui ne vient pas que du travail de l’industriel, qui capitalise pourtant le tout grâce au monopole que lui donne la propriété du brevet ?
Or il n’est pas possible d’en tenir compte notamment parce que, dans notre monde d’avant, la propriété est conçue pour un bien vital comme pour un bien qui ne l’est pas. C’est un pouvoir par construction « absolu ». Le Code civil français ajoute même un double superlatif en définissant le pouvoir du propriétaire par des prérogatives conçues « de la manière la plus absolue » (art. 544).
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a annulé, pour une raison de technique législative procédurale, une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui prévoyait de rendre public le montant des investissements publics de recherche et développement dont le propriétaire du brevet a bénéficié pour le développement d’un médicament. Cela aurait au moins rendu transparente la part prise par la collectivité dans la réalisation d’un bien vital.
Sans doute, on dira que le rétablissement des intérêts collectifs se fait par la fiscalité post-commercialisation. L’industriel en question dégage en effet des profits d’autant plus considérables que le bien est vital et il en rend une partie à la collectivité par l’impôt sur ses bénéfices.
Mais c’est oublier que, s’il s’agit d’un bien vital pour les populations, le sort de celles-ci se joue avant l’imposition du profit. Le principe devrait donc pouvoir jouer également avant, au moment où la propriété finale va se sceller au profit de quelqu’un dont le mérite principal est d’avoir une puissance financière qui lui permet de s’approprier les inventions qu’il se contente de racheter à des inventeurs externes ou celles de ses salariés.
La propriété d’un bien vital pour la population devrait être spécifiquement conçue pour être partagée entre tous ceux, privés ou publics, qui ont contribué à réaliser ce bien.
Mais comment y parvenir si le propriétaire qui capitalise pour lui seul toutes les étapes successives de réalisation d’un bien vital a une puissance économique qui va jusqu’à rivaliser parfois avec celle des États ?
Les sociétés pharmaceutiques, chimiques, énergétiques, informatiques, numériques ou technologiques, accaparent le pouvoir qui, en démocratie, devrait rester entre les mains des personnes humaines.
C’est en effet là que se trouve le troisième pilier du monde d’avant. Le problème est en réalité le suivant. La société pharmaceutique est une personne morale. Les personnes morales étant des personnes, elles ont des droits comme les personnes physiques. Elles bénéficient même des droits de l’Homme : droit de s’installer où elles veulent, droit au respect de la vie privée, etc. C’est ainsi, par exemple qu’au titre de leur « vie privée », elles peuvent faire respecter le secret des affaires : celui des contrats conclus pour l’approvisionnement en vaccins du monde entier ou de garder cachées les aides publiques qui leur ont profité. Plus généralement, les personnes morales bénéficient de tous les droits humains transposés à leur état de personnes dites « morales ».
Le problème vient surtout de ce que, si les personnes morales ont grosso modo les mêmes droits que les personnes physiques, l’inverse n’est pas vrai. Dans notre monde d’avant, en effet, les personnes morales ont le droit d’être « anthropophages », de se manger entre elles et d’approprier du même coup le patrimoine de celles qu’elles absorbent par l’effet d’un rachat, d’une prise de contrôle, d’une fusion-absorption, d’une OPA, etc.
Il en résulte la constitution de « monstres » qui, comme les sociétés pharmaceutiques, chimiques, énergétiques, informatiques, numériques ou technologiques, accaparent le pouvoir qui, en démocratie, devrait rester entre les mains des personnes humaines.
Si les personnes morales perdaient leur droit à l’anthropophagie, ou s’il était au moins limité, il n’y aurait pas de monstres inter ou transnationaux qui concentrent plus de pouvoirs que certains États et, par l’appropriation de biens vitaux, détiennent entre leurs mains le sort des humains.