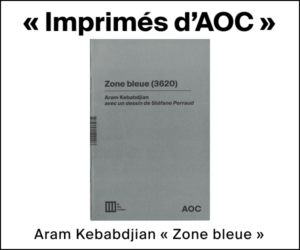Politique de la « dépolitisation »
La politique a-t-elle disparu avec les votants ? C’est la question que se posent aujourd’hui légitimement nombre de militant-e-s de gauche, sincèrement désarçonnés par un nouveau scrutin marqué du sceau de l’abstention massive et par ses conséquences relativement désastreuses.
Au-delà des larmes de crocodile maintenant vite essuyées et des phrases convenues, répétées à vide (« l’abstention est le premier parti de France », « le silence est assourdissant », « cela doit tous nous remettre en question » etc.), il s’agit d’observer à quel point une partie majoritaire du champ politique s’accommode parfaitement de cette nouvelle donnée structurelle de la compétition électorale. Cette trivialité s’analyse.
Les mines réjouies d’anciens ministres de l’ère Sarkozy triomphants, tout comme l’empressement de tel ou tel à se proclamer central pour tout ce qui passera à gauche, nous rappellent à quel point l’état de crise (ici démocratique) peut être « routinier », pour reprendre une analyse encore pleinement d’actualité du politiste Michel Dobry.
État spécifique d’un système de représentation et de son appropriation par le monde social, cette « grève des urnes » rencontre de nombreuses explications dont certaines interpellent singulièrement la gauche : héritière d’une vision positive de l’engagement, elle s’est construite sur cet accord minimal autour de l’idée que « la politique sert à quelque chose », sur un temps long rythmé par la promesse d’une société meilleure. À l’aune de ce futur-là, les « répétitions générales » composaient le passé, et le présent était en quelque sorte relativisé. Mais il semble bien que l’horizon du temps s’est raccourci et que dans ce resserrement, une crise de légitimité se déploie radicalement, emportant parfois tout sur son passage.
Dans les villes et les quartiers marqués tout au long du XXe siècle par le lien entre la gauche et classes populaires, une nouvelle étape semble franchie. En Île-de-France, pour celles et ceux qui étudient le phénomène historique incontournable qu’a constitué « la banlieue rouge », les résultats des élections départementales (qui se lisent en addition des dernières élections municipales), sont riches de confirmations et d’enseignements.
L’effacement progressif de l’influence « rouge » dans la petite couronne francilienne redéfinit en profondeur le rapport de la société française à un socle de représentations et de pratiques qui a structuré l’imaginaire de la gauche tout entière. L’idée qui l’accompagnait, à savoir la possibilité de faire exister à l’échelle locale un « contre-modèle », sorte de sanctuaire incarnant dans la pratique d’un pouvoir la résistance à l’ordre établi, n’est plus. Ce scrutin, comme les précédentes élections locales, accentuent ce constat.
À ce titre, le basculement du département du Val-de-Marne n’est pas seulement un événement symbolique et le séisme qu’il produit secoue bien au-delà du monde communiste : 13 ans après la perte de l’emblématique Seine-Saint-Denis au profit du Parti Socialiste, le dernier département communiste passe directement à droite. À titre d’exemple et pour comprendre la révolution qui s’opère : à Champigny-sur-Marne, ville de 78 000 habitants où Georges Marchais accueillait Fidel Castro à dîner, passée à droite il y a un an, les deux cantons qui composent la commune sont ravis par la droite. Dans le haut de la ville, Christian Favier, Président du Conseil Départemental depuis 20 ans, est battu.
De façon inévitable, l’effacement de la banlieue rouge acte en même temps un bouleversement des équilibres du champ politique français et une recomposition profonde du lien entre les quartiers populaires et la gauche. Les quartiers qui constituaient auparavant le socle (et l’autorité symbolique) de la gauche, et plus particulièrement du PCF, sont aujourd’hui traversés par des dynamiques de mobilisations et non-mobilisations qui expriment incontestablement une remise en cause d’une définition de la politique héritée du mythe de la gauche au XXe siècle.
Implantée sur des territoires « de manque » mis au ban de la société, la banlieue rouge retournait le stigmate en se revendiquant comme un espace « plein ».
Territoire politique emblématique, espace de conquête et d’émulation, la banlieue rouge constitue un modèle positif d’implantation politique et culturelle : même isolé (et ce dès les années 1980), cet écosystème politique et social plus ou moins fantasmé a donné à voir ce que pouvait être une autre société – ce que Maurice Thorez appelait « la gestion communale heureuse » : un maillage associatif et politique important, une multitude d’espaces de socialisation politique, des politiques sociales emblématiques et menées « avec du style [1] ».
Ce style reposait sur l’occupation d’un espace défini comme autonome au sein du champ politique, espace identifié par la revendication plébéienne et le capital constitué grâce à l’extraction populaire de nombre de ses cadres et militants. Implantée sur des territoires « de manque » mis au ban de la société, la banlieue rouge retournait le stigmate en se revendiquant comme un espace « plein », celui de la diffusion heureuse d’une idée du monde marquée par la vie collective, où tout était politique.
Il ne s’agit pas tant aujourd’hui de revenir sur cette histoire relativement bien documentée par les sciences politiques, que d’en observer les réverbérations contemporaines.
La culture populaire est en effet nourrie de ce coup de force symbolique. Les « années Gabin » ou les paroles des chansons de Renaud sont souvent citées, mais il faudrait aussi relire sous ce prisme d’une revalorisation politique la montée en puissance du rap en France à partir du début des années 1990 : le « Seine-Saint-Denis Style » (NTM) et sa version contemporaine du « 93 Empire » (Fianso), ou encore le « 9-4 c’est le Barça » de Kery James pour le Val-de-Marne, évoquent les liens entre l’histoire politique de la banlieue rouge et le processus d’identification sociale et culturelle qui l’accompagne.
La Mafia K’1 Fry, sans doute l’un des collectifs les mieux documentés du « rap game », présente ainsi une histoire marquée par des liens permanents avec les villes (Orly, Choisy, Vitry, toutes encore communistes dans les années 90-2000) où ont évolué ses artistes. L’ouvrage récent de Manu Key [2] revient ainsi sur la place déterminante de « la MJC d’Orly » dans ce parcours. Les artistes du 113, Mokobé en tête, continuent d’occuper publiquement le terrain de leur ville natale, Vitry-sur-Seine, notamment en participant à la vie locale, en s’engageant dans de nombreuses causes et en répondant aux invitations des acteurs locaux, voire en soutenant le municipalité [3], toujours communiste. Dans le légendaire « 94 » (2004), ode à son « deuxième pays », l’artiste Rohff réalise une véritable topographie géographique et sociale de son département, liée par cette phrase équivoque : « Villes de communistes, même avec Tati la vie est triste ».
Le style et la revendication tribunicienne du monde « coco » ont ainsi constitué un défi puissant adressé au monde social par les classes populaires : incarnation d’une forme de fierté à travers une conception valorisée de la politique, ce monde a « en se défaisant [4] » produit un mouvement de désaffection à la hauteur de la promesse qu’il représentait. Dans un effondrement structural (de l’ordre communiste à la gauche, de la gauche à la politique) et en chaîne, ces écosystèmes ont produit un rejet singulier, puissant, et dont la portée est forcément contradictoire : dans les quartiers populaires, le « Politique Beurk Beurk » qui ne se comprend réellement que dans l’analyse d’une forme de familiarité contrariée entre la gauche et celles et ceux qui se sont socialisés dans son mythe.
Les démarches citoyennes qui se sont constituées sur de nombreux territoires depuis le début des années 2000 portent cette histoire de l’émergence d’une revendication politique issue de ce qu’on pourrait appeler la « zone des amis » (« friendzone ») de la gauche : une zone peuplée de femmes et d’hommes assez proches pour avoir incorporé les logiques et les dispositions du champ politique, mais trop éloignés pour y occuper une position légitime. Cette zone des amis a explosé.
De cette explosion naissent un ensemble de mobilisations difficilement lisibles sur les radars de la politique traditionnelle, mais qui émergent régulièrement, rappelant une vitalité politique et démocratique difficile à démentir. Les dispositifs spontanés d’entraide, de solidarité, de dialogue qui ont rempli le vide de l’action publique pendant la crise sanitaire l’ont rappelé avec force.
De même, sur des sujets comme les violences policières, les conflits entre jeunes, le nettoyage des quartiers, l’organisation d’événements sportifs, les expériences se multiplient et expriment une ambiguïté qui en tétanise plus d’un : les valeurs de la gauche sont mobilisées, mais dans un cadre qui refuse tout lien avec la politique en général – et parfois avec la gauche en particulier. Ces mouvements citoyens revendiquent, sous des formes nouvelles, une capacité à agir et à peser concrètement sur les rapports de force politiques. En dehors des élections, mais aussi dedans.
Des conflits nouveaux ont ainsi structuré les champs politiques locaux, parfois jusqu’à les transformer : Samir Hadj Belgacem a très bien retracé comment, au Blanc-Mesnil (93), la montée en autorité d’une génération de nouveaux porte-paroles issus des quartiers a accompagné paradoxalement le renversement politique dans une ville jusque-là communiste, (im)posant de manière inédite la question de la représentation des classes populaires.
En désignant l’abstention massive comme l’expression d’une « dépolitisation », on neutralise sa portée conflictuelle et l’expérience politique bien réelle qui est à son fondement.
J’ai tenté pour ma part de montrer sur un autre terrain, à Corbeil-Essonnes (91), la manière dont le système de corruption mis en place par le milliardaire Serge Dassault a « rencontré » dans les quartiers populaires de la ville une critique du communisme municipal et des mécanismes de confiscation et d’invisibilisation qu’il produisait [5], avec là aussi pour effet le basculement.
Sur d’autres territoires comme Bobigny et Drancy (93), Valenton ou Villeneuve-Saint-Georges (94), des dynamiques similaires ont pu se mettre en œuvre : en s’engouffrant dans les failles et les déceptions du communisme municipal, une certaine droite a su mener un politique agressive de mobilisation dans les quartiers populaires pour « faire tomber » des municipalités de gauche. Souvent au prix du désordre, de la concurrence acharnée et de la violence, comme l’ont montré les feuilletons du système Dassault à Corbeil-Essonnes, ou du système Lagarde à Bobigny.
Nous avons cité cette phrase entendue un jour sur le terrain, lors d’une campagne électorale, « Vous la gauche, c’est pire, parce qu’au moins avec la droite, on sait [6] » : d’un point de vue électoral, la rupture historique qu’incarnent ces mots est manifeste et aide sans aucun doute à appréhender la transformation politique de nombreux territoires, considérés encore il y a quelques années comme imprenables par la droite. Non sans conséquences pour les populations concernées.
Surgissent alors un ensemble de questions troublantes, qui se posent autant aux partis de gauche qu’aux mobilisations citoyennes qui veulent prendre part au jeu politique : quel est le prix à payer pour ce conflit ? Comment ne pas appréhender avec inquiétude la manière dont les partis et réseaux libéraux récupèrent la critique du communisme municipal pour en écraser tous les acquis sociaux ? Plus largement, dans quelle mesure le dévoilement des manquements et points aveugles de la gauche peut-il s’opérer sans disqualifier brutalement des socles entiers de valeurs et progrès politiques réalisés ? Plus prosaïquement, est-on obligé de passer par « la sueur et les larmes » pour comprendre qu’un dialogue critique et contradictoire est possible ?
En désignant ces phénomènes de basculement, et l’abstention massive qui les accompagne, comme l’expression d’une « dépolitisation », on neutralise leur portée conflictuelle et l’expérience politique bien réelle qui est à leur fondement. Cette expérience contient pourtant d’importantes lignes de continuité avec l’histoire émancipatrice de la gauche, nécessairement transformée. Redécouverte et formalisée, cette continuité constitue l’espace d’un dialogue possible entre différentes formes d’expression politique.
De fait, l’affaiblissement de l’ordre politique établi ouvre la voie à la constitution en objet politique d’expériences sociales, traditionnellement renvoyées hors du champ politique. Dans un mouvement paradoxal, ces expériences sont réticentes à se revendiquer politiques, de peur d’être aspirées, récupérées, salies par ce registre d’action. Mais quand ces actrices ou acteurs « sautent le pas », ils révèlent de manière finalement irrésistible l’inexpérience et l’insensibilité de ceux qui auparavant leur confisquaient la politique. Ainsi libérés, ces engagements retrouvent le fil d’une histoire des résistances à la domination, heureusement loin d’être vierge. C’est cette dialectique forcément positive du « Politique Beurk Beurk » qu’il s’agit d’activer. On peut dire qu’il y a urgence.