Consommation de crack, soins et accompagnement dans le Nord-Est de Paris
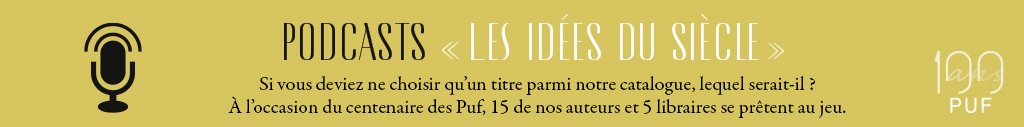
Au Nord-Est de Paris, à cheval sur les 18e et 19e arrondissements, le crack est vendu et consommé dans l’espace public. Cette zone peut être grossièrement délimitée. D’un côté, l’avenue Jean Jaurès. De l’autre, les rails de la Gare du Nord. Au nord, la rue de Crimée et au sud, le métro aérien de la ligne 2. Un carré approximatif dont les côtés font environ 1,5 km. Il s’agit d’un des quartiers les plus pauvres de Paris et c’est là que plusieurs centaines de toxicomanes sont relégués [1].
Les interstices de la ville
La présence de toxicomanes dans notre quartier n’est pas un hasard. Depuis son arrivée en métropole dans les années 90, le crack est quasiment exclusivement implanté dans le Nord-Est parisien. Au sein de cet espace, les lieux de vente et de consommation varient en fonction de l’évolution de l’urbanisme et de l’action de la police. En ce moment, ils sont ici. Pourquoi ?
En raison, d’abord, du démantèlement, fin 2019, de la « Colline du crack », porte de la Chapelle. Opération policière avec un accompagnement social minimal, elle a uniquement produit une dispersion des toxicomanes de ce camp. Ils se sont alors réorganisés à Stalingrad. Ensuite, les confinements et couvre-feu successifs leur ont laissé la complète maîtrise de l’espace public.
Dans le bas de l’avenue de Flandres, l’évolution fut saisissante. Sans les enfants du Jardin Luc-Hoffman, sans les habitués attablés aux cafés ou dans les kebabs, l’avenue fut laissée à l’abandon et progressivement contrôlée par les toxicomanes. Avec le retour des terrasses le long du Bassin de la Villette, les choses ont un peu changé. La colère et la mobilisation des riverains provoquèrent également un intérêt des médias et une présence policière plus importante.
En mai, la préfecture de Police et la Mairie de Paris décidèrent alors de déplacer la consommation de crack vers la partie nord des jardins d’Éole. Longeant la rue d’Aubervilliers et les rails de la Gare de l’Est, le jardin était déjà occupé par les toxicomanes en journée. À sa fermeture, ils retournaient vers le bassin de la Villette. À partir du mois de mai, le jardin resta ouvert jusqu’à 1h du matin et des distributions de repas y furent organisées. L’objectif était de concentrer la zone de vente et de consommation en un seul lieu.
Cette décision fut abandonnée le 30 juin sans qu’elle n’ait réellement changé la situation. En effet, suivie depuis trente ans, la stratégie consistant à déplacer les lieux de consommation ou à disperser les toxicomanes est inefficace. Ces hommes et femmes ont des habitudes, des fréquentations, des lieux de vie dans lesquels ils sont installés. Malgré les actions policières, ils restent plus ou moins aux mêmes endroits, laissant les mêmes quartiers de Paris souffrir de ces maux.
Cette présence persistante suscite un sentiment d’abandon et d’injustice chez les habitants. Depuis plusieurs mois, nous voyons les toxicomanes passer, acheter et consommer. Nous voyons des hommes et des femmes hagards, démolis, excités, amorphes, grattant le sol, dormant au milieu des déchets, hurlant contre des ennemis invisibles, s’oubliant en pleine rue, mendiant plus ou moins agressivement. Nous voyons des enfants se rendant à l’école obligés d’enjamber des hommes à terre et des parents les protégeant des agressions qu’ils ne peuvent éviter. Nous voyons des adolescents tirer au mortier sur des toxicomanes pour les chasser, des adolescents persuadés que seule la violence pouvait répondre à l’inaction des pouvoirs publics. Pourquoi devrions-nous continuer à subir cela ?
À cette question, seule répond l’impression de n’être qu’une marge, un « interstice » de la ville où sont relégués ceux dont les autres ne veulent pas.
Accueillir les toxicomanes
Dès lors, des solutions différentes doivent être adoptées pour résoudre réellement cette crise et pas seulement la déplacer au sein du Nord-est parisien. Deux stratégies sont notamment proposées. D’abord, poursuivre la création de lieux d’accueil où la consommation de drogue serait tolérée et sécurisée. Ces salles de consommation à moindre risque devraient réduire la consommation dans les rues et les jardins ainsi que les conflits avec les habitants du quartier. Surtout, en leur sein, un lien entre des travailleurs sociaux et les toxicomanes pourrait être créé. Une prise en charge graduelle des problèmes physiques, mentaux ou sociaux, causés par l’addiction ou l’ayant entrainée, serait possible dans ce cadre. Ultimement, aux termes d’un processus long, complexe et incertain, une aide pour sortir du crack pourrait être proposée aux toxicomanes.
Cependant, afin d’être efficaces, ces salles de consommation à moindre risque doivent être placées à proximité des lieux de consommation de drogue et des logements des consommateurs. La logique est évidente : si l’on espère que les usagers de drogue se rendent volontairement dans ces lieux, il est préférable de les placer près d’eux. Autrement dit, il faut installer ces salles dans le Nord-Est parisien.
La première salle a ainsi été installée à Lariboisière, à côté de la Gare du Nord. En toute logique, d’autres devraient également être installés à Stalingrad. Une telle solution risque toutefois de fixer la toxicomanie dans ces quartiers. Certes, en théorie, les toxicomanes ne consommeront plus dans la rue mais la vie qui les entoure, le crack s’y maintiendra : les vols pour obtenir de l’argent, l’agressivité entre consommateurs et habitants ou les sévices subis par les femmes toxicomanes se poursuivront.
Pour éviter une telle situation, les partisans des salles de consommation proposent d’abord de répartir ces lieux d’accueil et d’hébergement en les dispersant au sein de toute la métropole afin d’alléger la pression pesant sur les quartiers populaires. Cette mesure de justice sociale est complétée par l’encadrement policier des salles de consommation.
Une salle de consommation à moindre risque n’est pas une zone de non-droit dans laquelle la police n’interviendrait plus. Elle implique seulement une immunité pénale pour la consommation de drogue dans la salle et une tolérance pour le transport de petites quantités de drogue – correspondant à une dose personnelle – aux abords de la salle. Toutes les autres activités aux abords de la salle demeurent proscrites : la vente et la consommation de crack, les violences entre consommateurs ou contre les habitants, les vols pour obtenir de l’argent sont combattues autour de la salle [2]. Autrement dit, la création de ces lieux d’accueil et de suivis apaiserait les quartiers concernés en mettant en place une cohabitation viable entre les habitants et les toxicomanes.
Sevrage forcé et privation de liberté
Toutefois, une telle stratégie est critiquée car elle repose sur l’acceptation de la toxicomanie. Pour certains, seule la disparition complète du crack est une voie acceptable. Aucune tolérance pour la consommation de drogue ne saurait être acceptée afin d’éviter toute cohabitation entre les toxicomanes et les habitants. Les toxicomanes ne doivent pas être accompagnés, sur la base du volontariat, en dehors du crack mais soignés, y compris contre leur volonté. Pour y parvenir, la seule solution viable semble alors être de les placer dans des centres de désintoxication fermés.
Une telle proposition n’est pas isolée. Aux États-Unis, des États conservateurs ont récemment réinstauré des mesures de ce type pour répondre à la crise des opiacés. En Europe, certains États pratiquent des mesures d’enfermement pour sevrer les toxicomanes et les soigner. D’ailleurs, l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme autorise explicitement la privation de liberté d’un individu lorsqu’il s’agit d’un toxicomane.
Cependant, en France, cette stratégie n’est pas pratiquée. D’abord, le cadre législatif ne le permet probablement pas. Ensuite, l’enfermement et le soin sans consentement impliquent une annihilation totale de l’autonomie des toxicomanes. Ils ne peuvent pas être décidés à la légère.
Évidemment, les colères, les peurs, le dégoût accumulés depuis plusieurs mois nous poussent à accepter de priver des hommes et femmes de leur liberté. Les agressions, la violence, la perspective de voir les enfants de notre quartier grandir entourés de ces êtres en déshérence nous amènent à vouloir l’éloignement de ces hommes et femmes.
Seulement, une telle stratégie ne doit être acceptée qu’à trois conditions. D’abord, nous devons être certain qu’elle parviendra à atteindre son objectif. Ensuite, selon la Cour européenne des droits de l’homme, « elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention [3] ». Enfin, nous devons nous assurer que le mal que nous essayons d’éviter est à la hauteur de la violence que nous allons décider.
Or, aucune de ces trois conditions n’est respectée. D’abord, l’efficacité du sevrage forcé sur un plan sanitaire est largement remise en cause. Les rares études scientifiques sur le sujet concluent au mieux que le sevrage forcé n’est pas plus efficace que l’accompagnement volontaire des consommateurs de drogue [4]. Dans le cadre de la lutte contre le crack, l’absence de produit de substitution renforce cette conclusion.
Ensuite, les mesures d’accueil et d’accompagnement n’ont pas encore été sérieusement déployées. Ces mesures sont sans aucun doute plus longues, plus couteuses, moins spectaculaires. Seulement, elles ne peuvent pas être écartées d’un revers de main pour répondre, dans l’urgence, à un problème de santé et de sécurité publiques que l’État a laissé s’installer pendant trente ans.
Enfin, si certains toxicomanes souffrent de troubles mentaux profonds et devraient être hospitalisés sans leur consentement, la plupart d’entre eux ne menacent pas directement et immédiatement leur vie ou celle des autres. Or, l’enfermement préventif et la soumission forcée à des soins ne sont acceptables que s’il existe un « risque réel de dommage grave pour sa santé ou pour autrui » : un comportement déviant dans l’espace public y compris s’il est effrayant, dégoutant ou choquant ne peut pas suffire à enfermer un toxicomane pour le soumettre à un sevrage forcé [5].
Au fond, aussi difficile soit cette idée pour ceux qui comme moi les subissent au quotidien, les toxicomanes ont des droits et libertés au même titre que les habitants du quartier. Ils ne sont pas simplement une classe dangereuse qu’il faudrait évacuer de la société, un fléau qu’il faudrait éradiquer.
Une telle conclusion peut sembler naïve, teinte d’une morale qui n’a plus sa place face à l’urgence de la situation. Seulement, c’est précisément lorsque nos craintes et nos colères nous appellent à nier aux autres leurs droits et libertés qu’il faut les défendre.
L’État doit assurer le calme et la sécurité des habitants de notre quartier, leur droits et libertés, il ne peut pas nous laisser à l’abandon. Mais il doit réagir en mettant en place une politique sociale et pénale à la hauteur de ces enjeux, et non en privant radicalement les toxicomanes de toutes leurs libertés.
