Pragmatique de la transition
Je sortais de la lecture de l’excellent Pour l’intersectionnalité d’Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz [1] quand je suis tombé sur l’article « Nouveaux troubles dans le genre : identité ou identification ? » du psychanalyste Pierre Marie, publié ici même.
Quoique m’ayant enthousiasmé, Pour l’intersectionnalité avait conjointement réveillé en moi le souvenir de certains agacements récents devant des écrits et paroles d’étudiant.e.s ou d’enseignant.e.s qui, à mon sens, maniaient les études sur le genre ou la race non pas à coups de marteau (ça j’aime plutôt bien), mais en tapant à côté de l’enclume. J’avais beau adhérer à l’esprit de ces « studies », je restais parfois heurté par la tendance de certain.e.s chercheur.e.s à verser dans l’essentialisme ou à aligner des éléments de langage sans réfléchir au contexte – voire à éliminer volontairement celui-ci dans un but d’intimidation intellectuelle.
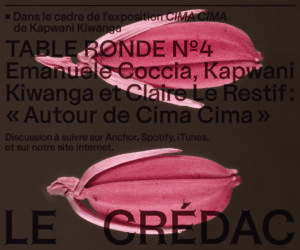
En me rappelant ces agacements, je voyais bien que j’avais tort de me focaliser sur celleux qui criaient le plus fort, au détriment de celleux qui pensaient le mieux. Il me semblait qu’il y avait quelque chose à approfondir autour de la question des « savoirs » ou « points de vue » dits « situés », c’est-à-dire qu’il me semblait que, dans tout ce qui m’avait agacé, mes interlocuteur.ice.s en lutte avaient banalement pris leur point de vue pour une connaissance : un travers qui n’épargne personne, mais que l’intersectionnalité apprend justement à défaire. Et qu’on gagnerait donc à plonger plus profondément bébé dans l’eau de son bain au lieu de jeter l’un et l’autre.
Cette accusation d’essentialisation, je la retrouvais sous la plume de Pierre Marie à l’encontre de la transition de genre : « C’est […] une manie récente qui nous obligerait à revêtir une identité sexuelle, à nous déclarer féminin ou masculin, hétérosexuel ou homosexuel, voire transsexuel. » Je me reconnaissais un peu dans ce refus de « l’identité », mais comme dans un miroir grimaçant : car quoique l’idéal me semble d’échapper à tout genre, de les déconstruire plutôt que de s’identifier à l’un ou à l’autre, je suis en tous points en désaccord avec son analyse et son propos.
Autant tel collègue me semble faire preuve de bêtise excluante plutôt que de « savoir » quand il insiste pour écrire « un.e enfant.e » (et donc pour remettre de la binarité là où, grâce à l’épicène, il n’y en avait plus), autant la transition de genre me paraît bien être un terrain fertile en « savoirs » et non ressortir à une lubie essentialiste ou à un jeu de dupes.
Concernant mon collègue et quelques autres errances des études queer, de genre, décoloniales, etc., rien de nouveau sous le soleil : le gros des ratages de pensée vient de psittacismes, de confusions ou de maladresse. On ne peut cependant oublier que les théories les plus progressistes ont toujours eu leurs parasites, lesquels, sous couvert de lutte, ne travaillent souvent que pour établir leur propre domination sur autrui et finissent quelquefois dans le parti opposé – auquel iels appartenaient en réalité depuis le début : le résultat de leur effort étant au passage d’avoir vidé la lutte de sa substance théorique pour en faire une version molle et bourgeoisement digeste.
La pensée de Foucault a eu ses profiteur.se.s, comme celle de Deleuze, et comme en auront celles de Haraway ou de Spivak. Aucun.e de ces profiteur.se.s ne vise à développer un « savoir » co-construit : seulement à confisquer le pouvoir.
Parfois, moins grave, c’est le syndrome dit « de Marie-Antoinette » qui frappe. Il s’agit d’un mal assez banal chez les chercheur.e.s qui n’ont aucune expérience de ce qu’est la subalternité ou la vraie pauvreté ni n’ont de possibilité de l’imaginer : leur expérience existentielle bourgeoise est radicalement différente et, quoi qu’iels fassent pour se « marginaliser », un héritage réseautique et/ou financier vient leur barrer l’accès au point de vue des subalternes.
Plutôt que d’admettre ce barrage et d’en faire son miel, la tentation est courante alors de plaquer des fantasmes sur l’objet de leur étude. Ainsi vont-iels parfois glorifier chez le subalterne les qualités qu’iels y attachent (vulgarité, violence, libido surdéveloppée, etc.) en supposant a priori que ces « bon.ne.s sauvages » sont incapables de mauvaises intentions – et sont donc en somme des abruti.e.s, ou des extraterrestres.
Face à la fausse monnaie de la malhonnêteté ou de l’intimidation intellectuelle, il y avait jadis une arme pédagogique et philosophique simple : l’ironie, qui tentait d’établir une complicité horizontale. On pourra relire si l’on veut Michel Foucault, Le Courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres II. Cours au Collège de France, 1984 sur l’ironie des cyniques grecs comme forme de vie. On peut plus rapidement prendre la définition américaine de cynique : « enclin à questionner la sincérité et la bonté des actions humaines et de leurs motifs ».
Le savoir est vivant, polyphonique, éventuellement désaccordé, évolutif, frémissant de la multiplicité des points de vue et – aimerait-on croire – de la multiplicité d’écoutes.
Cela consistait donc simplement à faire remarquer, dans le cadre d’un échange éducatif, que tout que ce nous pensons, disons et faisons n’est pas nécessairement sincère ni ne part forcément d’un bon sentiment – ce qui ne veut évidemment pas dire que toute action ou pensée est fausse ou malhonnête… Mais chacun.e était invité.e à interroger ses motivations.
J’entends et je comprends bien que ce discours qui exige de chacun.e qu’iel questionne entre autres la construction de sa sensibilité n’est plus audible, car il ne faut plus froisser, justement, les sensibilités — au risque de les « naturaliser ». Mais le programme cynique, une fois dépouillé de sa brutalité, peut peut-être se retrouver dans ce que les études intersectionnelles appellent les « savoirs situés », lesquels ne visent pas à produire des vérités sur lesquelles on pourrait indexer des lois (pour la pensée ou l’action) mais d’une façon assez pragmatique, me semble-t-il, à voir, comme l’écrivait William James, « ce qu’il y aura de différent pour vous et pour moi, à tels moments précis de notre vie, selon que telle formule de l’univers, ou telle autre, sera [tenue pour] vraie [2] ».
Je reviens donc à Pour l’intersectionnalité de Lépinard et Mazouz : dans ce précieux opus, les deux chercheures et enseignantes rappellent que, contre une position sociologique de surplomb, l’intersectionnalité promeut – afin de comprendre comment les différentes discriminations se potentialisent ou se neutralisent, interagissent non pas de façon systématique mais en contexte – les « épistémologies du point de vue » et les savoirs situés, c’est-à-dire « constitués à partir des expériences minoritaires » : « il ne s’agit pas d’affirmer qu’un point de vue subalterne serait porteur, intrinsèquement, de savoirs plus vrais, mais plutôt d’insister sur la nécessité de produire une capacité d’analyse collective qui prend le point de vue des dominé.es, et qui fait donc une large part à leur expérience. »
Il s’agit pour la.le sociologue, rappellent les autrices, de « reconnaître ce que l’on ne peut pas connaître seul.e a priori, d’identifier la façon dont ses propres privilèges peuvent induire des formes d’ignorance ». Elles y insistent : « L’épistémologie du point de vue n’accorde pas de privilège épistémique aux dominé.es . »
Vous me voyez venir avec mes sabots dominants, prêt à prendre prétexte de ce non-privilège pour le retourner en une délégitimation de la parole des dominé.es quand iels ne peuvent pas identifier leur ignorance. Que nenni. Sans doute est-ce le moment de revenir sur ce qu’on entend par « savoir » et de rappeler que pour l’épistémologue le « savoir » est toujours situé, c’est-à-dire prenant en compte ses conditions d’énonciation et renonçant au surplomb. Foucault à la fin de L’archéologie du savoir : « le savoir [est] un domaine où le sujet est nécessairement situé et dépendant, sans qu’il puisse jamais y faire figure de titulaire (soit comme activité transcendantale, soit comme conscience empirique) ».
En effet, le savoir n’est ni la science ni la connaissance. C’est plutôt un medium, une « formation » ou une « pratique discursive » comme dit Foucault, une notion « prospective » comme l’ajoute le philosophe Pierre Macherey entre autres dans son article « Histoire des savoirs et épistémologie » : « La notion de savoir […] dénote une activité, c’est-à -dire un processus engagé dans la dynamique de sa réalisation dont la progression se détermine à partir d’elle-même, en se relançant vers l’avant, donc vers son avenir, en fonction de ses réalisations antérieures qu’elle retravaille en vue de les modifier. »
Alors que la notion de science au contraire « correspond à un état de fait acquis qui, tout en pouvant être réévalué, est néanmoins considéré et déterminé en lui-même ». Le savoir est vivant, polyphonique, éventuellement désaccordé, évolutif, frémissant de la multiplicité des points de vue et – aimerait-on croire – de la multiplicité d’écoutes nourrissant une « réflexivité forte » comme le rappellent Lépinard et Mazouz.
Revenons à présent à Pierre Marie. Dans son article « Nouveaux troubles dans le genre : identité ou identification ? », le psychanalyste pointe, on l’a dit, la « passion catégoriale » et l’« essentialisation » qui lui semblent à l’œuvre dans certaines transitions de genre. En tant que sémiologue, j’avoue volontiers que mon premier réflexe est également de remarquer l’effet médiatique et de mode (donc identificatoire) de cette question, plutôt que ses aspects humains.
Je m’intéresse souvent plus à ce qu’on dit de la chose qu’à la chose elle-même. Et je constate (avec la relativisation nécessaire) qu’Instagram, YouTube ou TikTok débordent de récits d’expériences de transition de genre, jusqu’à l’exemple de cette jeune femme qui a opéré une transition FtM (female to male) pour « trouver la paix » mais qui raconte qu’elle est train de transitionner FtMtF, de redevenir femme, et de se convertir à l’islam car cela, espère-t-elle, lui permettra cette fois de trouver un meilleur équilibre. Je ne suis évidemment pas dupe de la couche médiatique voire fictionnelle qui recouvre ce récit : mais à ce titre, il entre dans la sarabande des points de vue situés.
Dans Petite fille, il n’est jamais question de pratiquer des opérations irréversibles sur le corps de Sasha. Aucune « fixation » : plutôt un essayage, comme on dirait d’un vêtement.
La première erreur, sans doute, consisterait à ne pas saisir que les savoirs sont aussi d’ordre médiatique et fictionnel et que par conséquent, même un « effet de mode » est constitutif de la façon dont une personne se représente. On peut développer sa sensibilité à travers l’usage de TikTok de la même façon que Roland Barthes disait avoir appris à aimer par la littérature.
La deuxième erreur, c’est de ne pas prendre en compte le vécu de la personne qui témoigne. À ce titre, on reprochera sans doute à l’article de Pierre Marie de confondre deux choses sans rapport : le genre et la préférence sexuelle (or on peut être FtM et aimer les hommes). Et surtout, de nier l’existence de ce qu’on appelle la dysphorie de genre en ramenant toute l’humanité sous l’aile de la bisexualité freudienne, c’est-à-dire à un goût sexuel. Or, ce n’est pas de cela qu’il s’agit dans le film de Lifshitz, Petite fille, dont part Pierre Marie dans son texte. Mais bien d’un « trouble » mal connu qui fait que les sujets se vivent dans le genre opposé : Sasha, la sujet du film, est dégoûtée depuis l’âge de trois ans par son pénis et désespérée de ne jamais pouvoir être enceinte. C’est une véritable détresse psychique que filme Lifshitz, une expérience existentielle douloureuse, pas un caprice passager.
Bien entendu, quand il s’agit d’un.e enfant impubère, on peut comme Pierre Marie s’inquiéter que la médecine offre une transition de genre au bistouri, sans prendre en compte le fait que le point de vue, le « savoir » de l’enfant (comme celui de l’adulte) devrait toujours avoir « en vue » de modifier ses « réalisations antérieures ». Qu’en effet, on ne peut confondre une identification, forcément mouvante, de genre, avec une improbable « identité » et « fixer dans la chair la catégorie à laquelle Sasha sera désormais assigné », comme l’écrit Marie. Sauf que dans Petite fille, il n’est jamais question de pratiquer des opérations de transitions irréversibles sur le corps de Sasha. Il n’est même question que d’accompagnement réversible à l’adolescence. Aucune « fixation » : plutôt un essayage, comme on dirait d’un vêtement.
En réalité, Pierre Marie ne semble partir de Petite fille que pour étendre son discours à la transition de genre en général et s’élever contre le principe de réassignation qui, comme son nom l’indique, est une assignation. Si j’ai pu moi-même, à une époque, avoir plus ou moins la même opinion, je crois que la notion de « savoir situé » peut là encore être précieuse. Ce dont il faut prendre la mesure, c’est que le corps est aussi un champ d’expérimentation pour ces savoirs et que, dans la transition de genre, il s’agit parfois moins de s’identifier à tel ou tel genre que d’ouvrir au contraire un champ des possibles, avec l’aide d’une technologie beaucoup moins castratrice qu’on peut l’imaginer. L’horizon cyborg n’est pas celui d’une « cancel technology ».
Paul Preciado a écrit des pages lumineuses à ce sujet dans Je suis un monstre qui vous parle, ouvrage qui s’adresse précisément aux psychanalystes. Les questions d’identité et d’identification y apparaissent comme résolument obsolètes à la lumière du non-binarisme. Preciado a testé sur lui-même la transition de genre, par la prise d’hormones. Il a en quelque sorte fait le voyage, et voici ce qu’il en a ramené : « Le mimétisme est un mauvais concept pour penser la transition de genre car il dépend encore de la logique binaire. Être ceci ou cela, être telle chose et imiter telle autre. Soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme. La personne trans n’imite rien ». Voilà ce que signifie être non-binaire : échapper à « la différence sexuelle ».
Si l’on ne satisfait pas des définitions négatives, un peu avant Preciado en proposait une positive : il évoquait « une évolution parallèle de ma propre vie » se situant pleinemement, a-t-on envie de dire, dans le champ du « savoir » comme spéculation somatique : « Pour être trans, il faut accepter l’irruption triomphale d’un autre futur en soi, dans toutes les cellules de son corps. Faire une transition revient à comprendre que les codes de la masculinité et de la féminité sont anecdotiques comparés à l’infinie variation des modalités de l’existence. » Une philosophie qui semble adéquate à la fois pour laisser Sasha construire ses savoirs d’elle-même et du monde, et pour situer des savoirs « parallèles » dans les études décoloniales ou de genre, sans binarisme, fantasme ni confusionnisme, involontaire ou délibéré.
