Lutter contre l’autocensure scolaire, une exigence démocratique, sociale, économique
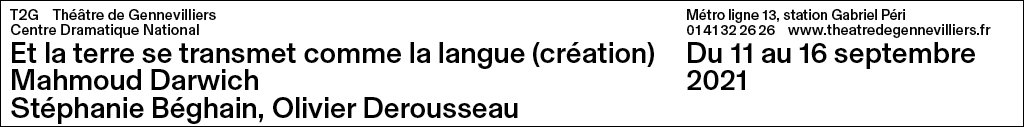
Une partie de la jeunesse française s’interdit le droit de rêver.
Au collège et au lycée, un grand nombre d’élèves d’origine modeste ne s’autorise pas à aspirer à des études longues ; des jeunes d’Île-de-France, du Lot, de Mayotte, à viser des établissements de la capitale ou des métropoles ; des filles, à s’engager dans des carrières scientifiques.
Les barrières sont géographiques, sociales, économiques, mentales. Le phénomène n’est pas marginal, il est massif, mesurable et mesuré. L’enjeu est démocratique. L’assignation à résidence sociale, spatiale et de genre abîme la société et les individus. Elle nourrit les inégalités devant la vie, ces inégalités profondes mises en lumière par Didier Fassin [1].
Le cercle vicieux des aspirations ajustées à la baisse
La question de la méritocratie en France est l’objet de débats biaisés par quelques totems qui suscitent un attachement aussi vigoureux chez les uns que l’est le rejet qu’ils provoquent chez les autres, et par des désaccords de vocabulaire.
S’attacher à lutter contre l’autocensure, c’est s’attaquer à un phénomène social dont le caractère problématique devrait faire consensus. Sauf chez ceux qui prôneraient un ordre social figé, dans la lignée des conservateurs disciples de Durkheim, tel un Paul Lapie craignant en 1904 que l’école gratuite et obligatoire instaurée par la IIIe République puisse inspirer aux élèves des « ambitions excessives » et les détourner « des carrières où les engagerait soit l’hérédité, soit le jeu naturel des forces sociales [2] ». Une conception entrant en opposition avec les fondements même de notre démocratie, qui exige une mobilité et une fluidité sociales véritables, et qui souffre de leur absence.
La réalité factuelle des phénomènes d’autocensure scolaire a été mise en lumière et mesurée par plusieurs travaux. À niveau scolaire égal, les élèves d’origine modeste ne s’autorisent pas les mêmes parcours. Quelle est la part prise par cette autocensure dans le fait qu’aujourd’hui,
