De la fin du charbon à la justice climatique
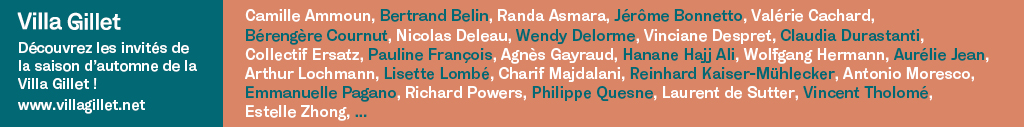
Ces deux dernières semaines marquent à l’évidence un tournant important dans la géopolitique du climat. Lors de son discours (à distance) devant l’Assemblée générale de l’ONU, le président Xi Jinping a en effet annoncé que la Chine allait cesser de « construire » des centrales à charbon à l’étranger.
L’annonce a été largement diffusée. Mais elle n’a pour l’heure pas encore été comprise et commentée à la hauteur de ses implications. Gageons que si Emmanuel Macron ou Joe Biden avaient pris un engagement similaire, la couverture médiatique aurait été fort différente. Et c’est sans doute l’une des clefs de compréhension des annonces du 21 septembre : leur portée ne se limite pas à la seule question du climat. Les conséquences sont nombreuses, y compris du point de vue des stratégies du mouvement pour la justice climatique.
L’effet domino
Dans son discours, Xi Jinping s’engage donc à cesser tout investissement chinois dans des projets charbonniers à l’étranger. Plusieurs précisions sont ici nécessaires : l’annonce ne porte que sur les projets de centrales à charbon, pas sur l’activité minière elle-même. Concrètement, 44 projets de centrales, pour plus de 50 milliards d’investissements chinois, seraient concernés.
Il s’agit là, à l’évidence, d’une des annonces les plus importantes depuis le lancement des campagnes de désinvestissement du secteur des combustibles fossiles. Jusqu’alors, plus de 14 000 milliards de dollars d’actifs ont été désinvestis du charbon, du gaz et du pétrole. Mais il s’agit des actifs totaux, dont une partie seulement est en réalité investie dans les combustibles fossiles.
Courant 2015, le fonds souverain de Norvège a par exemple annoncé désinvestir du charbon, de certains hydrocarbures non-conventionnels (ainsi que du ciment et des mines d’or) – il s’agit d’une des plus grosses capitalisations boursières au monde. Le montant des actifs désinvestis représentait à l’époque 850 milliards de dollars d’actions et obligations – soit le plus gros désinvestissement jusqu’alors. Mais, quoique l’on ne connaisse pas la composition précise des investissements de ce genre de fonds, il est peu probable que la part des combustibles fossiles atteigne 50 milliards de dollars. L’annonce chinoise est donc en valeur absolue littéralement historique. Et sa portée bien plus importante encore.
Dans la foulée, la Bank of China annonçait en effet se retirer sine die de tout projet charbonnier à venir – activités minières incluses. L’annonce de Xi Jinping prend de ce fait une résonance plus importante encore : il s’agit bien pour la Chine d’accélérer sa transition énergétique nationale. Car, dans la mesure où l’essentiel de l’activité minière soutenue par la Chine hors de ses frontières a pour fonction d’alimenter sa consommation intérieure, la Bank of China signifie clairement que la Chine entend réduire sa consommation de charbon dans les années à venir.
Xi Jinping avait annoncé plus tôt dans l’année que les émissions de gaz à effet de serre chinoises atteindraient leur pic en 2030. La tendance est donc à l’accélération : le pic de la consommation de charbon devrait advenir dès 2025 – pour un objectif de « neutralité » carbone en 2060. Dans la foulée, la Malaisie a annoncé à son tour vouloir sortir du charbon.
Les idées justes ne tombent pas du ciel
Les annonces chinoises ne viennent pas de nulle part. Elles s’inscrivent bien entendu dans une tendance lourde : l’ère du charbon est derrière nous, la question n’est plus de débattre de la nécessité de fermer les centrales à charbon, mais de s’organiser de sorte que la dernière soit débranchée au plus vite.
Pour autant, jusqu’à présent, les projets charbonniers continuaient à se multiplier : les tendances sont une chose, la dépendance au sentier (en l’occurrence : les effets de structures d’un mix énergétique précis) en est une autre. Si la Chine accélère sa sortie du charbon, en commençant par les projets situés en dehors de ses frontières c’est aussi en raison de la multiplication des mouvements de résistance aux infrastructures charbonnières. Au Kenya, au Ghana, au Bangladesh, aux Philippines : partout, les communautés concernées par de nouvelles centrales à charbon se mobilisent massivement pour faire barrage à la destruction du vivant. Il s’agit là bien d’une victoire des mobilisations contre l’extractivisme.
Et les émissions chinoises vont continuer à augmenter, du moins jusqu’en 2025. D’ici là, la Chine aura en effet mis en service de nouvelles centrales à charbon, qui représenteront une capacité de production (et des émissions de gaz à effet de serre) équivalente à la production électrique issue du charbon dans l’Union européenne.
L’un des enjeux est donc évidemment de resserrer le mouvement dans le temps, tout en l’étendant dans l’espace, ce qui implique de ne pas se contenter de l’abandon de projets, mais de parvenir à fermer des infrastructures en fonctionnement, bien avant leur date de fermeture programmée – et de s’assurer que l’attention ne soit pas portée sur la seule Chine : il y a du pain sur la planche, y compris en Europe.
Les limites aux annonces du 21 septembre sont donc multiples, et elles ne suffisent pas à nous remettre sur la trajectoire d’un réchauffement contenu au plus près des 1,5°C.
Irresponsabilité commune, mais différenciée ?
Nombreuses et nombreux étaient celles et ceux qui attendaient que les décisions motrices viennent des États-Unis, de l’Union européenne, voire du Royaume-Uni qui préside cette année la COP26.
Joe Biden a certes promis d’augmenter la contribution des États-Unis au fonds vert, mais son administration a soufflé le chaud et le froid : l’administration étatsunienne a autorisé des forages pétroliers dans le Golfe du Mexique, arguant que le « rapport [du GIEC] ne présente pas suffisamment de preuves » pour annuler ces projets. Trump est parti, mais le climato-scepticisme n’a pas quitté la Maison blanche.
Les tensions récentes entre la France (et l’UE) d’une part et l’Australie et les États-Unis de l’autre, sur fond de lutte contre l’influence chinoise dans le Pacifique, sont la dernière manifestation de changements profonds – et, depuis le sommet de Copenhague au moins, les conférences mondiales sur le climat sont autant d’arènes dans lesquelles est mis en scène l’affrontement Chine-USA. Ce qui se joue, pour partie, c’est la perte d’influence de l’Union européenne, qui n’est jamais parvenue à se poser comme un véritable modèle de la lutte contre le réchauffement climatique (un choix qui aurait pourtant été important, y compris pour des raisons purement instrumentales, comme manière de compenser sa perte de puissance géopolitique).
Les annonces chinoises amorcent un tournant important : Pékin se retire des projets charbonniers à l’étude, en Asie et en Afrique notamment, mais ne va évidemment pas renoncer à soutenir les pays africains et asiatiques dans le développement de leur capacité de production d’électricité.
La Chine n’est pas prête à décroître, bien entendu, ni même à modérer le rythme de sa croissance économique. Sa consommation d’électricité continue d’augmenter, et non seulement elle va mettre de nouvelles centrales charbon en service, mais elle développe par exemple des technologies nucléaires endogènes, de même qu’elle s’intéresse au gaz russe. Pourtant elle amorce un tournant majeur, vers une diplomatie climatique active, adossée à une stratégie de déploiement des énergies renouvelables préparée depuis au moins dix ans.
Par là même, Pékin démontre qu’il entend bien assumer sa part de responsabilité dans le réchauffement climatique, et prend à contrepied tous les gouvernements qui cherchent à en faire le bouc-émissaire de leur inaction, en oubliant au passage d’avouer qu’ils importent une bonne partie de ces émissions sur leurs marchés intérieurs.
La différence est ici vive, presque cruelle, avec les atermoiements des États-Unis (1er émetteur historique), de l’Allemagne (4ème), du Royaume-Uni (5ème), du Japon (6ème), de la France (8ème), du Canada (9ème) et de la Pologne (10ème) qui font tous figure de mauvais élèves, à des degrés différents. La Russie (3ème) et l’Inde (7ème) sont également à la traîne. Les États-Unis continuent ainsi d’autoriser les compagnies gazières et pétrolières à exploiter des gisements sur des terres fédérales et apportant un soutien indéfectible à l’économie charbonnière. Le Royaume-Uni rallume ses centrales à charbon sur fond d’augmentation du prix du gaz. La France n’est pas parvenue à proposer un scénario consensuel pour fermer la centrale à charbon de Cordemais, et continue à soutenir Total dans son jusqu’au-boutisme extractif, tout en s’agrippant à l’énergie nucléaire, malgré la gabegie financière qu’elle représente.
L’Union européenne considère le gaz comme une énergie bas carbone, de transition et investit dans des projets d’infrastructures doublement problématiques : ils ne permettent pas de sortir les États membres du centre et de l’Est de l’Europe de la dépendance à la Russie et ils représentent autant d’émissions « bloquées » (une infrastructure mise en service aujourd’hui est censée fonctionner pour au moins 40 ans, soit autant d’années d’émissions supplémentaires). La Russie est l’un des principaux producteurs de gaz, tandis que les États-Unis ont ouvert grand la porte à l’exploitation des gisements de gaz non-conventionnels.
Le retrait chinois du charbon pose bien sûr la question de l’énergie de substitution, étant entendu que la Chine n’entend pas réduire sa production d’électricité ou sortir de l’extractivisme, pas plus qu’elle n’accompagnera ses États partenaires vers la sobriété : par un jeu de vases communicants, la Chine pourrait bien renforcer ses investissements dans le nucléaire et se positionner comme un acteur majeur du gaz pour compenser la sortie progressive du charbon.
Léviathan climatique ou climate Mao ?
Dans leur stimulant ouvrage (non traduit en français) Climate Leviathan: a Political Theory of Our Planetary Future, paru chez Verso en 2018, Geoff Mann et Joel Wainwright distinguent quatre types de régimes politiques, qui correspondent à autant de réponses face au réchauffement climatique : le « Léviathan climatique », une sorte de méta-État, indissociable du capitalisme globalisé, avec une gouvernance mondiale adossée à une souveraineté planétaire qui émergerait du processus onusien institutionnel ; le « Mao climatique », soit une forme de réponse mondiale, mais non capitaliste, à la menace climatique, fondée sur une « terreur juste » ; le « Béhémoth climatique », un agencement mondial reposant sur une approche capitaliste et chauvine qui nierait la réalité du réchauffement climatique, dont Bolsonaro ou Modi sont les représentants actuels ; le « climate X », par lequel les auteurs désignent ce à quoi pourraient donner naissance les mouvements en lutte pour la justice climatique.
La place de la Chine est incertaine : Mann et Wainwright estiment que le « Léviathan climatique » ne pourra émerger sans inclure des États qui restent pour l’heure relativement écartés des espaces et arènes de la gouvernance mondiale – en l’occurrence principalement la Chine et l’Inde. Pour autant, le « climate Mao » ne devrait pas non plus voir le jour sans la Chine. Mann et Wainwright estimaient que le soutien sans faille de la Chine à des politiques industrielles reposant sur une augmentation des émissions de gaz à effet de serre rendait incertaine l’émergence du « Mao climatique ».
Peut-être la donne est-elle alors en train de changer. Le fait que la Chine puisse prendre le leadership mondial de la lutte contre le réchauffement climatique n’est ici nullement anodin : les conditions seraient alors réunies pour qu’émerge une solution organisée autour d’États forts, autoritaires – une forme de « terreur juste » comme seule réponse à même d’enrayer le dérèglement climatique par sa capacité supérieure (par rapport aux régimes démocratiques) à mobiliser les ressources nécessaires à la transition.
L’absence de volontarisme et d’ambition transformatrice dont font preuve les régimes représentatifs européens et d’Amérique du Nord ne fait qu’alimenter l’idée que la démocratie est incompatible avec ce que requiert la transformation profonde du système énergétique. À force de reculer le changement, les États créent les conditions de l’émergence de cette approche autoritaire comme ultime recours : moins ces choix seront anticipés, plus ils seront douloureux, impopulaires et devront être effectués dans l’urgence. Plus nous attendrons, plus le coût social sera élevé – prenant les salarié·es du secteur (et leurs syndicats) en étau, entre la nécessité de défendre l’emploi et leur volonté de contribuer activement à inventer un nouveau modèle.
En outre, l’Union européenne en général, et la France en particulier, s’inscrivent ici dans une impasse démocratique et sociale. En choisissant le prix du carbone comme élément central, sinon unique, des politiques de transition énergétique – sans réelle politique redistributive ; à défaut d’investir massivement dans ladite transition, elles alimentent l’opposition (pourtant largement artificielle) entre l’urgence sociale et l’urgence climatique. Or la question de l’accès à l’énergie est centrale, y compris dans les mobilisations éruptives les plus récentes : le mouvement des « gilets jaunes », mais aussi les mobilisations au Chili et au Liban en 2019 sont venus répondre à des politiques qui faisaient porter le prix de la transition (ou, pour être plus précis, le prix de l’absence de toute transition réelle) sur les classes populaires et les classes moyennes.
En France, les slogans des premiers mois du quinquennat d’Emmanuel Macron (Make the planet great again) et les processus pourtant censément novateurs tels que la convention citoyenne pour le climat (CCC) ont fait long feu. Au fond, les renoncements d’Emmanuel Macron à toute politique climatique ambitieuse ne sont pas seulement tactiques et conjoncturels : à moins d’un changement radical d’approche politique, la France renonce durablement à tracer la voie d’une transition démocratique et sociale, favorisant les plus riches (et les plus pollueurs).
Vers la justice climatique ?
La question n’est pas secondaire. Pékin incarne l’approche par le haut, dirigée par un État fort (dont on sait le peu de cas qu’il fait du respect des droits humains, en particulier concernant les Ouïghours). Aucune approche autoritaire et descendante de la transition ne permettra de « changer le système » tel que les militant.e.s pour la justice climatique le demandent depuis la COP15 à Copenhague. La logique et la vision de Xi Jinping, d’Elon Musk ou des dirigeant.e.s de Google sont les mêmes – la seule variante étant le rôle de l’État et la reconnaissance des droits des « minorités ». Pour le reste, l’avenir proposé est certes un avenir bas carbone (encore qu’il repose largement sur l’entourloupe de la « neutralité »), mais organisé autour de technologies par essence non-démocratiques. Le marché ou l’autoritarisme : nous sommes pris en étau entre deux visions de l’avenir aussi peu émancipatrice l’une que l’autre.
Il peut sembler ici paradoxal de regretter que des régimes représentatifs ne soient pas en mesure d’engager une véritable transition : la France d’Emmanuel Macron ou les États-Unis de Joe Biden ne correspondent pas au modèle d’une transition par le bas. Le revirement d’Emmanuel Macron, qui s’était engagé à reprendre « sans filtre » les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat est ainsi édifiant.
Pour autant, que Xi Jinping parvienne à ringardiser en une annonce et un seul discours les politiques climatiques européenne et états-unienne met en lumière l’incurie des dirigeant.e.s occidentaux et leur irresponsabilité totale.
Il y a un risque que la communauté internationale profite de ces annonces pour remettre à plus tard les décisions ambitieuses, et qu’une part significative de la COP26 soit gâchée à applaudir la concrétisation de la « prophétie autoréalisatrice » de l’Accord de Paris. Les annonces du 21 septembre ne sont, répétons-le, qu’une étape, très insuffisante. Il n’est pas question de rester les bras croisés.
L’étape suivante la plus évidente est d’accélérer la sortie du charbon, de deux manières : en mettant la pression sur les institutions financières privées (et notamment au Japon et aux États-Unis) qui continuent d’investir dans le secteur et en accélérant le rythme des fermetures : il n’est pas seulement question de renoncer à des nouveaux projets, mais de fermer de manière anticipée les infrastructures existantes. L’enjeu est en effet la sénescence planifiée de l’industrie fossile – autrement dit son déclin, jusqu’à sa disparition définitive.
L’Europe est l’une des lignes de front évidente : 166 centrales à charbon demeurent en service dans l’UE. Et le système européen de labellisation des financements des projets énergétiques (partiellement) décidé cette année ne s’applique qu’aux investissements futurs. L’UE ne compte que sur son système d’échange de quotas d’émissions, lamentablement défaillant, pour décourager les opérateurs et les gouvernements à accélérer la transition.
Un autre risque inquiétant est de voir se multiplier les projets gaziers et, dans le cas de la France et de la Chine au moins, que la pression en faveur du nucléaire augmente. Plus généralement, les renouvelables (en particulier les « méga projets ») ne doivent pas s’ajouter aux énergies existantes mais les remplacer, en même temps que s’amorce une diminution globale de la production d’énergie.
Une seule option est ici possible – et elle n’est pas compatible avec ce que propose la Chine : construire un système énergétique décentralisé, faciliter l’auto-production à petite échelle (quartiers, communes, groupes d’habitants, ensembles industriels ou complexes de bâtiments publics…), partagée et redistribuée selon les capacités et les besoins locaux, tout en conservant des structures de planification et de péréquation. Il importe donc d’insister sur la question du contrôle citoyen/populaire de la transition énergétique et sur la nécessité d’une transition par le bas. L’enjeu est alors de reprendre le contrôle des choix technologiques, de sorte que nous déciderons des innovations que l’argent public doit soutenir, des carburants dont nous entendons disposer à l’avenir, des infrastructures auxquelles nous ne souhaitons pas renoncer, etc. Avons-nous réellement besoin de cette usine, de cette voiture et de l’infrastructure de transport qui lui correspond ? Comment pouvons-nous nous passer de cette centrale, de cette méga ferme solaire ?
Le problème est alors le suivant : parviendrons-nous à peser sur la question de la production a priori, autrement dit avant que les choix ne soient faits, plutôt qu’a posteriori, comme le proposent les approches par le marché ? [1] On voit alors ici aussi pourquoi l’approche chinoise n’est pas la seule alternative. Le contrôle a priori peut, de fait, s’effectuer de deux manières : par le truchement d’un pouvoir fort, anti-démocratique (mais soucieux de préserver a minima les conditions de vie des générations futures, pour des raisons multiples, politiques, culturelles, stratégiques…), ou bien par en bas, par le contrôle citoyen.
Il apparaît aussi que les implications diplomatiques et géostratégiques de ce qui se joue avec l’annonce chinoise sont l’affaire des mouvements tout autant que des ministères des affaires étrangères et des services « d’intelligence » économique : la question de la diplomatie et de la politique étrangère nous concernent d’autant plus que les instruments qui nous permettront d’aborder et de réussir la transition sans rien céder à la Chine (ou à d’autres États autoritaires qui pourraient choisir de se positionner comme des acteurs de premier plan de la lutte contre le réchauffement climatique) restent à inventer entièrement.
Pour les puissances occidentales, « ne rien céder » signifie généralement une course à l’armement (ce dont atteste la récente affaire des sous-marins australiens) et d’éventuelles sanctions économiques et commerciales dont on ne sait que trop qu’elles affectent avant tout les plus vulnérables et n’affaiblissent jamais les élites politiques, économiques et militaires.
Enfin, à un mois de la COP26, la séquence ouverte ces dernières semaines redonne toute son importance aux négociations à venir… alors même que « l’apartheid vaccinal » rend extrêmement difficile une participation massive des organisations de la société civile, en particulier des pays du Sud.
