Faut-il rémunérer la nature pour son travail ?
Ce texte est la première étape d’un livre à venir sur le travail de la nature, pensé et conçu avec la juriste Sarah Vanuxem et le philosophe Matthieu Duperrex pour réfléchir, dans le sillon du soulèvement légal de la Terre, à l’économie qui pourrait en naître. Il s’agit moins d’un texte de réflexion que d’un travail de scénarisation. Voici l’hypothèse qui préside à ce scénario : si nos sociétés ont le courage de donner le statut de sujet de droit à des écosystèmes, des milieux, des espèces animales et végétales, mais aussi, à des processus naturels – capture du CO2, pollinisation, cycle de l’eau… – alors, ces sujets de droit émergents pourraient également demander des revenus pour le travail qu’ils accomplissent.
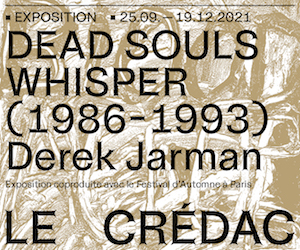
En quelques années, ces grands sujets naturels dotés de droits et touchant des revenus seraient à même de défendre les intérêts terrestres, en reversant à la nature une partie de la valeur qui lui est quotidiennement arrachée, en mettant fin à cette immémoriale injustice des systèmes humains : le travail-esclave de la Terre. À l’heure d’une certaine faillite des États – l’échec de la COP26 à Glasgow – cette voie permettrait également de faire émerger de plus solides gardiens de la Terre : les entités de la nature elles-mêmes, reconnues juridiquement. Voici quelques fragments – notes, didascalies, objections… – de ce scénario d’anticipation, pour une économie politique terrestre.
1.
… didascalie… Figurons-nous d’abord un impossible : une personnalité juridique « Terre » incarnée par des gardiens. Soit, un grand sujet de droit portant les valeurs, les besoins, les droits de la Terre. Et maintenant, imaginons que ce sujet de droit « Terre » réclame les revenus impayés pour le travail millénaire de transformation des sous-sols en pétrole ? Ses avocats exigeant : que nos sociétés paient non seulement des dommages et intérêts pour les atteintes portées à l’intégrité terrestre, mais en plus, les revenus impayés en contrepartie du travail-esclave accompli par la combinaison de la roche-mère, des bactéries… depuis les premiers soubresauts des diverses révolutions industrielles. Nous avons là une situation de départ pour notre scénario. Nous aurions là également un cas de jurisprudence, et un montant tel de compensation que le sujet de droit « Terre » pourrait financer une grande partie des coûts de la transition vers des économies décarbonées, en imposant des choix de mix énergétiques favorables non seulement aux milieux, mais aussi aux humains les plus exposés au réchauffement climatique. Nous serions, à la suite d’une telle « affaire », pleinement entrés dans une nouvelle économie politique : celle où ces sujets de droit émergents, incarnant des entités ou des processus naturels, se joindraient aux combats des sociétés civiles pour peser sur les arbitrages politiques.
2.
… suite… Prolongeons l’hypothèse de cette jurisprudence terrestre, mais de façon plus pragmatique et fragmentaire. Mettons qu’un grand nombre de sujets de droit émergents – des milieux, des espèces – usant de leurs capacités légales, obtiennent d’en finir avec le travail-esclave de la nature. Imaginons soudain, dans les tribunaux, ces sujets de droit plaider leurs causes, conduisant les juges à reconnaître la légitimité de ce combat inédit pour les salaires de la nature. Figurons-nous ici, le Danube, là, les forêts d’Amazonie, ici, l’espèce Abeille, là, la mer du Nord, ici, les coraux polynésiens, là, les mines africaines, ici, les longs fleuves de Chine, là, les grands lacs américains, ici, les poissons de l’Atlantique… Partout, de « grandes personnalités naturelles » se mettent à négocier leurs conditions de travail et engrangent des revenus. Les éléments naturels, pour leur compte, récupèrent donc une partie de la valeur kidnappée par les industries humaines. Dans ce scénario, des centaines de milliers de travailleurs terrestres acquièrent dès lors une capacité d’action, pour contrebalancer les impacts de l’industrie et défendre des logiques de restauration, de ménagement, de transition ou de sanctuarisation de la Terre.
3.
… note préalable au scénario… La réalité que nous connaissons – celle d’une capture, d’un arraisonnement du travail de la nature par les fictions du capital et de l’État – est le fruit d’une certaine écriture du droit : un encodage qui donne des droits exorbitants à de super-sujets : des États, d’une part, qui recherchent partout le développement, la croissance ; et des marchés, des groupements d’actionnaires, des entreprises d’autre part, qui sont conçus, structurellement, pour arracher de la valeur à la Terre et au travail humain. Ces deux espèces de fictions du droit – les États et les Entreprises – peuvent être vus comme des hyper-personnes, à l’image de ces créatures – les Transformers – que les films pour enfants représentent. Posons ici que notre scénario revient à faire émerger, à côté de ces « grandes personnes légales », des Transformers plus ancestraux : les sujets de droit de la nature. Il faut alors se figurer, dans ce scénario, le siècle à venir comme une bataille entre diverses « hyper-personnes ». Celles qui ont des visées productives, industrielles, de transformation, et celles qui ont des visées de préservation, de conservation, de restauration des milieux naturels ; et qui pourraient aider, face aux conséquences des dérèglements climatiques, à la transition et à la protection des sociétés humaines les plus exposées. Dans le contexte des COPs, les États ne seraient plus seuls face aux intérêts industriels. Ils auraient, à leurs côtés, poussant dans le sens des métamorphoses de nos économies, ces grandes entités légales de la nature : océans, glaciers, lacs, forêts, espèces animales et végétales…
4.
… questions… Face aux « Transformers » connus et admis actuellement – ces hyper-personnes, les États, les Entreprises – que peuvent les éléments de la nature s’ils n’ont ni droits ni moyens pour se défendre ? Qu’est-ce qui changerait dans nos économies si nous avions, à nos côtés, pour défendre les intérêts des travailleurs de la Terre, de nouveaux sujets du droit ? Ces grands sujets de droit connus – États, Entreprises – organisent aujourd’hui les espaces publics et les flux transnationaux d’argent, de marchandises, de personnes ; ils écrivent le droit, s’en détournent. Nous sommes dépendants d’eux pour le travail, pour la santé, pour les études, pour les retraites… Si parfois, leurs intérêts divergent, la tendance est plutôt à leur intrication : une intrication permanente des intérêts privés et publics en vue ici du développement, là de la croissance, ici d’une notion vague telle que le progrès… Les dernières négociations de Glasgow le prouvent une fois encore, et les engagements du président français en faveur du nucléaire le démontrent amèrement : les États ne sont pas de bons gardiens du temps long, ils servent les intérêts de leur « puissance », de leur « souveraineté », sans égard pour les communs naturels. L’enjeu du scénario que nous proposons tient à une réécriture, une modification de l’encodage juridique du monde, en créant partout des « personnes de la nature » rémunérées.
5.
… contexte et dialogue… Depuis le début du siècle, nous assistons à un soulèvement légal de la Terre : soit des rivières, des lacs, des montagnes, des écosystèmes entiers, des océans, des glaciers, certaines espèces végétales, animales… reconnus « sujets de droit »… — Et donc ? — Ça signifie qu’un nombre croissant d’entités naturelles peuvent accomplir des actes juridiques, signer des contrats, ou embaucher des gens ou aller en justice demander réparation. — Des exemples ? — Depuis 2008, en Équateur, un peu plus de 30 procès ont été initiés par des entités naturelles. Une vingtaine ont été gagnés. — Et puis ? — En 2019, 170 arbres de la ville de Bruxelles ont rejoint une action en justice contre l’État belge. Et en 2021, aux États-Unis, des zones humides ont attaqué l’État de Floride. Traduction de cette tendance, vers un soulèvement légal terrestre : on ne peut plus arrêter cette bascule légale. Il y aura de plus en plus de sujets de droit d’entités naturelles. Et la question n’est plus : est-ce qu’on est pour ou contre, mais : comment organiser l’économie qui va naître de là ? À quoi ça ressemble, un monde où des lacs, des rivières, des forêts, l’espèce « Abeille », l’espèce « Castor », ou « le processus de pollinisation » peuvent revendiquer des revenus ?
6.
… dialogue… Partons de ce qui fait mouvement : le soulèvement légal de la Terre, celui qui est au cœur du livre, Le fleuve qui voulait écrire, et des combats contemporains pour les droits de la nature, qui passent par des voix telles que celle de Marie Toussaint, députée européenne, ou Valérie Cabanes, qui promeut la reconnaissance du crime d’écocide. La juriste Marie-Angèle Hermitte qualifie ce soulèvement légal d’« animisme juridique ». — Pourquoi ? — Parce que ça signifie que, dans le monde qui vient, qui est déjà là, nous animons par le droit des entités qui jusque-là étaient considérées comme des choses. Ainsi, un fleuve, vu comme une « ressource », sera maintenant, potentiellement, une « personne ». — Et donc ? — Plutôt que de se demander si ça va arriver, ici, en Europe, on va chercher d’emblée à se projeter dans cette bascule du droit pour voir où elle peut nous mener. — Et ? — Et là, il y a de nombreuses conséquences. On va se demander : comment instituer ces nouveaux sujets ? Comment définir ce nouveau « mandat terrestre » ? Comment incarner et traduire les voix de la Terre ? Mais surtout, il y a cette question : est-ce que les sujets de droit émergents auront une capacité juridique pour toucher des revenus pour le travail qu’ils accomplissent et qui, jusque-là, est capturé par les intérêts humains ?
7.
… suite au dialogue… Tu as fait des études de droit ? — Non. — Alors, tu ne sais peut-être pas ce qui se passe : quand tu personnifies, en droit, quand tu donnes la personnalité juridique à une entité particulière, et bien, cette « nouvelle personne » est adossée à un patrimoine. — On lui donne de l’argent ? — Non, elle a, si tu veux, un potentiel avoir qui accompagne son être. Ça veut dire qu’elle peut acquérir des choses, en céder, conclure des contrats. Elle a aussi, potentiellement, une responsabilité, et, bien souvent, des mandataires. — Et alors ? — Et bien, ça signifie que la valeur créée ne passe plus seulement entre des mains humaines. Cette valeur va en partie vers des non-humains institués en personnes légales. Et donc le droit, en faisant surgir ces êtres juridiques – animaux, végétaux, milieux, processus naturels… – pourrait leur donner également la capacité de revendiquer des revenus. Ça crée, si tu veux, une déviation dans le circuit de la valeur : au lieu que seules des entreprises humaines exploitent le travail de la nature, les entités naturelles mobilisées toucheraient également des revenus. Et elles pourraient, par la suite, user de ces sommes pour dé-produire.
8.
… suite… — Ok, donc, je résume, on crée des sujets de droit pour les êtres de la nature qui peuvent de ce fait être rémunérés pour leurs productions et les services rendus aux humains ; et ces rémunérations vont servir au ménagement et à la réparation de la Terre, c’est ça ? — On peut le voir comme ça, oui. Et on pourrait prévoir même des statuts pour ces sujets de droit d’entités naturelles, afin qu’ils s’aident entre eux, afin qu’ils aident des sociétés humaines fragiles et exposées aux dérèglements climatiques. — Mais ce mécanisme de redistribution, ça s’appelle l’impôt en fait ? — Non, l’impôt va vers l’État. Là, c’est du revenu et ça irait directement aux travailleurs de la Terre, aux rivières, aux lacs, aux forêts, aux montagnes, aux champs… — Donc, ça revient à se dire : puisque les États n’ont pas été de bons gardiens des communs naturels, créons des sujets de droit autres, des « états de nature ». — Je vais le dire autrement si tu veux bien. En somme, trois voies permettent d’imposer le respect des entités naturelles : la sacralité, l’éthique, la loi. Quand la sacralité ne permet plus de défendre la nature, on va chercher du côté de l’éthique. Mais, comme l’éthique ploie devant l’économie, on en vient au droit. — Oui, mais le problème, c’est que les droits sans moyens financiers pour les défendre, ça revient à l’éthique. — Voilà pourquoi c’est intéressant, dans le scénario, de penser aux revenus des éléments de la nature. Si les sujets de droit émergents de la nature revendiquent un salaire pour leur travail, alors, ils auront de quoi se défendre…
9.
… suite… — Je ne sais pas si tu sais, les juristes de l’environnement emploient parfois l’expression soft law. C’est une façon de dire que le droit, dans certains cas, n’est pas contraignant. Les récentes déclarations de la COP26, encore une fois, nous rappellent assez amèrement ce qu’est une soft law. En bref, on signe des traités, on intègre des normes dans nos systèmes légaux nationaux pour les rendre opposables. Mais à la fin, on les piétine, on les compense, on les ignore. Or, concernant la bascule culturelle et économique que nous devons accomplir face aux perspectives du réchauffement climatique et de la destruction des espèces, nous en demeurons à peu près toutes et tous là : un constat d’impuissance, de non-respect des lois… et bien sûr, une colère, une colère sans issue ; sans autre issue que cette éternelle plainte aux États et à leurs représentants. Et donc, conséquemment, nous nous posons la question de l’efficacité de la loi, d’une opposabilité réelle des droits de la nature. Comment faire ? — Je comprends. Si on couple le sujet de droit et le revenu des entités naturelles, alors, on aura des grandes personnes naturelles en capacité d’imposer leurs vues, leurs valeurs, leurs perspectives. On aura potentiellement de véritables « gardiens », qui n’auront pas un mandat mixte comme les personnels politiques, qui doivent poursuivre des objectifs contradictoires, la réduction de CO2 et la croissance, le plein emploi et la sobriété énergétique, la puissance industrielle et le respect de l’environnement… Ces autres sujets de droit, eux, n’auront, statutairement, qu’une seule mission : défendre les intérêts du temps long des cycles naturels et l’habitabilité de la Terre.
10.
… suite… — Et tu penses que c’est comme ça que la mécanique du scénario va s’activer, par cette réécriture du droit ? — Disons que c’est notre moteur, ici : sujet de droit pour les entités naturelles, plus, renégociation, entre ces sujets et nos instances humaines, des conditions du travail terrestre. — Mais est-ce que ce ne serait pas mieux, tout simplement, de changer nos manières de vivre ? — Oui, sans aucun doute. Tout irait mieux si nous arrivions à imposer un horizon indien à l’Occident. Tu sais comme moi de certains anthropologues que certaines cultures vivent plus intelligemment avec leurs milieux et respectent la Terre, parce qu’ils n’ont pas congédié les mythes, les narrations, les rituels qui les relient à la nature. Mais tu sais aussi, après cinquante ans de travaux sur l’éthique environnementale, que ça ne suffit pas, que celles et ceux qui ont la charge des grands flux – capital, information, marchandises – ne parviennent pas à changer l’ordre des choses ou ne veulent pas le changer. Ils exploitent leurs rentes. Et tu sais encore que les métamorphoses existentielles – vivre en indien ou vivre sobrement – n’ont que très peu d’effet sur la majorité des comportements. — C’est pour ça que tu en viens à ce scénario ? — Disons que l’on cherche comment modifier notre économie politique à l’échelle, sans attendre le grand soir de l’Effondrement. — Et tu te dis : il y a ce tournant légal, des sujets de droit qui permettent soudain d’avoir des destinataires pour les revenus du travail des entités naturelles — En effet, je me dis que c’est à penser. — Mais ton scénario, en quoi il diffère des promesses du capitalisme vert ?
11.
… suite… — C’est une question douloureuse. Mais je te remercie. Ça me permet de souligner ici la différence profonde qu’il y a entre la logique du droit – les droits de la nature – et la logique du marché – la croissance verte et les services écosystémiques que les économistes sont en train de promouvoir, partout, dans les futurs accords internationaux, à l’OMC, au FMI, à la Banque mondiale… — Les services écosystémiques ? — Je vais t’expliquer. Dans ce que le marché propose, les entités humaines, entreprises, exploitations agricoles, collectivités territoriales, États, restent les destinataires du revenu. La nature accomplit son travail, mais ce sont toujours les entités humaines – les « Transformers » institués – qui captent la valeur créée. Le « service écosystémique », c’est la double peine pour les éléments de la nature. Non seulement on étend l’emprise de la comptabilité aux vivants, à la Terre, aux animaux, aux végétaux ; non seulement, on se met à les considérer, d’un point de vue économique, comme des acteurs productifs, mais on leur dénie le statut de travailleurs, on ne les rémunère pas. — Ok, et dans l’autre logique ? — Dans l’autre logique, celle de notre scénario, celle du droit, qui découle potentiellement de la personnalisation juridique des éléments de la nature, on sort du travail-esclave. On pense un monde, où à côté des travailleurs humains, des travailleurs non-humains s’appuieront sur leurs reconnaissances légales pour exiger des revenus.
12.
… suite… — Tu as un exemple ? — Mettons, un apiculteur canadien. — Pourquoi canadien ? — Pourquoi pas. — Ok, et alors ? – Il descend en camion jusqu’à San Diego. — Et… ? — Il emporte avec lui ses ruches pour polliniser les cultures d’un agriculteur californien. — Donc, il loue le service de ses abeilles ? — C’est ça. Et à l’issue de la pollinisation, il facture le travail de ses abeilles et les autres trucs qu’il a mis en mouvement pour assurer ce service. — Et toi, tu te dis, s’il y avait un sujet de droit « Abeille », on pourrait payer les abeilles ? — Disons qu’au lieu que l’apiculteur soit le seul destinataire des sommes facturées, on aurait une partie de la valeur qui reviendrait aux Abeilles. Et là, on peut imaginer que les gardiens de l’espèce Abeille useraient de ces sommes notamment pour engager des actions contre les producteurs de pesticides. — Tu as un autre exemple ? — Une forêt. — Et ? — C’est une forêt, on va dire, qui est plutôt bien exploitée. Les forestiers ne prélèvent chaque année sur la masse de bois « que les intérêts du capital ». — Ça veut dire quoi ? — C’est une vieille loi suisse que j’ai étudiée, qui a été votée après un grave incident, un village écrasé par un glissement de terrain. Les gars avaient tellement déboisé, que la montagne a fini par tomber. — Et donc ? — Et bien là, c’est un exemple où il y a plutôt une bonne loi. Ce que ça signifie, c’est que l’État a été un bon gardien, il a permis que la forêt traverse le temps, qu’elle se renouvelle. Mais maintenant, qu’est-ce qui se passe si la forêt devient un sujet de droit et que cette « hyper-personne » demande des revenus ? — Ben, je dirais simplement que le prix du bois va augmenter. — Oui, mais remarque qu’il augmente de toute façon. Non, ce qui est stimulant, c’est ce que cette forêt va pouvoir faire avec ses revenus. Et là, on peut imaginer que, comme elle se porte plutôt bien parce qu’il y a une bonne loi, la forêt puisse aider, avec ses revenus, des défenseurs de la forêt au Brésil ou dans une autre région du monde. — Ce serait une « forêt redistributrice » ? — On pourrait, oui, imaginer que les divers sujets émergents de la nature aient la capacité légale, quand les revenus le permettent, de s’entraider.
13.
… suite… — Ce que je commence à voir, dans ton scénario… enfin, disons que j’ai cette vision : des batailles de « Transformers ». D’un côté, tu as les Transformers connus : des États, des Entreprises, avec la technologie du capital, du pouvoir qui va avec. Ils utilisent les fictions actuelles, leur statut de sujets pour acquérir des droits : droits des marques, des investissements, droits à la concurrence, droits de la propriété intellectuelle… Et de l’autre, il y aurait ces « Transformers » de la nature : ici, une espèce, là, un milieu… Il y aurait donc, dans l’avenir, des luttes entre ces « hyper-personnes » ? — Si on y réfléchit, c’est déjà comme ça que ça marche. Pense à la lutte entre les États, les divers acteurs productifs, et le réchauffement de la Terre. Tu es déjà sur cette scène : une bataille entre des sujets de grande échelle. D’un côté, la Terre, de l’autre, des États et des intérêts industriels. Mais ce qui va changer, avec notre scénario, c’est que l’on institue les tiers acteurs de la nature. On reconnait le besoin de disposer, pour défendre la vie terrestre, des sujets de droit de la nature qui peuvent contrebalancer, au nom de l’habitabilité de la Terre, les intérêts de l’industrie humaine. — Mais leurs revenus dépendront de l’exploitation, de l’usage. — Oui, justement, ils obtiennent des revenus parce qu’il y a exploitation. Parce que nous ne parvenons pas à penser autrement l’habitation des modernes autrement que par l’exploitation de la nature. Donc, parce qu’il y a exploitation, des entités naturelles pourront soutenir, dans l’espace social, les causes de la Terre, de la transition, et de la sanctification de certains milieux.
14.
… objection… — Ok. Mettons qu’on en arrive-là… On a ces entités de la nature qui ont des droits et des revenus et ça tombe chaque mois ou chaque année… je vois. On a donc des bataillons de travailleurs de la Terre, les êtres de la nature institués en personnes légales qui produisent et sont rémunérés… mais ça va servir à quoi, tous ces revenus engrangés ? Je veux dire, une forêt avec des revenus, une Terre avec des revenus, des abeilles avec des revenus, ils en font quoi ? — Tu sais, il faut d’énormes sommes d’argent pour organiser la transition, pour défendre partout les droits de la nature, pour mener des actions en justice… — Oui, mais c’est aux États de prendre les bonnes décisions, d’impulser ces changements, de financer ces réparations. — Là, je crois qu’on avance. Parce qu’au lieu des États qui ont été, en résumé, d’assez pauvres gardiens de la nature, on aurait avec nous ces hyper-personnes, des lacs, des forêts, des rivières, des espèces animales et végétales qui pourraient consacrer leurs revenus au ménagement du monde. Elles pourraient, par exemple, s’inspirer de ce qui se fait déjà, à savoir racheter des terres, pour les sanctuariser, pour les redonner à la vie sauvage. Elles pourraient bien sûr payer des lobbyistes, des avocats, pour contrebalancer le pouvoir exorbitant des industries humaines. — Donc, la logique, c’est, par exemple, l’industrie du transport maritime… paie la mer, et la « mer » devenue sujet de droit pourrait ainsi financer à rebours des actions pour préserver la faune et la flore, collecter les plastiques, défendre la réduction des quotas de pêche ou réglementer les transports… ?
15.
… suite… — Je ne sais pas. Je t’écoute. Et je trouve que ton scénario, c’est un truc de grand malade. J’ai beaucoup d’objections qui me viennent, tu sais. — Vas-y, je t’écoute, je te propose de les énoncer rapidement. J’essaierai d’y répondre aussi très rapidement. — Ok, déjà, la monétisation de la nature… — La nature est monétisée depuis le Néolithique. Les humains, en tous les cas, les modernes, se servent d’elle. Là, au moins, il y a une contrepartie. — Mais il y a aussi toute cette administration de la nature que ça suppose. — La nature est administrée. Va voir dans le détail, les forêts, les lacs, les rivières. Tout est déjà totalement administré. Ce qui s’ajoute, ici, c’est une intensité d’incarnation : de la perspective, du vouloir, des intérêts de la nature. – Comment tu vas contrôler les sommes touchées par les éléments de la nature ? — Tous nos systèmes humains reposent déjà sur des règles de comptabilité. Si tu regardes les « Grands Parcs », aux États-Unis, il y a des mandataires, des sommes allouées, un fonds… — Je ne sais pas. Tu ne doutes pas ? — J’ai plein d’objections, de critiques sur ce scénario. Mais ce qui va me convaincre, c’est de voir une part de cette puissance hors-sol qu’est devenue l’argent se mettre au service d’autre chose que d’elle-même, d’autre chose que la production, le développement infini. Ce qui m’intéresse, c’est cette poussée qu’on organise, depuis la nature, qui permettrait de faire advenir une économie politique terrestre : soit, une part des revenus qu’une petite portion d’humains arrachent à la Terre, et qui, ici, reviendrait aux sujets de droit émergents : des lacs, des rivières, des montagnes… des espèces menacées, fragilisées.
16.
… suite… — J’ai encore une inquiétude, tu veux l’entendre ? — Je crois que je vois laquelle. — Vas-y. — Tu te dis qu’on risque de se retrouver avec des entités naturelles qui pourront dire : « Nous arrêtons de travailler pour vous ». Et comment on fera alors pour se nourrir et pour vivre ? — Je me dis que, comme on a créé des États et des Entreprises grâce à nos écritures juridiques, on pourrait se retrouver également soumis par ces autres hyper-personnes. — En fait, ce n’est pas exactement comme ça, il me semble, que le scénario se déploie. Nous autres, les humains, nous avons des intérêts contradictoires. Nous avons intérêt à sauver la Terre, à garantir l’accès à l’eau, à maintenir des conditions climatiques habitables, etc. Mais en même temps, nous avons intérêt à ce qu’il y ait de l’emploi et des investissements. Si ce n’est pas nous, c’est notre oncle, notre sœur qui travaille dans le privé… Et puis, dans le même temps, même si nous n’avons pas intérêt à ce que l’État nous matraque et nous violente, nous avons intérêt à ce qu’il assure des missions de service public, notamment l’éducation… — Là, je te perds. — Ce que je te dis, c’est que nous sommes intriqués à tous les « Transformers ». Nous sommes écartelés entre des intérêts contradictoires. Mais nous avons désormais besoin qu’il y ait aussi ces « hyper-personnes » de la nature pour défendre nos communs naturels.
17.
… dialogue… — J’aimerais poursuivre. — J’ai tout le temps. J’ai découpé le texte en micro-paragraphes pour qu’on puisse s’arrêter, continuer. – Ok. Alors je voulais te dire tout à l’heure que ton scénario, me semble-t-il, tient à un fil. — Oui, il est très improbable. Mais j’aime bien penser avec l’improbable, ça permet de sortir de l’étau où l’on se trouve, où l’on n’arrive pas à transformer la réalité. — Ce qui apparait, en t’écoutant, c’est que ton histoire dépend du statut de ces nouveaux sujets. Qu’est-ce qu’ils auront le droit de faire ? Comment ils imposeront leurs conditions de rémunération ? Quelles seront les voix humaines de ces « hyper-personnes » ? Comment être certain qu’elles ne vont pas être corrompues par les autres acteurs étatiques ou industriels ? — Là, je me permets de t’arrêter. Toutes tes questions sont justes, et particulièrement celle qui se demande quel statut pour ces nouveaux sujets. Mais la question sur la corruption… je veux dire… cette idée juste et chaque jour vérifiée que tout est corruptible, que tout sera finalement corrompu… Ça, je vais te dire, si tu introduis cet élément-là, tu peux tout détruire, plus rien ne tient. Pour avancer dans ce scénario, tu as raison, il faut encore croire à la loi, au moins un tout petit peu : croire à notre capacité collective à écrire le droit, à redéfinir les termes de nos habitations, et à respecter ces termes…
18.
… suite … — Mais je vais quand même essayer de te répondre. — Vas-y, je t’écoute — Est-ce que tu as confiance ? — Confiance ? Comment confiance ? En qui, en quoi, en moi ? — Si tu n’as pas confiance, je veux dire, si tu ne fais plus confiance à rien ni à personne, tout s’arrête. — Je ne comprends pas. — Tout ce que l’on discute, ici, part du fait que malgré tout, malgré toute la corruption qu’il y a en ce monde, on continue à avoir confiance — Mais en qui ? En quoi ? En des « gardiens de la nature », des « élus » ? — Si je te dis « table » en montrant une table, tu y crois ? — Je suppose. — Tu vois, ça, c’est la base, la petite confiance que l’on place dans un code, une langue, une manière d’écrire le monde. — Ok, et donc ? — Donc, quand on accepte le verdict des juges, que l’on se range, même résigné, aux résultats d’une élection, que l’on accepte de payer ses impôts… tout ça, ce sont des signes de la confiance. On suit la manière dont nous avons écrit la loi. — Et ? — C’est pareil pour cette nouvelle écriture juridique, si nous arrivons à nous mettre d’accord pour habiter un monde où les éléments de la nature sont des sujets de droit, et si nous acceptons cette idée qu’ils doivent être payés pour leur travail, on peut avancer. On peut commencer à réfléchir aux statuts, à ce que ces sujets pourront et devront faire, ce que ces sommes rappelées à la nature, à rebours des intérêts industriels, permettront d’accomplir.
19.
… suite… — Donc, tu me demandes de faire confiance ? — Comme tu fais, malgré tout, in fine, confiance aux juges qui sont dans les tribunaux, aux experts-comptables, aux chiffres de l’INSEE, aux administrateurs des fondations, aux associations d’utilité publique, aux porte-paroles des diverses luttes… — Et qu’est-ce que tu réponds si je te dis que la nature, pour moi, ça ne peut pas être une entité légale, encore moins, une entité économique, que tout ça, c’est justement le problème. — Je te poserais une question en retour. — Je t’écoute. — Est-ce que la nature n’est pas déjà absorbée par l’économie et par le droit. — Mais c’est le problème. — Oui, tu as raison, c’est le problème. Mais avec huit milliards d’êtres humains, dix milliards en 2050, c’est notre horizon. On peut réduire nos empreintes, manger de la nourriture cellulaire, interdire la voiture, les avions, on continuera d’user du monde. C’est ce que notre espèce a fait depuis sa verticalisation. Et là, je crois que l’on peut se mettre d’accord. La nature continuera d’être mobilisée par nos diverses habitations humaines. — Donc ? — Donc, ce que l’on essaie de penser, avec ce verdict, ce tragique de l’exploitation, c’est qu’au moins une part de cette exploitation revienne à la Terre.
20.
… Autre objection… — Mais parmi les chefs d’État, les industriels, et sur les marchés, qui voudrait aller dans ce sens ? Payer les éléments de la nature pour leur travail ! Ils ne veulent déjà pas appliquer les restrictions de CO2. — Pour répondre à ça, je pense qu’il faut en revenir à Stone ? — Qui ? — Stone, Christopher, le pionnier de l’idée de personnalisation juridique des éléments naturels[1]… Quand il parle des esclaves, du fait que personne, parmi les grands propriétaires, n’avaient intérêt à l’émancipation des esclaves. — Et alors ? — Les esclaves, par la lutte, ont obtenu le statut de sujets de droit, ils ont donc pu obtenir une rémunération. — Dérisoire. Tu sais en plus très bien que seuls les propriétaires ont eu le droit à des compensations. — Tu as raison. Il faudrait penser une vaste réparation à hauteur de l’ensemble des revenus qui n’ont pas été payés aux populations traitées, comme il faudrait le faire pour les éléments de la nature. Mais même si c’est dérisoire, on peut considérer que c’est tout de même louable d’être payé pour son travail et de pouvoir en changer plutôt que de porter des chaines. — Je ne sais pas, vas-y, continue. — Il y a eu des luttes, donc, des voix qui se sont élevées contre l’esclavage et il a été aboli. Pourtant, aucun des bénéficiaires de la Traite n’y avait intérêt. On pourrait imaginer qu’il en soit de même pour les droits de la nature et la rémunération des travailleurs de la Terre. Il pourrait y avoir un consensus, ou du moins, une majorité, pour aller vers cette économie politique terrestre*…
* Nous arrêtons ici ces quelques fragments pour une scénarisation déviante de l’économie politique. À suivre dans de futurs épisodes…
NDLR : Camille de Toledo vient de mettre en récit Le fleuve qui voulait écrire. Les auditions du parlement de Loire chez Manuella éditions et Les liens qui libèrent.
