Sauve qui peut : une lecture désabusée de l’évacuation depuis Kaboul
L’évacuation qui a suivi le retour au pouvoir, en août dernier, des Taliban à Kaboul a été relayée par les médias du monde entier. Aux côtés du personnel expatrié des ambassades et des forces militaires, quelques 100 000 Afghans ont bénéficié, eux aussi, du pont aérien. Mais ils n’étaient pas les seuls à vouloir partir. Les images et les récits des Afghans massés à l’intérieur et autour de l’aéroport de la capitale afghane, prêts à tout pour monter à bord d’un avion, ont ému et indigné beaucoup d’entre nous.
D’aucuns y ont vu une manifestation de la précipitation déclenchée par la rapidité de la conquête de Kaboul par les Taliban ; d’autres y ont vu une preuve de la peur suscitée par ceux-ci ; d’autres encore considèrent ces images comme le symbole de l’échec occidental en Afghanistan.
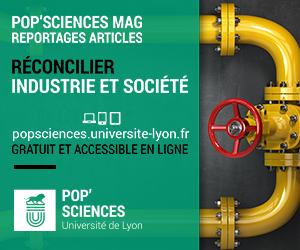
J’y vois l’aboutissement indécent des obstacles dressés depuis fort longtemps devant ceux qui souhaiteraient quitter légalement l’Afghanistan. Un billet d’avion pour l’Europe ou les États-Unis constitue un mirage pour la plupart des Afghans. Les alternatives qui se posent concrètement et cruellement à la plupart d’entre eux sont soit de rester, soit de partir dans l’illégalité. Alors que l’illégalisation des migrations afghanes vers l’Europe date de leur commencement il y a vingt ans, ce phénomène est plus récent en ce qui concerne les mobilités régionales.
Ceux qui partent, ceux qui restent
Qui a pu finalement embarquer pendant les deux dernières semaines d’août ? Laissons de côté les expatriés, par ailleurs habitués aux va-et-vient par voie aérienne, au gré de leurs missions et de leurs congés. Laissons aussi de côté les VIP Afghans, à l’image du président Ashraf Ghani, qui a quitté le pays avant même que les Taliban ne prennent Kaboul. Ont pu embarquer celles et ceux qui étaient sur les listes rédigées dans la précipitation par les unités de crise des pays qui évacuaient, dans la limite des places disponibles à bord des avions et sous réserve de parvenir à atteindre l’aéroport, puis l’avion, malgré le chaos ambiant.
En deux semaines, plusieurs milliers d’Afghans qui avaient collaboré avec les ambassades et les forces militaires étrangères, souvent accompagnés de leur famille, ont été évacués en urgence. Dans le cas de la France, environ 2 700 personnes – personnel de l’ambassade et collaborateurs de l’armée, interprètes, artistes, membres des familles d’Afghans réfugiés en France, entre autres – sont arrivées dans l’hexagone.
C’est oublier un peu vite les personnes qui, tout en figurant dans les listes, ont été victimes d’erreurs pratiques (comme cet ingénieur dont le numéro de téléphone avait été mal transcrit), ou n’ont pas pu atteindre l’aéroport à temps (en témoigne l’histoire de cet homme reconnu dans la foule par ses ex-collègues de l’armée, qui a ainsi pu monter à bord de leur véhicule à la dernière minute – mais on peut aussi penser à tous ceux qui n’habitaient pas la capitale et n’ont pas eu la possibilité de s’y rendre). Seul un quart des Afghans qui figuraient sur la liste rédigée au Quai d’Orsay ont été évacués[1]).
C’est oublier aussi ceux dont les noms ne figuraient pas sur les listes, malgré leurs nombreux rapports avec les étrangers. Oubliés sur le moment parce qu’ils avaient des tâches moins visibles ou des rapports moins fréquents avec leurs collègues expatriés, ou ont été victimes du manque de temps nécessaire au traitement de toutes les demandes d’évacuation. De nombreux officiels interviewés par les médias ont ouvertement regretté l’impossibilité d’évacuer tous leurs collaborateurs en dépit des risques qu’ils encourent. Avoir collaboré avec les étrangers les expose désormais à des rétorsions, voire à des formes d’exclusion politique ; en outre, les salaires relativement élevés qu’ils ont perçus en font des victimes idéales de vol ou d’extorsion de la part des combattants taliban.
Sont aussi restés à terre tous ceux qui ne figuraient pas sur les listes car ils n’avaient pas de liens particuliers avec les étrangers, soit la grande majorité des individus. Des milliers d’entre eux se sont rendus à l’aéroport malgré le risque d’attentats et de mouvements de foule dangereux, déterminés à partir coûte que coûte. L’aéroport offrait en effet à ce moment-là un espoir ténu de sortie légale par voie aérienne.
Les images les plus relayées montrent ceux qui ont trouvé la mort après s’être agrippé aux ailes des avions, les enfants passés de mains en mains au-dessus de clôtures, les foules incontrôlables, les blessés par les tirs visant à disperser la foule, la dévastation après les deux attaques de l’ISIS. Ces images, filmées depuis l’aéroport de Kaboul, ne doivent pas nous faire oublier que des centaines de milliers d’autres Afghans ont essayé de quitter le pays par voie terrestre, mais sont restés bloqués aux frontières. Et que d’autres encore auraient voulu partir, mais au final n’ont pas pris le risque de se confronter aux dangers que cela impliquait. Pour eux aussi, un visa et un vol direct auraient été un précieux sésame…
Le sésame d’une sortie légale
Je ne défends pas l’idée qu’il aurait fallu ou qu’il faudrait évacuer tout le monde. Ce serait utopiste sur le plan matériel, et contre-productif pour l’avenir du pays. Je soutiens en revanche qu’il est fort trompeur de lier ces images accablantes à la seule conquête de Kaboul par les Taliban et d’en faire les responsables bien commodes du chaos et de la nécessité de partir. Cette lecture m’apparaît très insatisfaisante, car les Afghans ont depuis quarante ans au moins de très bonnes raisons de vouloir quitter leur pays. À cet égard, le retour au pouvoir des Taliban est un des nombreux renversements de régimes qu’a connus le pays, un renversement qui offre par ailleurs certaines conditions de sécurité à travers le pays.
Le drame qui s’est déroulé sous nos yeux pendant deux semaines n’est pas seulement la conséquence du changement de régime à Kaboul, c’est aussi le résultat du manque criant de voies légales d’émigration que les Afghans connaissent depuis longtemps. Cette vague d’aspirations à émigrer qui a suivi le retour à Kaboul des Taliban – les aspirations de ceux qui craignent les rétorsions des Taliban, ou préfèrent voir de loin si le régime tient les promesses faites à la communauté internationale, certes, mais aussi celles d’aspirant-migrants beaucoup plus ordinaires (ceux que les affrontements armés ont privés de perspectives, ou ceux qui cherchent des soins dans les pays voisins, par exemple) – s’est brisée, comme les précédentes, contre le manque de voies légales de sortie.
Le pont aérien a mis à nu le caractère paradoxal et violent de cette situation. Malgré la situation de conflit ouvert que plusieurs régions du pays ont connue jusqu’à il y a quelques mois, malgré le taux de pauvreté du pays (parmi les plus élevés du monde), malgré les courbes démographiques de la population afghane (une population très jeune et en forte expansion), malgré l’intérêt que les grandes puissances ont porté à ce pays au cours des vingt dernières années, malgré l’existence d’innombrables instruments juridiques de protection des droits de l’homme, les possibilités pour les Afghans de quitter légalement l’Afghanistan sont dérisoires. Bilan : l’une des populations pour laquelle la mobilité est cruciale est aussi celle qui dispose du minimum de voies légales pour quitter le pays.
Le tri opéré par l’évacuation apparaît particulièrement discrétionnaire et violent. À mes yeux, il prolonge les filtrages effectués dans le cadre des politiques internationales d’asile des Afghans. Ceux-ci, en effet, opèrent une sélection entre les rares privilégiés qui parviennent à obtenir un statut sécurisant à l’étranger, et tous les autres.
Il s’agit d’abord de l’attribution des permis de séjour dans les pays de la région, par des autorités dont la disponibilité à l’accueil s’est épuisée depuis longtemps : leurs critères de plus en plus sélectifs visent ouvertement à exclure plutôt qu’à protéger. Il s’agit ensuite de l’examen des demandes de réinstallation : seul canal permettant de quitter légalement la région pour se rendre dans un pays occidental, la réinstallation est surtout un mirage, car un nombre très faible d’Afghans en a bénéficié pendant les vingt dernières années (quelques centaines par an).
Il s’agit aussi de la « sélection naturelle » opérée par le voyage illégal : les difficultés du voyage en font une épreuve physique et morale que tout le monde ne peut surmonter. Il s’agit enfin de l’examen des demandes d’asile en Europe, dont la forte variation des taux de reconnaissance d’un pays de l’UE à l’autre montre le caractère fondamentalement aléatoire de la procédure du point de vue des Afghans.
Les effets d’exclusion des formes de tri évoquées, et leurs conséquences pour la survie et la subsistance de ceux qui en sont exclus sont tout à fait comparables à ceux du pont aérien. Cette violence, habituellement moins visible, a été mise au jour de manière dramatique par ces gestes désespérés de centaines d’Afghans souhaitant quitter Kaboul.
À l’Ouest, rien de nouveau
On aurait pu espérer que la conjoncture très particulière d’août dernier induise les décideurs européens à modifier leurs politiques d’asile à l’égard des Afghans. D’abord parce que les Occidentaux sont ouvertement hostiles au nouveau régime que l’OTAN a combattu pendant 20 ans. Ensuite parce que la population concernée – urbaine, déjà proche des Occidentaux – est connue, fait moins peur, peut susciter l’empathie. Enfin, la nouvelle conjoncture géopolitique rend les Occidentaux plus sensibles au sort d’une population à laquelle ils se sont avérés incapables de tenir leurs promesses. Et puis le pont aérien n’a-t-il pas montré que, lorsque la volonté politique est là, la souplesse et l’inventivité peuvent remédier au manque criant de possibilités légales de mobilité ?
Et pourtant, les mesures adoptées par les décideurs européens semblent pour le moment indiquer un retour au statu quo. La solidarité affichée lors du pont aérien semble n’avoir été qu’une touche de politiquement correct pour sauver les apparences. Certes, certains pays ont suspendu les expulsions vers l’Afghanistan, et d’autres ont annoncé une augmentation des places pour la réinstallation des Afghans. Mais ces mesures ne changent pas la donne, et la réaction des décideurs européens reste dominée par la peur : en dépit du fait que les départs à venir soient vraisemblablement ceux d’une population urbaine, instruite, proche, ciblée par un régime que nos pays ont combattu pendant 15 ans, c’est la peur de voir affluer plus de demandeurs d’asile afghans qui prévaut.
Ainsi, l’objectif affiché des pays de l’UE est d’« empêcher que des mouvements migratoires illégaux incontrôlés et à grande échelle, tels que nous en avons connu par le passé, ne se reproduisent[2]. » Les moyens pour l’atteindre ? Un nouveau tour de vis au verrouillage des frontières et des politiques d’endiguement des flux encore plus agressives[3]. Autrement dit, la duplicité de la politique européenne en matière d’asile reste la même : d’un côté la promesse d’examiner scrupuleusement toute demande d’asile, de l’autre celle de tout faire pour bloquer l’entrée sur le territoire, au nom de la « lutte contre l’immigration illégale ». Pour demander l’asile en Europe, il faut survivre deux fois.
La crise de 2015 a pourtant montré les limites des politiques d’asile des pays de l’UE, mais les décideurs persistent à apporter les mêmes réponses qu’il y a six ans. Les événements de 2015 l’avaient bien montré : la « crise » n’était pas la conséquence d’une augmentation des demandeurs d’asile mais une crise des politiques d’asile européennes.
On a assisté par exemple à l’explosion des tensions entre les pays internes et les pays frontaliers de l’UE, auxquels les premiers entendaient sous-traiter la surveillance des frontières et l’accueil des réfugiés. Pour contenir l’arrivée des demandeurs d’asile, l’UE a dû payer le prix fort : sa dépendance vis-à-vis du régime Erdogan, un durcissement des clivages en son sein, entre États et au sein même des États, du fait de nouvelles formes de contestation des politiques restrictives – un des phénomènes sur lesquels nous travaillons dans le cadre du projet ANR PACE. Le prix s’est aussi envolé pour les demandeurs d’asile eux-mêmes, avec un passage dans l’UE toujours plus sélectif, plus cher et plus dangereux, des réseaux de passeurs plus professionnalisés. Morale de l’histoire ? Les décideurs mobilisent l’exemple de 2015 pour… maintenir la même approche !
Dans la région, une mobilité de plus en plus ardue
Les flux régionaux sont historiquement anciens et très importants. Au cours du conflit, la population afghane s’est redéployée à l’échelle régionale, avec une présence particulièrement importante en Iran et au Pakistan voisins, où la population actuelle estimée d’Afghans avoisine deux à trois millions dans chaque pays. La migration vers l’Europe est minoritaire et plus récente. Elle date notamment du début des années 2000, lorsque les autorités iraniennes et pakistanaises ont durci leurs politiques vis-à-vis des Afghans (en justifiant ce tournant, entre autres, par le lancement du projet international de reconstruction en Afghanistan).
En août dernier, alors que l’attention médiatique était concentrée sur le pont aérien, plusieurs milliers d’Afghans tentaient de quitter le pays par voie terrestre. Les données disponibles indiquent que la plupart des frontières avaient été fermées. Aux longues queues aux postes de frontières, s’ajoutent ainsi la création d’une zone tampon à la frontière pakistanaise et des camps en territoire iranien.
Cette situation est inédite. Jusqu’au début des années 2000, en effet, la mobilité des Afghans dans la région était assez aisée. La frontière afghano-pakistanaise, notamment – quelques 2 000 km à travers des zones montagneuse et désertiques, en terre pachtoune – était très poreuse, les États n’ayant ni les moyens ni parfois l’autorité nécessaires pour la contrôler. Cette possibilité de se déplacer assez librement a permis à plusieurs millions d’Afghans de faire face à la pauvreté et à la guerre pendant des décennies.
Comment en est-on arrivé là ? D’abord, les pays voisins de l’Afghanistan ne souhaitent pas s’opposer aux Taliban en accueillant ouvertement leurs opposants. Ensuite, face à une Europe qui verrouille ses frontières tout en s’affichant comme chantre des droits de l’homme, pourquoi devraient-ils faire mieux ? Mais un processus de fond est à l’œuvre.
Mon travail de recherche m’a permis de mesurer à quel point les possibilités de se déplacer dans la région se sont considérablement réduites au cours des vingt dernières années. Non seulement en raison de la dégradation des conditions de séjour dans les pays voisins, mais aussi à cause de l’augmentation de leur capacité de contrôle des Afghans. Les politiques internationales vis-à-vis des réfugiés afghans n’avaient pas cet objectif mais elles ont renforcé ce phénomène, pour différentes raisons : la confiance inébranlable (même si, aujourd’hui on le sait, mal placée) dans le projet de reconstruction, la vision sédentaire de l’ordre mondial, l’idée selon laquelle l’appartenance nationale détermine notre lieu de résidence « naturel » dans le monde, ou encore l’idée que l’informalité constitue un problème, une entrave à la modernité.
La mobilité, autrefois largement informelle, s’est ainsi retrouvée saisie par un ensemble de dispositifs visant à rendre visible la présence des Afghans dans les pays voisins et leurs déplacements à travers la région. Des recensements ont été organisés et des millions de documents d’identification ont été délivrés. Les gardes-frontières ont aussi été formés, pour « apprendre » à gérer une frontière internationale. C’était compter sans les priorités des autorités pakistanaises et iraniennes : non pas mieux accueillir les Afghans, mais réduire leur présence ou l’instrumentaliser à des fins politiques (montrer une influence en Afghanistan) ou économiques (créer un réservoir de main d’œuvre exploitable).
Ces politiques de régularisation ont ainsi favorisé l’insertion des Afghans dans des dispositifs de contrôle qui n’existaient pas avant. Sur le temps long, elles ont conduit à ce que j’appelle l’emplacement des Afghans en Afghanistan. À côté d’un retour et d’une réintégration promus comme solutions définitives, les mobilités sont rendues plus difficiles, voire illégales. Les politiques de régularisation ont ainsi entrainé l’illégalisation des mobilités : faute de moyens légaux de se déplacer, toute sortie peut désormais être considérée et sanctionnée comme illégale.
À ce jour, aucun changement majeur ne point à l’horizon : l’emplacement des Afghans en Afghanistan et l’illégalisation de leurs mobilités restent les effets incontestés des politiques actuelles. Visiblement ni les médias, ni les universitaires, ni les ONG, ni le retour au pouvoir des Taliban ne parviennent à mettre les décideurs européens face aux paradoxes de leurs politiques d’asile. L’échec du projet international de reconstruction incitera-t-il les milliers de fonctionnaires qui ont travaillé en Afghanistan au cours des vingt dernières années, croyant sincèrement offrir aux Afghans un pays meilleur, à confronter leurs institutions à ces paradoxes ?
