La formation professionnelle peut-elle aider à atteindre le plein emploi ?
Durant son allocution du 9 novembre dernier, le président de la République a déclaré « viser […] le plein emploi » d’ici la fin de sa mandature. Alors que le chômage de masse caractérise la situation française depuis plusieurs décennies, le pari apparaît pour le moins risqué. Il s’agirait en fait de ramener de 9,5 % à 7 % le taux de chômage en France d’ici le printemps 2022.
Parmi les mesures mobilisées pour y parvenir, Emmanuel Macron pensait sans doute à la formation d’un million et demi de demandeurs d’emploi et de jeunes annoncée par son Premier ministre le 27 septembre dernier. Jean Castex, accompagné d’Élisabeth Borne, avait en effet présenté à cette date le nouveau plan « d’investissement dans les compétences et de réduction des métiers en tension ». Ce plan sera-t-il en mesure de répondre aux ambitions présidentielles ?
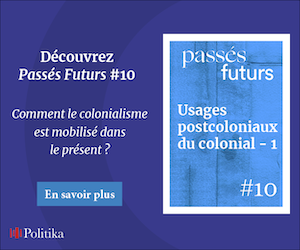
Pour tenter de répondre à cette question, le mieux est sans doute de se reporter aux propos du Premier ministre lui-même. Après la séquence habituelle d’auto-satisfaction à propos de la politique qu’il mène dans le sillage de celle de son prédécesseur en matière d’emploi et de formation professionnelle, Jean Castex a présenté les mesures censées répondre aux difficultés de recrutement que rencontre actuellement le pays. Deux objectifs ont été annoncés.
Le premier vise à répondre aux besoins de recrutement dans des secteurs traditionnellement déficitaires en main d’œuvre comme le commerce, les transports routiers, le bâtiment, la santé et l’aide à la personne, en mobilisant davantage les mesures présentes dans la loi de septembre 2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».
Le second se propose de simplifier le dispositif de « Transitions Collectives » (TransCo) qui, depuis début 2021, vise (par la formation) à favoriser la reconversion des salariés (dont les emplois sont menacés) vers des métiers qui recrutent[1] localement. Selon le Premier ministre, ce dispositif manquerait de visibilité et d’attrait, notamment po
