Guerre et climat : le péril de la nostalgie toxique
Vladimir Poutine serait animé par la nostalgie de l’empire – ça et le désir de surmonter la honte de la brutale thérapie de choc économique imposée à la Russie à la fin de la guerre froide. La nostalgie de la « grandeur » américaine constitue un des moteurs du mouvement que dirige toujours Donald Trump – ça et le désir de surmonter la honte face à la vilenie de la suprématie blanche qui a participé à la fondation des États-Unis et continue de les meurtrir. C’est aussi la nostalgie qui anime les camionneurs canadiens qui ont occupé Ottawa près d’un mois durant, brandissant leurs drapeaux rouge et blanc comme une armée conquérante, convoquant une époque plus simple où des corps d’enfants indigènes ne venaient pas troubler leur conscience, enfants dont on découvre encore les dépouilles sur les sites de ces institutions génocidaires qui osaient autrefois s’appeler « écoles ».
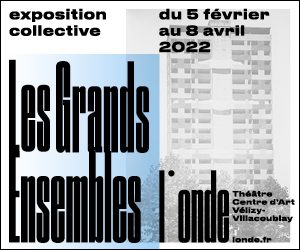
Il n’est pas question ici de la douce et sympathique nostalgie des plaisirs de l’enfance dont on se souvient confusément, mais d’une nostalgie enragée et destructrice qui s’accroche à de faux souvenirs de gloires passées et ce en dépit des preuves de leur inexactitude.
Tous ces mouvements et personnages nostalgiques ont en commun la quête d’une même et unique chose, d’une époque où l’on pouvait extraire les énergies fossiles de la terre sans avoir à se soucier ni de l’extinction massive, ni des enfants qui revendiquent leur droit à un avenir, ni des rapports du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), comme celui publié le 28 février 2022, qualifié par le secrétaire général de l’ONU António Guterres, d’« atlas de la souffrance humaine et une accusation accablante de l’échec du leadership climatique ».
Poutine, bien sûr, dirige un pétro-État, un État qui a refusé obstinément de diversifier sa dépendance économique vis-à-vis du pétrole et du gaz, malgré non seulement l’effet dévastateur des fluctuations en dents de scie de la valeur de ces matières premières pour sa population, mais aussi la réalité du changement climatique. Trump est obsédé par l’argent facile qu’offrent les énergies fossiles et, en tant que président, a fait du déni climatique sa politique phare.
Les camionneurs canadiens, pour leur part, ont choisi comme symboles pour leur mouvement les poids lourds de 18 roues tournant au ralenti et les jerricans omniprésents ; en outre, les dirigeants du mouvement ont également d’étroits liens avec le pétrole sale des sables bitumineux de l’Alberta. Avant même le fameux « convoi de la liberté », beaucoup des acteurs de ce mouvement avaient déjà organisé, en 2019, une sorte de répétition générale : le « United We Roll », un convoi à la fois pro-pipeline, anti-tarification du carbone, anti-immigrés et explicitement nostalgique d’un Canada blanc et chrétien.
Même si les pétrodollars sont le dénominateur commun de tous ces protagonistes et mouvements de force, il est essentiel de comprendre que le pétrole incarne une vision du monde plus large, une forme de cosmogonie profondément liée à la « destinée manifeste » et à la « Doctrine de la découverte », qui classait la vie humaine et non humaine dans une hiérarchie rigide, avec au sommet l’homme blanc et chrétien. Dans ce contexte, le pétrole symbolise la mentalité extractiviste : c’est-à-dire non seulement le droit divin de continuer à extraire les énergies fossiles, mais aussi celui de continuer à prendre à sa guise, à laisser du poison derrière soi et à ne jamais regarder en arrière.
C’est pourquoi la crise climatique en rapide évolution ne représente pas seulement une menace économique pour les personnes engagées dans les secteurs extractifs, mais aussi une menace existentielle pour les personnes attachées à cette vision du monde. Car le changement climatique, c’est la Terre qui nous dit que rien n’est gratuit, que l’ère de la « domination » humaine (blanche et masculine) est révolue, qu’il n’existe pas de relation à sens unique qui consisterait à uniquement prendre, que toute action engendre une réaction. Tous ces siècles de forage et de rejets libèrent des forces qui aujourd’hui révèlent la vulnérabilité et la fragilité des structures, même les plus solides créées par les sociétés industrielles – les villes côtières, les autoroutes, les plateformes pétrolières. Et, dans l’esprit d’un extractiviste, ce constat est impossible à accepter.
De nombreux porte-drapeaux progressistes sont également des figures profondément nostalgiques, qui n’offrent comme antidote à la montée du fascisme qu’un néolibéralisme réchauffé.
Étant donné leur vision du monde commune, il ne faut pas s’étonner que Poutine, Trump et les « convois de la liberté » se rejoignent par-delà leurs dissemblances géographiques et circonstancielles. Trump a fait l’éloge du « mouvement pacifique des camionneurs, travailleurs et familles patriotes qui manifestent pour leurs libertés et droits les plus fondamentaux » ; Tucker Carlson et Steve Bannon applaudissent Poutine tandis que les camionneurs arborent leurs casquettes MAGA (Make America Great Again) ; Randy Hillier, député de l’Assemblée législative de l’Ontario et l’un des plus fervents partisans du « Convoi de la liberté », a récemment déclaré sur Twitter que « beaucoup plus de gens sont et seront tués par cette piqûre [le vaccin contre le Covid] que dans la guerre russo-ukrainienne ». Et que dire de ce restaurant ontarien qui, la semaine dernière, a inscrit sur son ardoise des plats du jour que « la Russie n’occupe pas l’Ukraine » et que Poutine s’oppose à la « grande réinitialisation », aux satanistes, et « lutte contre l’asservissement de l’humanité ».
Au premier abord, ces alliances nous semblent profondément étranges et improbables. Mais à y regarder de plus près, on voit clairement un dénominateur commun : une certaine attitude à l’égard du temps marquée par une farouche volonté de s’accrocher à une version idéalisée du passé et le refus catégorique d’affronter les dures vérités qui se profilent. Les trois partagent également le goût pour la force brute : le poids lourd versus le piéton, la tonitruante réalité fabriquée de toute pièce versus le prudent rapport scientifique, l’arsenal nucléaire versus le fusil mitrailleur. C’est cette énergie-là qui déferle en ce moment dans des sphères très différentes, qui déclenche des guerres, qui attaque les sièges des gouvernements et qui toise et déstabilise les systèmes de survie de notre planète.
C’est cet éthos-là qui est à l’origine de tant de crises démocratiques, géopolitiques et de la crise climatique : un attachement violent à un passé toxique et un refus de faire face à un avenir plus enchevêtré et interdépendant, un avenir qui sera défini par le respect de certaines limites : ce que les humains peuvent prendre à la Terre et ce que cette dernière peut supporter. C’est l’expression pure et simple de ce que la regrettée bell hooks décrivait souvent, accompagné d’un clin d’œil taquin, comme le « patriarcat capitaliste impérialiste blanc-suprématiste » – car, oui, parfois, il faut sortir l’artillerie lourde pour décrire notre monde avec précision.
La tâche politique la plus urgente, à l’heure actuelle, est d’exercer une pression suffisante sur Poutine pour qu’il considère son invasion criminelle comme une entreprise trop risquée pour être poursuivie. Mais ce n’est que le tout début du commencement. « Nous avons une fenêtre d’opportunité qui se rétrécit » si nous voulons garantir un avenir vivable à la planète, a déclaré Hans-Otto Pörtner, coprésident du groupe de travail du GIEC qui a rédigé le fameux rapport publié cette semaine. Si notre époque a une tâche politique commune, c’est bien celle d’apporter une réponse complète à cette conflagration de nostalgie toxique. Et dans un monde moderne né du génocide et de la dépossession, cela exige d’envisager un avenir fondamentalement inconnu de nous.
Les dirigeants de nos différents pays, à de très rares exceptions près, sont très loin de relever ce défi. Poutine et Trump sont des personnages rétrogrades et nostalgiques, et ils ont beaucoup d’amis du côté de la droite dure. Jair Bolsonaro a été élu en exploitant la nostalgie de l’époque du régime militaire brésilien, et les Philippines, de manière alarmante, sont sur le point d’élire Ferdinand Marcos Jr. comme prochain président, le fils du défunt dictateur qui a pillé et terrorisé sa nation pendant la majeure partie des années 1970 et 1980. Mais il ne s’agit pas seulement d’une crise de la droite.
De nombreux porte-drapeaux progressistes sont également des figures profondément nostalgiques, qui n’offrent comme antidote à la montée du fascisme qu’un néolibéralisme réchauffé, ouvertement allié aux intérêts privés prédateurs – de Big Pharma aux grandes banques – qui ont contribué à laminer les conditions de vie. Joe Biden a été élu sur la promesse réconfortante d’un retour à la normale, à l’avant-Trump, oubliant que c’est sur ce même terreau que le trumpisme a prospéré. Justin Trudeau n’est qu’une version plus jeune de la même impulsion : attaché à « l’économie de l’attention », il n’est que l’écho superficiel de son père, feu le Premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau. En 2015, la première déclaration de Trudeau Jr sur la scène mondiale a été « Le Canada est de retour » ; celle de Biden, cinq ans plus tard : « L’Amérique est de retour, prête à diriger le monde. »
Nous ne vaincrons pas les forces de la nostalgie toxique avec ces faibles doses de nostalgie marginalement moins toxique. Il ne suffit pas d’être « de retour » ; nous avons désespérément besoin de nouveauté. La bonne nouvelle c’est que nous savons à quoi ressemble la lutte contre non seulement les forces qui permettent l’agression impériale, le pseudo-populisme de droite, mais aussi le dérèglement climatique. Cela ressemble beaucoup à un New Deal vert, un cadre pour sortir des énergies fossiles en investissant dans des emplois syndiqués capables de faire vivre des familles et qui proposent un travail utile, comme la construction de maisons écologiques abordables et de bonnes écoles, en commençant par les communautés les plus systématiquement abandonnées et victimes de la pollution. Pour cela, il faut abandonner le fantasme de la croissance illimitée et investir dans le care and repair [l’éthique du soin et de la sollicitude couplée à l’attention portée aux choses et aux objets, NdT].
Il va de soi que la pression en faveur de nouveaux projets d’exploitation de combustibles fossiles en Amérique du Nord n’a aucunement pour but d’aider les Ukrainiens ou d’affaiblir Poutine.
Le New Deal vert – ou le New Deal vert, rouge et noir (Red Black & Green New Deal) – est notre meilleur espoir si nous voulons construire une solide coalition multiraciale de la classe ouvrière, fondée sur la recherche d’un terrain d’entente au-delà des clivages. C’est aussi le meilleur moyen de stopper l’afflux de pétrodollars vers des gens comme Poutine, puisque une économie verte qui a vaincu la dépendance à la croissance sans fin n’a besoin ni de pétrole ni de gaz importé. Et c’est aussi le meilleur moyen de couper l’oxygène au pseudo-populisme des Trump/Carlson/Bannon, dont les bases ne cessent de s’étendre du fait qu’ils sont bien plus doués pour exploiter la rage contre les élites de Davos que ne le sont les Démocrates, dont les dirigeants, pour la plupart, sont justement ces élites.
L’invasion de la Russie souligne l’urgence de ce type de transformation verte, mais elle soulève également de nouveaux défis. Avant même que les chars russes ne se mettent en marche, nous entendions déjà dire que la meilleure façon de stopper l’agression de Poutine était d’augmenter la production des énergies fossiles en Amérique du Nord. Dans les heures qui ont suivi l’invasion, chacun des projets de destruction de la planète que le mouvement pour la justice climatique avait réussi à bloquer au cours des dix dernières années a été frénétiquement remis sur la table par les hommes politiques de droite et les spécialistes pro-industrie : chaque pipeline de pétrole annulé, chaque terminal d’exportation de gaz refusé, chaque site de fracking protégé, chaque rêve de forage dans l’Arctique. Puisque la machine de guerre de Poutine est financée par les pétrodollars, la solution, nous dit-on, est de forer, de faire du fracking et d’expédier davantage de notre propre pétrole.
Tout cela n’est qu’une mascarade capitaliste désastreuse du genre auquel j’ai déjà consacré de trop nombreux articles. En premier lieu, la Chine continuera d’acheter du pétrole russe, quoi qu’il arrive dans les schistes de Marcellus ou les sables bitumineux de l’Alberta. Ensuite, les calendriers sont chimériques. En matière d’énergies fossiles, l’investissement à court terme n’existe pas. Chacun des projets présentés comme une solution à la dépendance aux énergies fossiles russes mettrait des années à avoir un impact ; de plus, pour que leurs coûts non récupérables aient du sens sur le plan financier, il faudrait que les projets demeurent opérationnels pendant des décennies, et ce au mépris des avertissements de plus en plus désespérés que nous adresse la communauté scientifique.
Mais il va de soi que la pression en faveur de nouveaux projets d’exploitation de combustibles fossiles en Amérique du Nord n’a aucunement pour but d’aider les Ukrainiens ou d’affaiblir Poutine. La véritable raison derrière le dépoussiérage de toutes ces vieilles chimères est bien plus grossière : cette guerre les a rendues, du jour au lendemain, beaucoup plus rentables. Dans la semaine où la Russie a envahi l’Ukraine, la référence pétrolière européenne, le Brent brut, a atteint 105 dollars le baril, un prix inégalé depuis 2014, et il continue d’osciller au-dessus des 100 dollars (soit le double de ce qu’il était fin 2020). Les banques et les entreprises du secteur de l’énergie cherchent désespérément à tirer le meilleur parti de cette remontée des prix, au Texas, en Pennsylvanie et dans Alberta.
Aussi sûrement que Poutine est déterminé à remanier la carte de l’Europe de l’Est de l’après-guerre froide, ce jeu de pouvoir dans le secteur des énergies fossiles pourrait redessiner la carte énergétique. Le mouvement pour la justice climatique a remporté des batailles très importantes au cours des dix dernières années. Il a réussi à interdire le fracking dans des provinces, des pays, des États entiers ; d’énormes pipelines comme Keystone XL ont été bloqués, de même que de nombreux terminaux d’exportation et plusieurs forages dans l’Arctique. Les leaders des peuples autochtones ont joué un rôle central dans presque tous les combats. Et, fait remarquable, à la date de cette semaine, 40 000 milliards de dollars de fonds de dotation et de fonds de pension de plus de 1 500 institutions se sont engagés à une forme ou une autre de désinvestissement des combustibles fossiles, et ce grâce à une campagne de désinvestissement menée avec acharnement depuis dix ans.
Mais voici un secret que souvent nos mouvements gardent, y compris vis-à-vis de leurs rangs : depuis l’effondrement du prix du pétrole en 2015, nous combattons en réalité une industrie qui a une main attachée dans le dos. En effet, le pétrole et le gaz moins chers et plus faciles d’accès sont pour la plupart épuisés en Amérique du Nord, de sorte que les batailles rangées autour de nouveaux projets ont principalement porté sur des sources non conventionnelles, plus coûteuses à extraire : les combustibles fossiles piégés dans la roche de schiste, ou dans les grands fonds marins, ou sous la glace de l’Arctique, ou encore dans la boue semi-solide des sables bitumineux de l’Alberta.
Bon nombre de ces nouvelles zones d’exploitation n’étaient devenues rentables qu’après l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003, qui avait fait flamber les prix du pétrole. Soudain, il devenait logique d’un point de vue économique de faire ces investissements de plusieurs milliards de dollars pour extraire le pétrole des profondeurs de l’océan ou pour transformer le bitume boueux de l’Alberta en pétrole raffiné. Le Financial Times n’hésita pas à décrire la frénésie des sables bitumineux comme « le plus grand boom en matière de ressources en Amérique du Nord depuis la ruée vers l’or du Klondike ».
Or, l’effondrement du prix du pétrole en 2015 a fait vaciller la détermination de l’industrie à poursuivre sa croissance à un rythme aussi effréné. Le fait que certains investisseurs ne soient plus sûrs de récupérer leur argent devait conduire des majors à se retirer de l’Arctique et des sables bitumineux. Face à la baisse des bénéfices et du cours des actions, les organisateurs du désinvestissement ont soudain pu faire valoir que les titres liés aux énergies fossiles n’étaient pas seulement immoraux, mais constituaient un mauvais investissement, même selon les critères du capitalisme. Et maintenant, disons que les agissements de Poutine ont détaché la main dans le dos de Big Oil et l’ont transformée en poing.
C’est ce qui explique la récente vague d’attaques contre non seulement le mouvement pour le climat mais aussi la poignée d’hommes et de femmes politiques démocrates qui ont fait avancer l’action climatique scientifiquement fondée. Le représentant Tom Reed, un républicain de New York, a déclaré il y a quelques jours : « Les États-Unis ont suffisamment de ressources énergétiques pour éliminer totalement la Russie du marché du pétrole et du gaz, mais nous n’utilisons pas ces ressources à cause de la soumission partisane du président Biden aux extrémistes environnementaux du parti démocrate. »
C’est précisément le contraire qui est vrai. Si les gouvernements, dont beaucoup ont mené, au cours des quinze dernières années, des politiques prometteuses de type New Deal vert, avaient réellement mis en œuvre ces dernières, Poutine, convaincu qu’il aura toujours des clients pour ses hydrocarbures de plus en plus rentables, ne serait pas en mesure de bafouer le droit et l’opinion internationaux comme il le fait de manière si flagrante. La crise sous-jacente à laquelle nous sommes confrontés n’est pas due à l’incapacité des pays d’Amérique du Nord et d’Europe de l’Ouest d’exploiter leurs énergies fossiles afin de se passer du pétrole et du gaz russes ; non, elle est due au fait que nous tous, États-Unis, Canada, Allemagne, Japon, continuons de consommer des quantités obscènes et intenables de pétrole et de gaz, d’énergie en somme – un point c’est tout.
Et si de l’argent public peut être alloué en un clin d’œil à la construction de terminaux gaziers, peut-être n’est-il pas trop tard pour se battre pour plus de solaire et d’éolien.
Nous connaissons la solution pour sortir de cette crise : le développement d’une infrastructure pour les énergies renouvelables, l’alimentation des foyers en énergie éolienne et solaire, l’électrification de nos réseaux de transport. Et parce que toutes les sources d’énergie ont un coût écologique, nous devons également réduire notre consommation d’énergie en général, en améliorant l’efficacité, en développant les transports en commun et en réduisant une surconsommation génératrice de déchets. Cela fait des dizaines d’années que le mouvement pour la justice climatique ne dit rien d’autre. Le problème n’est pas que les élites politiques ont passé trop de temps à écouter les soi-disant extrémistes environnementaux, mais qu’elles ne nous ont, pour ainsi dire, pas écoutés du tout.
Nous nous trouvons à présent dans un drôle de moment, où il semblerait qu’une belle affaire soit à saisir. La société BP a annoncé le 27 janvier qu’elle allait vendre sa participation de 20 % dans le géant pétrolier russe Rosneft, et d’autres suivent son exemple. C’est potentiellement une bonne nouvelle pour l’Ukraine, car la pression exercée sur ce secteur des plus critiques attirera assurément l’attention de Poutine. Cependant, il faut également préciser que si cela se produit, c’est probablement uniquement parce que BP a l’intention de profiter pleinement de la frénésie pétrolière et gazière déclenchée par la hausse des prix en Amérique du Nord et ailleurs. « BP reste confiante dans la flexibilité et la résilience de son cadre financier », indiquait le communiqué de presse annonçant la décision, soucieux de rassurer les observateurs du marché.
Il est également significatif que la nouvelle de BP soit tombée quelques heures après que le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé que son pays allait construire deux nouveaux terminaux d’importation pour recevoir des cargaisons de gaz naturel, verrouillant encore davantage la dépendance aux combustibles fossiles en pleine urgence climatique. Alors que les écologistes allemands s’opposent depuis longtemps à la construction de ces terminaux, ces derniers sont, aujourd’hui, sous couvert de la guerre, présentés comme l’unique moyen de compenser le gaz dont Scholz avait récemment annoncé qu’il ne transiterait pas par Nord Stream 2, le nouveau gazoduc qui passe sous la mer Baltique – décision qui avait transformé une infrastructure ultramoderne dédiée aux énergies fossiles en un « trou de 11 milliards de dollars dans le sol », selon les termes du chef du bureau européen du Globe and Mail, Eric Reguly.
Mais les projets de combustibles fossiles ne sont pas les seuls que l’on tue et ressuscite. « Nous redoublons d’efforts en matière d’énergies renouvelables, a annoncé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, quelques jours avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cela renforcera l’indépendance stratégique de l’Europe dans le domaine de l’énergie. »
En voyant ces pièces d’échecs géopolitiques voler en éclats sur l’échiquier en l’espace de quelques jours, ainsi que la dernière vague de sanctions spectaculaires contre les banques et le transport aérien russes, les raisons d’être inquiets sont nombreuses, y compris le constat de la réitération de mesures punissant les pauvres pour les crimes des riches. Mais il y a aussi des lueurs d’optimisme. Ce qui est encourageant, ce n’est pas tant la substance des mesures prises individuellement que leur rapidité et leur fermeté. Tout comme lors des premiers mois de la pandémie, la réaction à l’invasion de la Russie devrait nous rappeler que, malgré la complexité de nos systèmes financiers et énergétiques, il s’avère que ceux-ci restent transformables grâce à des décisions prises par de simples mortels.
Cela vaut la peine de s’arrêter sur certaines des implications. Si l’Allemagne peut abandonner un oléoduc de 11 milliards de dollars parce que subitement considéré comme immoral (il l’a toujours été), alors toutes les infrastructures liées aux énergies fossiles qui violent notre droit à un climat stable devraient également être sujettes à débat. Si BP peut renoncer à une participation de 20 % dans Rosneft, y a-t-il un investissement qui ne puisse être abandonné dès lors qu’il participe à détruire une planète habitable ? Et si de l’argent public peut être alloué en un clin d’œil à la construction de terminaux gaziers, peut-être n’est-il pas trop tard pour se battre pour plus de solaire et d’éolien.
Si nous bâtissons une nouvelle infrastructure énergétique – et nous le devons –, alors celle-ci doit s’inscrire dans le futur et non pas dans toujours plus de nostalgie toxique.
Comme l’a écrit la semaine dernière Bill McKibben dans son excellente newsletter, Biden pourrait contribuer à cette transformation – en usant de pouvoirs disponibles uniquement en cas d’urgence – en invoquant le Defense Production Act afin de produire un grand nombre de pompes à chaleur électriques et les expédier en Europe dans le but d’atténuer les effets pénibles de la privation de gaz russe. Voilà le genre de démarche imaginative dont nous avons besoin en ce moment. Car si nous bâtissons une nouvelle infrastructure énergétique – et nous le devons –, alors assurément celle-ci doit s’inscrire dans le futur et non pas dans toujours plus de nostalgie toxique.
De nombreuses leçons doivent être tirées de ce moment particulièrement angoissant que nous vivons – des leçons concernant : les dangers d’une prolifération non contrôlée des armes nucléaires ; le manque de perspicacité qui consiste à humilier d’anciennes grandes puissances ; le deux poids, deux mesures grotesque pratiqué par les médias occidentaux quant aux terres et vies considérées comme pouvant être envahies et sacrifiées. Des leçons concernant : quelles migrations forcées sont traitées comme des crises pour les personnes qui se déplacent, et lesquelles sont traitées comme des crises pour les pays vers lesquels ces personnes se déplacent ; la détermination avec laquelle des gens ordinaires se battent pour leur pays – sans oublier la question de savoir quels combats pour l’autodétermination et l’intégrité territoriale sont célébrés comme héroïques, et quels semblables combats sont considérés comme terroristes. Ce sont-là quelques-unes des leçons que nous devons tirer de ce moment d’histoire brute. Sans oublier celle-ci : nous sommes encore capables de changer le monde que nous avons construit lorsque la vie est en jeu, et de le faire rapidement et de manière spectaculaire. Comme il y a deux ans, lorsque la pandémie a été déclarée, nous vivons un moment terrifiant mais hautement malléable.
La guerre refaçonne notre monde, mais l’urgence climatique aussi. La question est la suivante : saurons-nous mobiliser le même degré d’urgence et de prises d’initiatives qu’en temps de guerre pour catalyser l’action climatique, et ce afin de garantir notre sécurité à tous pour les décennies à venir, ou laisserons-nous la guerre jeter plus d’huile encore sur une planète déjà en feu ? L’enjeu a été mis en évidence récemment par Svitlana Krakovska, une scientifique ukrainienne qui fait partie du groupe de travail du GIEC, auteur du rapport publié cette semaine. Alors même que son pays subissait les attaques du Kremlin, elle aurait déclaré, lors d’une réunion virtuelle, à ses collègues scientifiques que « le changement climatique d’origine humaine et la guerre contre l’Ukraine ont les mêmes racines, les énergies fossiles et notre dépendance à leur égard ».
Les outrages de la Russie en Ukraine devraient nous rappeler que l’influence corruptrice du pétrole et du gaz est à l’origine de pratiquement toutes les forces qui déstabilisent notre planète. La suffisance de Poutine ? Merci le pétrole, le gaz et les armes nucléaires. Les camions qui ont envahi Ottawa un mois durant, harcelant les résidents, remplissant l’air de leurs émanations et inspirant de semblables convois dans le monde entier ? Une des chefs de file de l’occupation s’est présentée au tribunal il y a quelques jours vêtue d’un sweat-shirt « I ♥ Oil and Gas ». Elle sait très bien qui sont ses sponsors. Le négationnisme covidien et la montée en puissance de la culture du complot ? Eh bien, une fois que vous avez nié le dérèglement climatique, nier les pandémies, les élections, ou à peu près toute forme de réalité objective, est un jeu d’enfant.
À ce stade avancé du débat, la plupart de tout ceci est bien compris. Le mouvement pour la justice climatique a remporté tous les arguments en faveur d’une action transformationnelle. Ce que nous risquons de perdre, dans le brouillard de la guerre, c’est notre sang-froid. Car rien ne transforme le sujet comme la violence extrême, même celle activement subventionnée par la flambée du prix du pétrole.
Pour éviter que cela n’advienne, il y aurait pire à faire que de s’inspirer de Krakovska, laquelle aurait déclaré à ses collègues du GIEC, lors de cette même réunion à huis clos : « Nous ne capitulerons pas en Ukraine. Et nous espérons que le monde ne capitulera pas dans la construction d’un avenir résilient au changement climatique. » Selon des témoins oculaires, ce propos a tellement ému un homologue russe qu’il a rompu les rangs et présenté des excuses pour les actions de son gouvernement – un bref aperçu d’un monde tourné vers l’avenir, et non vers le passé.
Traduit de l’anglais par Hélène Borraz
NDLR : Ce texte a été publié dans notre collection « Les Imprimés d’AOC », disponible en librairie.
