L’avènement d’une opinion publique écologique
Emmanuel Macron fera-t-il de la France « une grande nation écologique », comme il s’y est engagé ? Si c’est le cas, ce sera parce qu’il est contraint par une autre politique que la politique « d’en haut » : celle qui vient des citoyens « ordinaires », des expériences « locales », de la « France d’en bas »[1]. Depuis quelque temps émerge dans les médias et les discours politiques de nos représentants l’importance de cette autre politique. La rhétorique fluctue suivant les partis : Marine Pen « écoute » le « Peuple français », Jean-Luc Mélenchon le « peuple », Emmanuel Macron les « compatriotes », d’autres les citoyennes et citoyens, signalant au passage beaucoup d’impensés et des visions contrastées de l’union sociale de base.
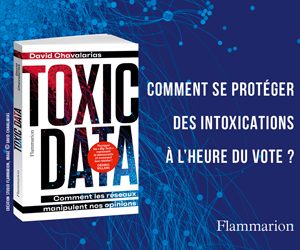
Mais l’idée maîtresse demeure : face à la politique « politicienne » dont le vacarme est étourdissant, il existerait une autre politique, celle dont les personnes directement impliquées, concernées, engagées, seraient les initiatrices et les chefs d’orchestre, quels que soient le type de leur existence et la portée de leurs actions, et qui, au bout du compte, conditionnerait leur conduite électorale.
Cette autre politique serait certes plus discrète, « à bas bruit », audible pour les seules oreilles attentives, plus dispersée et pour cette raison moins puissante que celle s’appuyant sur des institutions bien solides et centralisées mais, tout bien considéré, digne d’attention et, peut-être même, source du renouvellement dont la démocratie libérale a un besoin structurel, puisque comme le disait le philosophe américain John Dewey, cette dernière doit être pensée comme « une tâche à accomplir » qui ne sera jamais achevée.
Ce changement d’attitude est une bonne nouvelle. Mais ne faudrait-il pas aller plus loin et inverser le rapport de force entre l’opinion et les dirigeants ? C’est ce que je propose de faire, en prenant à partie d’abord les apports de nos fondateurs, puis les liens actuels entre démocratie et écologie, qui me semblent exemplaires en la matière.
Plus l’opinion est consciente de sa force potentielle, moins elle abandonne son pouvoir à quelque autorité que ce soit, et plus le régime est démocratique.
En embrassant sur le tard la question écologique, les candidats à la présidence de la France n’ont témoigné d’aucune initiative originale ni d’aucun courage. Ils ont pris le train de l’opinion qui s’était mis en route il y a longtemps et dont le nombre de wagons a tellement augmenté qu’il est devenu inévitable de le croiser.
Le relativement bon score au premier tour par Jean-Luc Mélenchon, dont la fin de campagne a été axée sur les interactions entre questions écologiques et questions sociales, a rendu plus manifestes les progrès de la conscience écologique et de l’éthique environnementale qui se sont développés dans notre pays ou ailleurs, parfois bien loin du pouvoir central et de la politique des gouvernements en place.
Je voudrais avancer l’hypothèse qu’en infléchissant leurs positions en faveur d’une nouvelle considération portée à la crise climatique, les candidats n’ont fait que suivre la loi universelle qui veut que la virtuosité des dirigeants politiques consiste non à dominer, à faire preuve d’inventivité politique, à créer avec « art » de nouvelles institutions, mais parfois à deviner, à simplement entendre, ce que pensent, veulent, visent les citoyens dans leur majorité et à s’aligner en leur envoyant des signes, ténus ou explicites, de pure et simple allégeance. Pourquoi ?
James Bryce avait démontré que, quel que soit le régime politique dominant, c’est de l’opinion publique qu’il dépend. Cela s’applique aussi bien aux régimes les plus despotiques qu’aux démocraties libérales auxquelles il accordait sa préférence. Si autoritaire ou brutal qu’il soit, aucun régime ne pourrait se maintenir durablement s’il ne jouissait de l’assentiment, tacite ou explicite, de la majorité des sujets ou des citoyens sur lesquels il exerce sa domination.
Davantage, la forme du régime dépend, poursuivait-il, du degré auquel l’opinion prend conscience d’elle-même. Moins elle est consciente de son pouvoir, moins elle est « publique », plus elle laisse faire et abandonne la partie, plus elle sombre, tantôt dans l’indifférence ou le ressentiment, tantôt dans ce sentiment d’impuissance qui nous est si familier aujourd’hui, et plus le régime politique est despotique.
À l’inverse, plus l’opinion est consciente de sa force potentielle, moins elle abandonne son pouvoir à quelque autorité que ce soit, et plus le régime est démocratique. Il faut en conclure ceci : l’opinion publique, qu’il a été longtemps de bon ton de mépriser, tant elle fut associée à la somme des opinions privées, versatiles et irrationnelles, chaotiques et égoïstes, des individus pris un à un, est vraiment ce qui mène le monde. On s’en était affolé dès les années 1890, y dénonçant un « 4e pouvoir » quasi illégitime qu’aucune Constitution n’avait prévu, puis on l’a oubliée.
L’opinion publique est devenue « ce que mesurent les sondages », selon l’expression de Jean Stoetzel qui introduisit, à la suite de Gallup, les sondages d’opinion en France, ce dans quoi on l’a enfermée, omettant ainsi de voir que l’industrie du sondage d’opinion née à la fin des années 1930 avait plus obéi, dans son organisation même, à l’objectif de court-circuiter l’opinion – qui en fait court toujours, qu’on la mesure ou pas – qu’à celui d’enregistrer ses mouvements.
Il faut donc revenir à James Bryce et au bon sens, dont les pères fondateurs des régimes libres (La Boétie, Machiavel, Pascal Paoli, Montesquieu par exemple) étaient imprégnés : ce ne sont pas les gouvernants qui font l’opinion, mais au contraire : c’est l’opinion publique qui fait les gouvernants. Heureusement pour les uns ou malheureusement pour les autres, notre responsabilité individuelle est donc beaucoup plus importante que ce que nous sommes portés à croire.
L’électorat des extrêmes droites est moins un courant d’opinion issu d’interactions, qu’un agrégat de ressentis relativement uniformes malgré la diversité de ceux qui les éprouvent.
Le problème qui se pose en démocratie n’est donc pas de sélectionner tel dirigeant parmi d’autres au cours d’une compétition dont l’enjeu serait la simple conquête du pouvoir. Il est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir un degré de conscience de l’opinion si élevé que le risque que nos institutions s’effondrent et que notre régime soit miné, soit levé.
La course pour le pouvoir n’est pas un jeu superficiel, pas plus que le programme que défendent les candidats n’est un pur et simple artifice, comme le croyait Joseph Schumpeter. Dans ces deux hypothèses se dessine ce que les candidats à la présidence présument être un courant d’opinion dominant tout en ménageant, comme le veut la démocratie libérale, ce qu’ils pensent être la sensibilité des minorités. Pour le meilleur ou pour le pire, si manipulation il y a, ce sont eux qui sont manipulés par une opinion à laquelle ils s’efforcent de ressembler et d’obéir.
On dira peut-être que l’opinion peut délibérément se retourner contre le système démocratique. Après tout, nous voici dans une Ve République bien malmenée, qui fait suite à quatre autres qui sont quant à elles tombées. Mais tout n’est pas égal en la matière. Une distinction essentielle s’impose : le public des composantes anti-démocratiques de la société et celui de la démocratie entendue au sens étroit ou large, comme système de gouvernement ou comme mode de vie, sont de nature fondamentalement différente.
L’opinion agrégée n’est pas l’opinion publique politique. La première est celle d’individus qui ne peuvent ni ne veulent se parler, par crainte, par envie, par méfiance, par indifférence, voire à cause de la haine qu’ils éprouvent les uns pour les autres. Le terreau de l’extrême droite, c’est bien connu, c’est la peur, le déclassement, l’isolement social.
Tocqueville l’avait déjà bien observé : plus les individus se défient les uns des autres, plus ils s’isolent et se replient sur eux, plus ils en viennent à penser et vouloir la même chose, faute de cette fertilisation de l’intelligence et de l’imagination qui vient du commerce que les humains ont entre eux, de leur vie sociale ordinaire, de l’amitié qu’ils se portent, de leurs conversations en face-à-face. Ici et maintenant, en France, on peut dire que l’électorat des extrêmes droites est moins un courant d’opinion issu d’interactions, qu’un agrégat de ressentis relativement uniformes malgré la diversité de ceux qui les éprouvent.
On l’a lu et relu sous la plume des journalistes et des sociologues : cet électorat composé d’individus perpétuellement inquiets, indifférents à la chose publique, en proie à un sentiment d’abandon et d’insécurité face à une probable « submersion migratoire », plongé dans une situation d’« anomie sociale » (selon Daniel Cohen), est à la fois hétéroclite, volatil et dans une certaine mesure perdu.
Dans les situations de dislocation, ajoute alors Tocqueville, il est aisé pour les gouvernants en place d’exercer un pouvoir despotique qui, à son tour, en raison d’un cercle vicieux inévitable, accroîtra la distance entre les gens en semant la zizanie entre eux et en détruisant leurs occasions de s’associer – ce qui commence à notre époque par le contrôle de l’expression des cultures au bénéfice exclusif de La Culture dite nationale.
Ce phénomène qui fut annoncé par Tocqueville correspond, je pense, à ce qu’on appelle « populisme » aujourd’hui : plaire aux masses, lesquelles sont faites de gens isolés, et non considérer les peuples, lesquels sont constitués de gens reliés et associés ; fabriquer des masses en sapant tout ce qui permet aux gens de se rencontrer et miner les publics démocratiques actifs.
Aux antipodes du populisme ainsi conçu, il y a la véritable opinion publique. Dans l’idéal, cette dernière est composée, comme le remarquait le sociologue Charles Wright Mills, d’autant d’opinions qu’il y a de citoyens. Que ceux-ci aient des objectifs communs n’implique pas que tous prennent le même chemin pour les atteindre, au contraire, affirmait Tocqueville : en se rencontrant, en se parlant, en s’associant de mille manières et pour des raisons aussi variées que le sont les activités et les occasions possibles, les individus s’enrichissent mutuellement et se singularisent tout en valorisant ce qui rend possible leurs libertés respectives, à savoir leurs manières d’être les uns vis-à-vis des autres.
La méthode de la démocratie, c’est la méthode de l’expérience, écrivait Dewey, et celle-ci suppose de sortir hors de soi pour aller à la rencontre d’autrui comme du monde extérieur en général.
C’est à cet endroit qu’intervient la conscience environnementale et que se forgent les attitudes écologiques dont dépend notre éventuel futur. La culture écologique est démocratique ; elle passe par la formation d’une véritable opinion publique. Aller vers le dehors, à la rencontre des phénomènes hors de nous, dont nous reconnaissons l’altérité et l’indépendance, c’est prendre place dans le monde sans prendre sa place ni souhaiter se mettre à sa place. La conscience de soi des individus à la fois explorateurs et situés est une conscience ouverte sur l’altérité. Cela est vrai des relations spécifiquement interhumaines, lesquelles sont indissociables des interactions avec le monde extérieur en général.
Au plan interhumain, se parler, se rencontrer, faire des choses ensemble, suppose de s’ajuster aux attentes des autres, de se découvrir mutuellement un point de contact et de former une communauté. L’opinion publique, qui est une composition d’opinions personnelles dont chacune est liée à une expérience personnelle, est une communauté de ce type. On dira peut-être que cette dernière est envisageable à petite échelle, mais constitue sinon une utopie inaccessible.
Ce n’est pas le cas : il suffit de penser par exemple à la concordance universelle des opinions en ce qui concerne des œuvres d’art historiques comme Les Nymphéas de Monet ou, pourquoi pas, la Joconde, pour admettre qu’un consensus fait d’avis issus d’autant d’expériences singulières est non seulement possible, mais aussi nécessaire. Car un objet qui suscite une expérience identique chez un nombre X de gens n’est pas et ne peut être une œuvre d’art.
L’opinion publique, la démocratie – qui orchestre et protège les libertés d’expérience de chacun – et les attitudes écologiques sont indissociables.
De même, en ce qui concerne notre période de pandémie fort trouble, un consensus quasi mondial s’est dégagé au fil du temps, apportant quelque chose de positif à un moment où rien n’allait, sur le fait d’accorder une priorité absolue à la vie humaine et de reléguer les autres priorités, notamment la richesse et la croissance, au second plan. Un accord bottom up, d’échelle variable, plurifactoriel, issu d’acteurs extrêmement diversifiés dont les visées et les valeurs étaient contrastées, s’est progressivement conclu par la validation institutionnelle étatique qui s’impose face à l’opinion constituée.
De même, la condamnation de l’invasion meurtrière de l’Ukraine par la Russie de Poutine a fédéré des acteurs et des opinions par ailleurs souvent clivés, à des niveaux d’union rarement égalés. À quand, doit-on se demander, un accord aussi étendu sur l’action urgente en faveur du climat et des équilibres environnementaux ? Faudrait-il une catastrophe supplémentaire ?
Il semble que la solution soit ailleurs : a contrario, le virus du SIDA d’un côté ou l’annexion en 2014 de la Crimée par la Russie de l’autre n’ont déclenché aucune montée tangible de l’opinion mondiale que les gouvernements auraient dû subséquemment endosser. Ni les rapports du GIEC ni les chiffres alarmants selon lesquels environ 8 millions de gens meurent chaque année à cause de la pollution ne se sont avérés mobilisateurs.
C’est que l’écologie humaine qui est le socle de la formation des opinions publiques dépend d’un environnement plus vaste. La démocratie qui forme un écosystème spécifiquement humain inclut aussi des arbres et des bêtes, des immeubles et des rues, des paysages, la « nature », une géographie particulière. Or, que ce soit vis-à-vis d’autrui ou d’une abeille qu’on observe, faire une expérience suppose d’établir activement un point de contact avec l’objet dont on fait l’expérience, sans bien sûr le détruire mais en transformant tout de même la relation qu’on a avec ce dernier. Ce processus « expérimental » assure de s’occuper du monde qu’on occupe, de l’aménager tout en le ménageant, de l’anthropiser sans l’accaparer, d’y cultiver ce dont on a besoin tout en s’en faisant le « gardien ».
Pour conclure, l’opinion publique, la démocratie – qui orchestre et protège les libertés d’expérience de chacun – et les attitudes écologiques sont indissociables. L’opinion publique, en faveur du tournant écologique qu’il est urgent de prendre, est une opinion issue de l’expérience directe des gens qui entrent en contact avec leur coin de vie et dédient une part de leur citoyenneté au ménagement de leur environnement en plantant, nettoyant, désignant leurs espaces de vie, mais aussi, via l’attention et l’observation de leurs manières d’être, en invitant les éléments les plus significatifs de leurs environnements à prendre part à leurs projets.
La participation active des citoyens à la création des modalités de leur existence et aux formes de leur vivre-ensemble conditionne l’émergence d’une culture écologique dont le passé regorge d’exemples et dont notre période actuelle, grâce à une multitude d’initiatives d’autogouvernement, témoigne déjà amplement. Par opposition au monde idéalement identitaire des extrêmes droites, celui de l’expérience est pluriel.
C’est celui-ci que le gouvernement qui va se former en France va devoir écouter, respecter et relayer s’il souhaite éviter une déflagration environnementale et sociale. S’il y parvient, le mérite reviendra, non au Prince, mais à nous tous qui avons réussi à nous rencontrer et à identifier nos intérêts en faveur d’un lieu commun où vivre.
NDLR : Joëlle Zask a récemment publié Écologie et Démocratie aux éditions Premier Parallèle
