L’ordre républicain d’Emmanuel Macron
Dans les dernières semaines, Emmanuel Macron et ses ministres ont sciemment franchi trois lignes rouges devant lesquelles ses prédécesseurs s’étaient arrêtés. Ils ont d’abord imposé une loi que la Chambre n’avait pas votée et dont l’impopularité était manifeste. Ils ont ensuite apporté leur appui inconditionnel aux formes les plus violentes de la répression policière. Ils ont enfin, pour répondre aux critiques de la Ligue des Droits de l’Homme, laissé entendre que les associations d’intérêt public pouvaient voir leurs subventions supprimées si elles émettaient des réserves sur l’action gouvernementale.
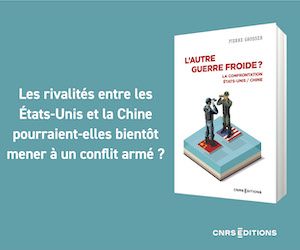
De toute évidence, ces trois franchissements font système et permettent de voir assez précisément la nature du pouvoir qui nous gouverne. Le premier a, bien sûr, frappé par contraste avec l’attitude adoptée par Jacques Chirac lors des grèves de 1995 et Nicolas Sarkozy lors du mouvement contre le contrat première embauche en 2006. Ni l’un ni l’autre n’avaient une fibre sociale très prononcée. Le premier avait été élu sur un programme de reconquête de la droite et le second avait annoncé la couleur en déclarant vouloir mettre la France au travail.
Ils ont pourtant estimé tous deux qu’il n’était pas possible de faire passer une loi modifiant le monde du travail qui était massivement rejetée par les intéressés eux-mêmes. En tant que politiciens à l’ancienne mode, ils s’estimaient encore redevables envers un sujet nommé le peuple : un sujet vivant qui ne se limitait pas au décompte électoral et dont il n’était pas possible d’ignorer la voix exprimée par l’action syndicale, les mouvements de masse dans les rues et les réactions de l’opinion publique. C’est ainsi qu’en 2006 la loi votée par le Parlement ne fut pas promulguée.
De toute évidence, Emmanuel Macron ne partage plus cette naïveté. Il ne croit plus qu’en sus du décompte des bulletins de vote, il existe encore quelque chose comme le peuple dont il ait à se soucier. Marx disait, avec quelque exagération à l’époque, que les États et leurs chefs n’étaient que les agents d’affaires du capitalisme international. Emmanuel Macron est peut-être le premier chef d’État chez nous à vérifier exactement ce diagnostic. Il est décidé à appliquer jusqu’au bout le programme dont il est chargé : celui de la contre-révolution néo-conservatrice qui, depuis Margaret Thatcher, vise à détruire tous les vestiges de ce qu’on appelait l’État social mais aussi toutes les formes de contre-pouvoir issues du monde du travail pour assurer le triomphe d’un capitalisme absolutisé soumettant toutes les formes de vie sociale à la seule loi du marché.
Cette offensive s’est donné un nom, celui de néo-libéralisme qui a alimenté toutes sortes de confusions et de complaisances. À en croire ses champions mais aussi bon nombre de ceux qui croient le combattre, ce mot de libéralisme signifierait simplement l’application de la loi économique du laisser-faire laisser-passer et aurait pour corrélat la limitation des pouvoirs de l’État qui se contenterait désormais de simples tâches de gestion en se dispensant de toutes interventions contraignantes dans la vie publique. Certains esprits, qui se croient forts, y ajoutent que cette liberté de la circulation des biens et ce libéralisme d’un État facilitateur plutôt que répressif s’accorderaient harmonieusement avec les mœurs et l’état d’esprit d’individus désormais soucieux de leurs seules libertés individuelles.
Pourtant, cette fable du libéralisme permissif a été démentie dès le début par les charges de la police montée lancées en 1984 par Margaret Thatcher dans la bataille d’Orgreave, une bataille destinée non seulement à imposer la fermeture des mines mais à démontrer aux syndicalistes ouvriers qu’ils n’avaient pas leur mot à dire sur l’organisation économique du pays. No alternative veut aussi dire : taisez-vous ! Le programme d’imposition du capitalisme absolu n’est en rien libéral : c’est un programme guerrier de destruction de tout ce qui fait obstacle à la loi du profit : usines, organisations ouvrières, lois sociales, traditions de lutte ouvrières et démocratiques.
L’État réduit à sa plus simple expression n’est pas l’État gestionnaire, c’est l’État policier. Le cas de Macron et de son gouvernement est à cet égard exemplaire. Il n’a rien à discuter ni avec l’opposition parlementaire, ni avec les centrales syndicales, ni avec les millions de manifestants. Il n’a que faire d’être désapprouvé par l’opinion publique. Il lui suffit d’être obéi et la seule force qui lui semble requise pour ceci, la seule sur laquelle son gouvernement peut en définitive s’appuyer, c’est celle qui a pour tâche propre de contraindre à l’obéissance, soit la force policière.
D’où le franchissement de la seconde ligne rouge. Les gouvernements de droite qui avaient précédé Emmanuel Macron avaient tacitement ou explicitement respecté deux règles : la première était que la répression policière des manifestations ne devait pas tuer ; la seconde était que le gouvernement était en tort lorsque la volonté d’imposer sa politique avait pour conséquence la mort de ceux qui s’y opposaient. C’était la double règle à laquelle s’était soumise en 1986 le gouvernement de Jacques Chirac après la mort de Malik Oussekine battu à mort par une brigade volante lors des manifestations contre la loi instaurant la sélection dans l’enseignement supérieur. Non seulement les brigades volantes avaient été dissoutes mais la loi elle-même avait été retirée.
Les actions musclées des BRAV-M sont la légitime défense de l’ordre républicain, c’est-à-dire de l’ordre gouvernemental qui veut à tout prix imposer cette réforme.
Cette doctrine est clairement du passé. Les brigades volantes, recréées pour réprimer la révolte des Gilets jaunes, ont été utilisées résolument pour réprimer les manifestants à Paris comme à Sainte-Soline où l’une des victimes est encore entre la vie et la mort. Et surtout, toutes les déclarations des autorités concordent pour dire qu’il n’y a plus de ligne rouge : loin d’être la preuve des excès auxquels conduit l’acharnement à défendre une réforme impopulaire, les actions musclées des BRAV-M sont la légitime défense de l’ordre républicain, c’est-à-dire de l’ordre gouvernemental qui veut à tout prix imposer cette réforme. Et ceux qui se rendent à des manifestations toujours susceptibles de dégénérer sont seuls responsables des coups qu’ils peuvent recevoir.
C’est aussi pourquoi aucune critique de l’action des forces de police n’est plus recevable et notre gouvernement a cru bon de franchir une troisième ligne rouge en s’en prenant à une association, la Ligue des droits de l’homme que ses prédécesseurs avaient généralement eu la prudence de ne pas attaquer de front parce que son nom même symbolise une défense des principes de l’État de droit jugée s’imposer à tout gouvernement de droite comme de gauche.
Les observateurs de la Ligue s’étaient en effet permis de mettre en cause les obstacles mis par les forces de l’ordre à l’évacuation des blessés. Cela a suffi pour que notre ministre de l’Intérieur s’interroge sur le droit de cette association à recevoir des subsides publics. Mais ce n’est pas là simplement la réaction du chef de la police à la mise en cause de ses subordonnés. Notre très socialiste Première ministre a mis les points sur les i : la réaction de la Ligue devant l’ampleur de la répression policière à Sainte-Soline confirme l’attitude anti-républicaine qui avait fait d’elle une complice de l’islamisme radical. Après s’être en effet interrogée sur la validité des diverses lois restrictives de la liberté individuelle qui proscrivaient certains habillements ou interdisaient de se couvrir le visage dans les lieux publics, elle s’était émue des dispositions de la loi « confortant les principes de la République » qui restreignent de fait la liberté d’association. En bref, le péché de la Ligue comme de tous ceux et de toutes celles qui se demandent si notre police respecte bien les droits de l’homme est de ne pas être une bonne républicaine.
On se tromperait en voyant dans les propos d’Élisabeth Borne un argument de circonstance. Ils sont l’aboutissement logique de cette philosophie dite républicaine qui est la version intellectuelle de la révolution néo-conservatrice dont son gouvernement applique le programme économique. Les philosophes « républicains » nous ont tôt averti que les droits de l’homme, jadis célébrés au nom de la lutte contre le totalitarisme, n’étaient pas si bons que cela. Ils servaient en fait la cause de l’ennemi qui menaçait le « lien social » : l’individualisme démocratique de masse qui dissolvait les grandes valeurs collectives au nom des particularismes.
Cet appel à l’universalisme républicain contre les droits abusifs des particuliers a vite trouvé sa cible privilégiée : les Français de confession musulmane et notamment ces jeunes lycéennes qui revendiquaient le droit d’avoir la tête couverte à l’École. On déterra contre elle une vieille valeur républicaine, la laïcité. Celle-ci signifiait naguère que l’État ne devait pas subventionner l’enseignement religieux. Maintenant qu’il le subventionnait de fait, elle acquit un sens tout nouveau : elle se mit à signifier l’obligation d’avoir la tête découverte, principe que contredisaient également les jeunes lycéennes porteuses du foulard et les activistes portant capuche, masque ou foulard dans les manifestations.
Dans les mêmes temps, un intellectuel républicain inventait le terme d’islamo-gauchisme pour identifier sans reste la défense des droits bafoués du peuple palestinien avec le terrorisme islamiste. L’amalgame allait alors s’imposer entre revendication des droits, radicalisme politique, extrémisme religieux et terrorisme. Certains auraient voulu en 2006 interdire, en même temps le port du foulard, l’expression d’idées politiques à l’école. En 2010, en revanche, l’interdiction de cacher son visage dans l’espace public permettait l’assimilation de la femme porteuse de burqa, du manifestant porteur de foulard et de la terroriste cachant des bombes sous son voile.
Mais c’est aux ministres d’Emmanuel Macron que revient le mérite de deux avancées dans l’amalgame « républicain » : la grande campagne contre l’islamo-gauchisme à l’Université et la « loi pour conforter les principes de la République » qui, sous couvert de lutte contre le terrorisme islamique, soumet l’autorisation des associations à des « contrats d’engagement républicain » suffisamment vagues pour pouvoir être tournés contre elles. C’est dans cette droite ligne que s’inscrivent les menaces adressées à la Ligue des Droits de l’Homme.
Certains pensaient que les rigueurs de la discipline « républicaine » étaient réservées aux populations musulmanes issues de l’immigration. Il apparaît aujourd’hui qu’elles visent bien plus largement tous ceux et toutes celles qui s’opposent à l’ordre républicain tel que le conçoivent nos dirigeants. L’idéologie « républicaine » que certain(e)s essaient encore par des jongleries diverses d’associer à des valeurs universalistes, égalitaires et féministes n’est que l’idéologie officielle de l’ordre policier destiné à assurer le triomphe du capitalisme absolutisé.
C’est le moment de se le rappeler : il n’y a pas en France une mais deux traditions républicaines. En 1848 déjà, il y avait la république tout court, celle des royalistes, et la république démocratique et sociale, écrasée par la première sur les barricades de juin 1848, exclue du vote par la loi électorale de 1850 puis à nouveau écrasée par la force en décembre 1851. En 1871, c’est la République des Versaillais qui noyait à son tour dans le sang la république ouvrière de la Commune. Macron, ses ministres et ses idéologues n’ont sans doute aucune intention meurtrière. Mais ils ont clairement choisi leur république.
