Les femmes de l’ESR : minorées, invisibilisées, mais désormais mobilisées
Après l’appel retentissant des historiennes qui jetaient le pavé de la sous-féminisation de leur discipline dans la mare de Blois, ce sont les philosophEs qui se sont mises à compter leurs rangs, ajoutant leurs voix à celles de leurs collègues et sœurs de misère. Dans les deux cas, une même déploration : d’un côté, la trop lente féminisation du corps académique, de l’autre, la trop faible reconnaissance des travaux féminins.
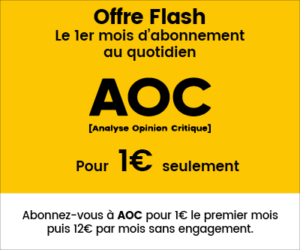
Nul doute que d’autres appels suivront tant il est vrai que cette situation caractérise le champ scientifique dans sa globalité : partout dans l’enseignement supérieur et la recherche (ESR), les femmes sont sous-représentées, minorées, invisibilisées. Toutes disciplines confondues, leur proportion parmi les enseignant·e·s-chercheur·se·s est aujourd’hui de 38 %, la sous-féminisation s’accentuant encore à mesure que les disciplines se « durcissent » : on compte 61 % de femmes en langues et littérature, 45 % en sciences humaines, 44 % en droit et science politique, 38 % en chimie, 28 % en sciences de la terre, 22 % en physique, mathématiques et informatique, 19 % en sciences de l’ingénieur (d’après le rapport annuel du ministère).
Mais ces seuls chiffres ne disent pas le plus important, soit la concentration des femmes aux premiers échelons de la profession. On compte ainsi 44 % de maîtresses de conférence pour 24 % de professeures. On dénombre 34 % de chercheuses au CNRS, mais seulement 31 % parmi les directeurs/trices de recherche à l’échelon 1, 25 % à l’échelon 2, 15 % à la classe exceptionnelle (données 2016). Quant aux postes d’autorité et autres fonctions exécutives, c’est chasse-gardée masculine : seules 12 % des présidences d’université et 17 % des directions de Grands établissements sont confiées à des femmes, quand la gouvernance des organismes publics de recherche n’est féminisée qu’à « hauteur » de 29 %. Le phénomène n’est en rien spécifique au monde de la recherche et de l’enseignement, c’est tout simplement le fait majeur caractérisant la situation des femmes dans le monde du travail. Reste que cette féminisation en dégradé de l’ESR a quelque chose de particulièrement choquant dans un milieu où sont supposés prévaloir le principe méritocratique et l’impartialité institutionnalisée de l’évaluation.
En l’état actuel des travaux sur la question, deux types de causalité sont invoqués. Sur le versant psycho-social, la confrontation à un environnement professionnel exigeant au point d’être hostile sous-tendrait chez les femmes des postures de retrait et d’auto-exclusion. Sur le versant socio-institutionnel, la sélection obéirait à des critères favorisant implicitement les hommes, révélant la prégnance d’un idéal-type androcentré de la réussite académique. Dans les deux cas, tout semble dépendre de la représentation que se font les acteurs concernés, candidat·e·s ou décisionnaires, de ce que doit être un.e professeur·e d’université ou un.e directeur·rice de recherche. Qu’il s’agisse d’hésitations personnelles ou d’obstacles institutionnels, c’est toujours parce qu’elles sont ramenées à leur statut domestique que les femmes se privent ou se voient privées de l’accès aux échelons supérieurs du microcosme. Je voudrais montrer que cet argument récurrent sert en fait de paravent dissimulant la persistance d’une forte réticence à reconnaître la valeur des femmes dans le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Pour le dire simplement, faire des enfants ou écrire des livres, il faudrait choisir !
Une première interprétation du phénomène de la sous-féminisation des sciences en renvoie la responsabilité aux intéressées elles-mêmes. Conscientes des sacrifices à faire et soucieuses de pouvoir s’engager, le moment venu, dans une vie familiale anticipée comme chronophage, les femmes renonceraient volontairement à briguer un poste ou une promotion. Il y aurait en somme intériorisation de l’incompatibilité postulée entre les exigences de la vie privée et celles d’une carrière académique valorisante. Pour le dire simplement, faire des enfants ou écrire des livres, il faudrait choisir !
Convenons-en, la principale des attentes auxquelles se soumet un·e enseignant·e-chercheur·se est celle de la production scientifique : « produire », c’est pouvoir présenter une liste de publications dense, conséquente et, surtout, continue. Pour souscrire à cet impératif, il faut se donner le temps de la recherche, celui qui vient se loger dans les interstices laissés entre les exigences de l’enseignement et/ou des charges administratives et les éventuelles contraintes familiales. Dans cette course d’obstacles, chacun·e se trouve soumis·e à une demande implicite de « disponibilité à la productivité » : on ne refuse jamais de participer à une manifestation scientifique, encore moins décline-t-on une proposition de publication… Dans le monde académique, tout se passe donc comme si les individus n’étaient que « publics », comme si les femmes ne faisaient pas d’enfants.
De la parentalité, on ne parle pas, ou c’est alors pour en souligner les inconvénients. Premier adage, avoir un bébé pendant ses années de thèse, c’est signer son arrêt de mort doctoral, chacune ayant dans son entourage connu le cas de la thèse avortée pour cause d’enfantement. Deuxième constat, devenir mère dans les années qui précèdent ou suivent le recrutement obère tout autant les chances d’être recrutée que celles d’être promue. Quelle enseignante-chercheuse n’a pas connu l’angoisse des « trous » dans sa liste de publications, des « trous » imputables à la naissance d’un enfant et malheureusement inexplicables dans la froide formalité d’un curriculum vitæ… Dans certaines disciplines, comme la biologie, la chose est acquise : une année = une publication ou un enfant. Mais ce raisonnement est loin de prévaloir dans les sciences humaines et sociales.
L’hypothèse de « l’auto-censure » permet notamment aux personnes directement impliquées de se dédouaner de toute responsabilité relativement à la minoration féminine observée.
C’est ainsi en arguant de la difficulté a priori de concilier vie académique et vie privée que l’on constate, sans beaucoup s’en émouvoir, que les femmes abandonnent les postes de statut supérieur aux hommes, qu’elles renoncent à écrire et à publier, qu’elles s’auto-excluent des positions gratifiantes au sein du monde de l’enseignement et de la recherche. Cette interprétation est bien commode, elle permet notamment aux personnes directement impliquées dans la sélection des candidat·e·s aux recrutements, des participant·e·s aux colloques et des contributeurs/trices aux revues, de se dédouaner de toute responsabilité relativement à la minoration féminine observée. Comme l’affirme les conclusions d’un rapport ministériel récent, « la carrière des femmes universitaires souffre davantage d’autocensure – c’est-à-dire de discriminations indirectes – que de discriminations directes ». La précision est aussi subtile qu’erronée.
Car il faut le dire, l’éventuelle moindre consistance des dossiers féminins n’est pas directement liée à la maternité. Au terme d’une enquête menée auprès de chercheurs en sciences de la vie, Catherine Marry remarquait que les liens entre famille et réussite étaient assez distendus : au sein de son échantillon, toutes les femmes ayant brisé le plafond de verre académique étaient mères de famille. Ce constat s’avère le même pour l’ensemble des disciplines universitaires [1]. Il faut donc en finir avec la pseudo-certitude selon laquelle les enfants empêcheraient les femmes de réussir, il faut convaincre les jeunes enseignantes-chercheuses de ce que leurs carrières ne dépendent pas de leurs choix familiaux, il faut les libérer de ce faux dilemme : un enfant ou un poste. S’il existe bel et bien un différentiel de productivité scientifique selon les sexes, celui-ci ne s’explique pas uniquement au regard de la potentialité maternelle des femmes. Il a également à voir avec les attentes et les préjugés d’un monde séculairement masculin.
Devenir professeure ou directrice de recherches signifie bien souvent devoir accepter un changement de son lieu de travail, parfois même sans en avoir connaissance avant la fin du recrutement (comme c’est le cas pour les agrégations du supérieur). Or, la chose est connue et l’on ne s’étendra pas sur ses raisons, les hommes sont bien plus mobiles géographiquement que les femmes (voir l’analyse d’Anne Revillard). Passer une habilitation à diriger des recherches (HDR) ou un concours menant à une promotion nécessite un investissement en temps qui peut se compter en années. Solliciter une invitation à l’étranger, se lancer dans un projet d’ouvrage, organiser une manifestation scientifique, toutes ces activités qui font notre quotidien exigent de s’y consacrer corps et âme.
L’injonction à l’excellence et la centralité de l’évaluation quantitative des dossiers font que tout.e impétrant·e doit accepter de se soumettre aux lois de la flexibilité et de la compétition.
On ne s’étonnera donc pas de constater que les instances de la gouvernance académique et de la sélection scientifique soient autant de cénacles où perdurent des règles d’évaluation androcentrées circonscrivant un profil de candidat saisi au prisme wébérien de la « vocation » [2]. Dévouement à la science et disponibilité absolue, telles sont les qualités attendues des enseignant·e·s-chercheur·se·s, des qualités attribuées par défaut aux hommes mais qui sont fréquemment questionnées quand il s’agit d’une candidature féminine [3]. Ces préjugés se jouent par ailleurs sur le fond d’une réévaluation de type managérial des critères de la vie académique. L’injonction à l’excellence et la centralité de l’évaluation quantitative des dossiers font que tout.e impétrant·e doit accepter de se soumettre aux lois de la flexibilité et de la compétition. L’image prévalente du scientifique reste celle du héros solitaire dégagé de toute contrainte familiale et susceptible de se dédier exclusivement à sa carrière.
D’où cette dynamique insidieusement discriminatoire qui voit les femmes assumer plus souvent que les hommes des tâches non reconnues et chronophages (obligations pédagogiques diverses, tutorats, recherche de financements et de partenariats, collaborations interdisciplinaires). Accaparées par des fonctions peu valorisées, les enseignantes-chercheuses sont aussi privées du temps nécessaire pour mener à bien leurs propres recherches. En parodiant l’effet Matthieu décrit en 1968 par Robert Merton (soit un effet de sur-reconnaissance des scientifiques ayant déjà atteint le sommet de leur carrière), Margaret W. Rossiter a qualifié d’effet Matilda (en référence à la suffragiste américaine Matilda Joslyn, 1826-1898) le phénomène du travail invisible des « collaboratrices » en science. Difficile dans ces conditions de trouver l’énergie nécessaire à une candidature.
Dans un même registre, les femmes s’avèrent moins sollicitées que leurs homologues masculins pour participer à des congrès internationaux ou pour assumer des responsabilités au sein des institutions disciplinaires, et ce dès les premières années de leur activité (Zuckerman, Cole & Bruer, The Outer Circle. Women in the scientific community, Yale University Press, 1991.). C’est que, dans l’université et le monde de la recherche aussi, l’insertion dans les réseaux est décisive quand il est question de réussite professionnelle. Les jurys de thèse, directions de laboratoires ou de départements, comités de rédaction ou d’organisation, jouent un rôle crucial. Ils révèlent trop souvent des processus de cooptation tendant à intégrer des critères sociaux et culturels aux mécanismes de l’évaluation des candidat·e·s. Détenir un capital symbolique individuel et être investi dans des relations diversifiées constituent des ressources inestimables quand il s’agit d’accéder aux « biens rares » que sont les postes d’enseignant.e.s-chercheur.se.s. On comprend dès lors comment il peut se faire que certain·e·s, femmes mais aussi personnes issues de milieux défavorisés et/ou de l’immigration puissent être à ce point invisibles dans l’ESR.
Il faut réclamer une modification des critères de l’évaluation et en finir avec la division sexuée du travail scientifique.
La place manque pour évoquer les décisions, plans et autres campagnes qu’il faudrait mettre en œuvre pour que les femmes occupent leur juste place dans l’enseignement supérieur et la recherche. Les historiennes et les philosophEs en ont présenté les grandes lignes en appelant à « l’édification de pratiques solidaires visant à contester des normes dominantes ». Outre l’exigence comptable de parité au sein des instances de sélection, il faut réclamer une modification des critères de l’évaluation et en finir avec la division sexuée du travail scientifique, se débarrasser de l’obsession quantitative pour revenir à la qualité des publications et valoriser l’originalité des travaux, intégrer les contraintes propres aux parcours féminins (la période épuisante de la maternité) et soutenir les jeunes collègues dans leurs aspirations. En un mot, se battre pour que les femmes de science ne restent pas des silhouettes floues et que leurs contours se dessinent enfin nettement.
Pour celles d’hier, cela signifie militer pour leur reconnaissance et leur présence dans les programmes ; pour celles d’aujourd’hui, c’est révéler la richesse de leurs travaux et leur contribution au renouvellement de la recherche. Il y va donc de notre responsabilité, à nous qui sommes en poste et qui avons réussi à nous hisser aux côtés des hommes, ne laissons pas les plus jeunes renoncer. Faisons en sorte, en initiant des Assises de l’égalité dans l’enseignement supérieur et la recherche, que la dynamique de féminisation s’accélère et que les biais masculins de la carrière académique disparaissent.
