Un Élan insuffisant face aux crises du logement
Le 19 octobre dernier, le Sénat adoptait la loi portant Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Élan). Ce texte fait suite aux importantes mesures d’économies budgétaires mises en œuvre dans la loi de finances pour 2018 et les ambitieux objectifs affichés sur les thèmes du « logement d’abord » et de la reconquête des cœurs de ville.
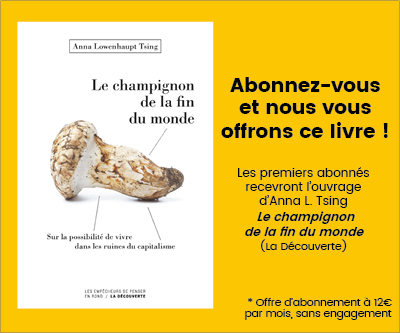
Si le terme « crise du logement » est absent de l’exposé des motifs du projet de loi Élan, ce dernier souligne « la tension sur la demande de logement » et « la pénurie de logements » dans certains territoires, de même qu’il pose le constat que les politiques mises en œuvre au cours des dernières décennies « ont permis de répondre à certains besoins, mais […] n’ont pour autant pas résolu l’ampleur des problèmes ». Face à ces échecs, le texte insiste sur le besoin de « construire plus, mieux et moins cher » et de faire évoluer le secteur du logement social, insuffisamment efficace aux yeux du gouvernement.
Si le constat est partagé par tous, la cohérence des intentions et des mesures proposées se doit d’être interrogée.
Le constat des crises du logement
Dans l’ouvrage que nous venons de coordonner, nous traçons les contours de ce qu’il est convenu d’appeler Les crises du logement en France, partant du constat d’une situation radicalement différente de celle de la crise quantitative des années 1950 ou 1970.
Les analyses des chercheurs qui y ont contribué à l’ouvrage (économistes, démographe, sociologue, urbaniste) mettent en avant à la fois la persistance d’un nombre élevé de personnes subissant soit le mal logement soit l’accentuation des coûts de la mobilité résidentielle dans les grandes villes du pays, du fait de prix et de loyers de marché devenus inaccessibles. Cette incapacité croissance des ménages à adapter leurs conditions de logement à leurs besoins accroît les mécanismes inégalitaires et le gouffre de plus en plus large qui sépare propriétaires et locataires et, par la même occasion, les générations et les territoires. La situation des individus en matière de logement est devenue, en tant que telle, depuis le début des années 2000, un facteur d’inégalités. De fait, le pluriel s’impose pour évoquer les crises du logement.
Alors que ce constat devrait constituer le point de départ d’une réflexion politique visant à régler les problèmes identifiés, force est de constater que la stratégie du gouvernement pour le logement ne va pas dans ce sens. Bien évidemment certaines des dispositions, visant à améliorer l’efficacité de l’action publique, vont dans le bon sens (généralisation de la cotation de la demande de logements sociaux, amélioration du droit de la copropriété, lutte contre l’insalubrité et les marchands de sommeil, régulation des meublés touristiques, etc.) En outre, on ne peut que saluer les intentions affichées de développer le « logement d’abord » visant à proposer plus systématiquement des formules d’habitat pérenne à des personnes à qui on n’offre aujourd’hui que le recours à un hébergement temporaire frappé par l’embolie.
Toutefois, ces mesures ne constituent ni le cœur de la stratégie gouvernementale, ni des moyens à la hauteur pour répondre aux enjeux globaux du domaine.
Les illusions du choc de l’offre
La volonté du « choc de l’offre » n’est pas nouvelle. Elle apparaissait déjà dans un programme promu par Benoist Apparu, secrétaire d’État au logement et à l’urbanisme en 2011 (« Construire plus et mieux ») ou dans le programme présidentiel de Nicolas Sarkozy en 2012 (« augmenter les droits à construire pour provoquer un choc d’offre »). Opérations d’urbanisme où l’État joue un rôle moteur, mise à disposition de terrains publics, réduction des normes et restriction du droit de recours, toutes ces mesures sont connues et ont pour la plupart déjà été mises en œuvre avec plus ou moins de succès. La plupart vont probablement dans le bon sens s’il s’agit d’accroître un peu la production de logements neufs dans les secteurs les plus tendus.
Malgré tout, l’erreur réside à la fois dans le diagnostic et dans la croyance dans les effets rapides d’une telle croissance. Au niveau national, les hausses de prix des vingt dernières années doivent beaucoup plus à l’évolution des conditions du crédit (baisse des taux, allongement des prêts) qu’à un déséquilibre offre/demande. Le parc de logements français est l’un des plus abondants d’Europe [1] et la construction y est dynamique. Seule exception, elle est de taille, le cœur de l’agglomération parisienne qui a accumulé un retard de construction depuis plusieurs décennies.
Le volume de la construction neuve en France équivaut chaque année à entre 1,0 % et 1,2 % du stock total de logements [2], dont seulement entre un tiers et la moitié, selon les aléas de la conjoncture, sont destinés à la vente [3]. Penser que ce volume marginal pourrait avoir un effet rapide sur l’offre globale et sur les prix relève de la pensée magique.
Cela ne signifie pas qu’il faille renoncer au rôle de la production neuve, bien au contraire, mais ses effets sur une détente du marché ne peuvent se penser qu’en considérant le temps long compté en décennies. Tout le contraire d’un choc. C’est l’affirmation de la nécessité de règles favorables à la construction, mais surtout sûres et stables, non soumises aux aléas annuels des lois de finances, aux pressions conjoncturelles des lobbys, ou aux échéances électorales.
La fragilisation du logement social
Outre les nombreuses mesures réglementaires, la loi Élan propose une ré-organisation en profondeur du secteur du logement locatif, transformation qui s’inscrit dans la suite logique des arbitrages budgétaires décidés lors de la loi de finances pour 2018. L’objectif affiché visait à réduire massivement la dépense publique adressée au secteur du logement en France. Après la gestion pour le moins malencontreuse de la baisse généralisée de 5 euros par mois en juillet 2017, il convenait d’inventer une formule permettant de réduire la dépense, sans impact sur les allocataires dont les revenus sont faibles. C’est ainsi que, plutôt que de réduire les aides dans le parc privé où elles sont pourtant accusées par le gouvernement d’avoir un effet inflationniste sur les loyers [4], le choix s’est porté sur une solution plus facile consistant à obliger les bailleurs sociaux à réduire drastiquement les loyers des locataires à bas revenu. C’est la « réduction de loyer de solidarité » créée par la loi de finances pour 2018 et qui génèrera, après trois ans de montée en puissance, 1,5 milliard d’euros d’économie pour l’État [5] et autant de pertes de ressources pour les bailleurs sociaux ; les deux tiers de leur capacité d’autofinancement.
C’est cette fragilisation financière du monde du logement social qui conduit, dans la loi Élan, à forcer les regroupements des petits organismes et à les inciter vigoureusement à développer la vente de leur patrimoine. Le produit de ces ventes est censé reconstituer les fonds propres évaporés par la réduction des loyers et donc la capacité d’investissement des bailleurs. Le résultat de ces mesures sera un accroissement considérable des disparités entre les bailleurs. D’un côté des grands groupes privés capables de se diversifier, de valoriser un patrimoine attractif et d’organiser des péréquations financières à l’échelle nationale. De l’autre, des offices publics de taille moyenne, ancrés dans tous les territoires et logeant une population de plus en plus pauvre. Ces disparités ne sont pas nouvelles et l’émiettement des structures HLM est évidemment excessif et contre-productif, notamment au cœur de l’Île-de-France, mais les mesures budgétaires et structurelles en cours de mise en œuvre vont accélérer le processus de creusement des inégalités internes au secteur. Iront-elles jusqu’à le faire éclater et à faire disparaître les acteurs les plus faibles, notamment dans les villes petites et moyennes et les territoires ruraux où l’investissement privé est absent ? Il est trop tôt pour le dire, mais on ne peut que constater la fragilisation globale d’un édifice certes imparfait, mais que l’Europe entière envie à la France.
Quel élan pour sortir de la crise ?
Aujourd’hui, la France semble à rebours de ses voisins. L’exemple du Royaume-Uni est éclairant. Sous l’égide de Margaret Thatcher, le Royaume-Uni a impulsé une réforme profonde du secteur du logement social en entamant notamment de larges opérations de ventes HLM et de baisse des allocations logement. Aujourd’hui, face à la forte dégradation des conditions de logement des ménages anglais, le gouvernement a annoncé un grand plan d’investissement dans le secteur afin de soutenir la production de logements sociaux. En réalité, compte tenu de la structure des statuts d’occupation en France, les modèles dont nous pourrions – devrions – nous inspirer sont les modèles des pays nordiques. Le parc social y est largement développé, les prix y sont contenus et les conditions de logement des ménages sont bonnes. Bien évidemment, ces pays consacrent des aides publiques importantes au secteur. En contrepartie, les aides affectées au secteur privé sont réduites. Une autre piste pourrait résider dans le fameux « modèle allemand », le parc social y est résiduel mais le parc privé est très largement réglementé. Il semblerait que cette piste soit privilégiée par le gouvernement avec la fragilisation du modèle du logement social. Le problème étant qu’aucune contrepartie n’est proposé pour développer un parc locatif privé abondant et abordable.
Il est important de rappeler qu’il n’y a pas de « fatalité » aux crises du logement. Certes, le diagnostic que nous posons est lourd. Malgré tout, les choses changent. La question du foncier est maintenant au cœur de nombres de réflexions au sein des territoires en tensions. De nombreuses villes comme Rennes ou Lille se sont ainsi emparées de la question de la régulation du foncier – et donc des prix – en mettant en œuvre de multiples outils réglementaires à disposition depuis longtemps. L’explosion des prix immobiliers au début des années 2000 a eu au moins cela de positif qu’elle a forcé les acteurs locaux à s’emparer de la question du logement cher.
Concernant les publics exclus du logement, là encore les choses avancent. En réaffirmant son engagement de soutenir une politique du « logement d’abord », le président de la République a répondu à une longue attente du monde associatif. Une fois encore, les solutions existent et sont pour la plupart connues. On serait de fait tenté de dire que seule la volonté vient parfois à manquer. L’encadrement des loyers est, dans les zones tendues, une solution à court terme, même si elle est largement perfectible. La garantie des loyers aurait pu en être une autre si elle avait vu le jour. La réforme des valeurs locatives qui devrait voir le jour dans les années qui viennent pourraient constituer une avancée majeure en termes de justice fiscale mais également le pas d’une réforme profonde de la fiscalité immobilière, levier d’action public important dans un contexte où les inégalités patrimoniales ne cessent de croître.
Si l’on remonte le temps, qui aurait dit à la fin des années 90 qu’une loi (la future loi SRU) allait permettre à la France de produire plus de logements sociaux que tous ses voisins ? Qui aurait dit que le droit au logement allait devenir opposable ? La France a connu des avancées majeures en l’espace de 20 ans et les conditions de logement n’ont cessé de s’améliorer. C’est ce qui nous a amenés à la conclusion que « Les réponses à apporter aux problèmes de logement que traverse la France sont en réalité probablement bien plus nombreuses que les crises qui la traversent. Si l’existence de solutions nombreuses rassure, le devoir de responsabilité est grand ».
NDLR : Jean-Claude Driant et Pierre Madec ont dirigé Les Crises du logement (« La vie des idées », Presses Universitaires de France, 2018.)
