L’extrême droite et la faillite politique et morale de la droite libérale
On admet généralement qu’il revient surtout aux militant.e.s et sympathisant.e.s de gauche de lutter contre les forces d’extrême-droite et le fascisme. Et c’est effectivement ce qui se passe – avec plus ou moins de succès. Mais lorsque ces forces commencent à obtenir des scores électoraux dépassant les 10%, elles exercent une pression politique sur les droites traditionnelles qu’il est de la seule responsabilité de ces dernières de dénoncer, de contrer et d’annihiler.
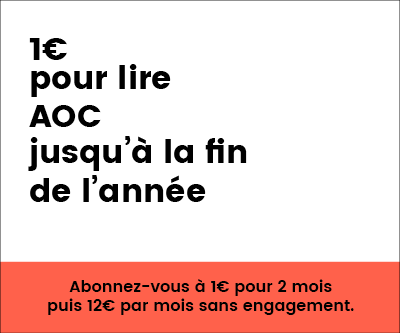
Cela a longtemps été le cas avec la doctrine dite du « cordon sanitaire », posant que les partis extrémistes ne font pas partie de l’« arc démocratique » et que toute alliance avec eux est exclue. Mais voilà : ce cordon se relâche un peu partout en Europe. Comme il semble loin le temps où la participation de l’extrême-droite du FPÖ au gouvernement autrichien en 1999 avait donné lieu à des sanctions temporaires de la Communauté européenne. Dorénavant, la présence de ce genre de parti dans des exécutifs européens n’entraîne plus ce réflexe de salubrité démocratique, que ce soit en Belgique ou au Danemark, pour ne pas parler de la longue absence de réaction des instances de l’Union aux atteintes à l’État de droit en Pologne et en Hongrie. Ce délitement de la volonté politique est la marque d’un certain délabrement moral et du sauve-qui-peut politique qui fait insensiblement dériver la droite traditionnelle vers l’inacceptable.
Si ce renoncement tient pour beaucoup au désarroi et à l’inquiétude que suscitent la progression du soutien électoral que les partis d’extrême-droite parviennent à drainer et la menace qu’elle fait peser sur l’avenir de régimes démocratiques, il traduit aussi leur impuissance à résister à l’argumentation démagogique et à l’attisement des craintes et de la peur. C’est ce début de faillite morale et politique d’une partie du camp de la droite traditionnelle qui favorise la montée en puissance des discours d’extrême droite et l’empire qu’ils sont en train de conquérir sur les esprits – et qui commence à se traduire dans les urnes. C’est en tout cas ce que montrent le résultat des récentes élections aux États-Unis, en Italie et au Brésil.
États-Unis : la défaite des républicains
La victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines de novembre 2016 peut, d’une certaine manière, apparaître comme inscrite dans la logique de l’alternance, en mettant fin à deux mandats démocrates, en offrant un exutoire au racisme d’une partie de la population que l’élection d’un homme blanc « venge » de la première présidence « noire ». Elle a également révélé la profondeur de la détestation suscitée par la candidate démocrate, à la fois parce que c’est une femme et un membre de l’« establishment » et, par suite, traduit les divisions internes au Parti démocrate. Elle est, de plus, le fruit d’une stratégie électorale mieux ciblée par l’équipe républicaine : alors même qu’Hillary Clinton a remporté le vote populaire (avec près de 3 000 000 de voix d’avance), c’est le basculement de quelques États traditionnellement démocrates vers les républicains qui lui ont coûté la nomination.
Au fond, l’élection improbable d’un candidat unanimement considéré comme vulgaire, raciste, misogyne, inconsistant et incompétent s’est faite sur un écart de 60 000 voix. Mais elle tient d’abord à la déconfiture de la direction du Parti républicain qui s’est montré totalement incapable de contrôler un processus de désignation dans lequel un outsider absolu et honni – mais soutenu par une faction déterminée, le Tea Party, qui a pris les commandes en son sein – est parvenu à écraser, en usant de méthodes et de subterfuges dégradants, ses figures historiques qui préparaient leur campagne de longue date. Et une fois la nouvelle présidence installée, l’establishment républicain s’est aligné (à quelques notables exceptions près) sur des pratiques qui rompent avec tous les usages en vigueur et toutes les instructions professées par la corporation des conseillers en communication. Comme l’a fait une grande partie des milieux d’affaires qui, bénéficiant de l’accroissement de leurs profits que le maximalisme libéral de Trump leur permet d’engranger, passent par pertes et profits ses assauts délibérés contre les médias, la vérité, l’égalité et la justice ; ses penchants militaristes et ses certitudes obsidionales ; voire ses obsessions sécuritaires, nationalistes et suprémacistes.
Le résultat des élections de mid-terms attestent du fait que la grande majorité du camp de la droite fait bloc derrière un président dont, même si elle n’apprécie pas les mauvaises manières ou les liens avec les mouvances extrémistes, antisémites et néo-fascistes, elle reconnaît qu’il sert bien ses intérêts.
Italie : le refus de comprendre les pratiques politiques autonomes des citoyen.ne.s
En Italie, la situation est un peu plus complexe puisque les élections ont conduit à l’arrivée au pouvoir, en juillet 2017, d’une coalition associant le Movimento Cinque Stelle (M5S), présenté comme « inclassable » ou « anti-système », et la Lega, parti de droite nationaliste dirigé par un leader d’extrême-droite, Mateo Salvini. Le contexte qui a permis la naissance de cet improbable attelage est particulier.
Depuis les années 1980, le système politique italien est mis en coupe réglée par deux grands blocs de gouvernement (la droite, tenue par Berlusconi, et la gauche, conduite par Renzi) qui poursuivent une même politique d’austérité et entretiennent des liens avec les Mafias. Ce paysage a été profondément bouleversé par l’émergence inopinée, en 2009, d’une troisième force : les Cinque Stelle, un mouvement constitué par des activistes (associations de quartier, écologistes) et des citoyen.ne.s non encarté.e.s écœuré.e.s par l’état de la démocratie italienne, gangrénée par le clientélisme, l’affairisme et la corruption. Refusant toute assignation idéologique (ni droite ni gauche), le mouvement, qui se réclame de la démocratie directe, est organisé autour d’une plate-forme informatique (Rousseau) sur laquelle se développe le débat entre adhérents, s’élaborent les mesures qu’il s’agit de faire advenir, se décident les nominations des représentants et s’exerce le contrôle permanent des mandants sur les mandataires.
En moins de dix années de présence sur la scène électorale, le M5S est devenu le premier groupe politique du Parlement en obtenant près de 33% des voix aux législatives du 4 mars 2018 – et cela bien qu’un changement de loi électorale ait été voté en dernière minute pour lui barrer la route du pouvoir que lui annonçait les sondages. Puisque ni le « centre-droit » ni le « centre-gauche » ne sont parvenues à s’assurer une majorité, le M5S a été placé en position de former l’exécutif. Une première négociation s’est donc ouverte assez naturellement, à gauche, qui a capoté lorsque Renzi a déclaré à la télévision, sur un ton de parrain, que jamais sa formation ne gouvernera avec un groupe qui n’a cessé de le combattre et de l’insulter.
A la suite de cette rebuffade, un nouveau prétendant à la négociation s’est présenté : la Lega, après avoir rompu son alliance avec Forza Italia de Berlusconi et les néo-fascistes des Fratelli d’Italia. Et, à la surprise générale, le M5S et la Lega sont parvenues à établir un « contrat de gouvernement », aux termes duquel chacune de ses composantes conserve ses propres orientations mais s’engage à remplir, en toute transparence, les clauses qui y sont consignées. Jusqu’à présent, ce gouvernement est parvenu à éviter les écueils et la rupture, même si des désaccords majeurs entre les deux formations sont quotidiennement et violemment débattus. Certains raillent cette incohérence du gouvernement, alors qu’on pourrait y voir une avancée démocratique qui met sur la place publique les divergences que suscite une question politique, en impliquant la société tout entière dans un débat mené de façon ouverte. Pour l’instant, le M5S avale – non sans mal – les délires sécuritaires, identitaires, xénophobes et familialistes de Salvini et de la Lega ; et ces derniers entérinent – avec bien des difficultés – les dispositions écologiques, sociales et anti-corruption défendues par leur partenaire.
Personne n’ose pronostiquer la durée de vie de cette coalition hétéroclite, d’autant que, dès sa formation, Salvini a joué cartes sur table, en annonçant que son objectif était de récupérer les voix du M5S avant de provoquer des élections anticipées qui lui donneraient la majorité absolue au Parlement. Et ce pari commence à se réaliser partiellement : les intentions de vote pour la Lega sont aujourd’hui à 34% et celles pour le M5S à 28%. Il faut dire que ce niveau tient largement au fait que, pour la droite, Salvini a détrôné Berlusconi et que la Lega a siphonné les voix de Forza Italia. Ce qui le place en position de leadeur d’un camp divisé entre idéologues (nationalistes irascibles et xénophobes avérés) et pragmatiques (industriels et commerçants favorisant l’ordre, la stabilité et l’ouverture à l’Europe).
La solidité de cette alliage est mise à l’épreuve par la présentation d’un budget marqué par le refus de la discipline financière fixée et contrôlée par les services de la Commission européenne. Ce budget rompt en effet délibérément avec les règles économiques et sociales qui ont été définies – et que ses prédécesseurs ont mises en application – par des traités dont le caractère obsolète est clairement affirmé. Pour une partie des élites politiques et économiques italiennes qui continuent à soutenir la nécessité de respecter les règles du Pacte de stabilité, le bras de fer que leur gouvernement a engagé contre les défenseurs de la doxa économique est absurde et suicidaire. Mais elle ne se risquerait pas aujourd’hui à s’engager publiquement contre Salvini, qui est devenu son champion et sur lequel elle compte pour en finir avec cette anomalie que représente l’installation dans l’univers réservé aux professionnels de la politique d’un mouvement composé de citoyen.ne.s ordinaires, le M5S, qui les empêche de gouverner dans l’entre-soi. Pour revenir à la normale, la droite est prête à s’abandonner à une aventure dont elle croit détenir les clés.
Brésil : faire le lit du vote pour le fascisme
Quant au Brésil, la déconfiture de la droite est plus terrifiante encore. A première vue, la victoire de Jair Bolsonaro sonne comme l’expression d’un « dégagisme » viscéral et contagieux qui emporte une population de façon irrationnelle. Rien n’assure cependant que ce succès signe l’adhésion d’une majorité du corps électoral aux aspects les plus choquants ou les plus délirants de ses propositions, en considérant qu’elles sont des articles de rhétorique qui ne seront de toute façon pas mis en œuvre.
Ce qui trouble le plus dans l’accession au pouvoir de Bolsonaro est le fait qu’il a très explicitement affiché un programme qui prône la foi en l’autorité absolue du leader, la grandeur de la tradition et de famille, l’exploitation intensive et sans entraves de la nature, la criminalisation des oppositions, la réduction au silence des médias, la militarisation de la répression, l’aggravation de l’austérité budgétaire, la mort du pluralisme, la fin de la transparence, la remise en cause de l’égalité de statut des femmes, l’éradication de l’homosexualité. Et tout cela en promettant de rendre sa grandeur au Brésil et la prospérité à ses habitants. La victoire de cet adversaire résolu des droits humains et de la démocratie – même s’il a fait mine de la vénérer au lendemain de son élection – a toutes les chances d’ouvrir une période sombre pour les libertés publiques (celles d’association, de réunion et d’expression) et, on peut le craindre, pour l’intégrité physique de ceux et celles qui oseraient le défier.
La tournure extravagante qu’a prise ce suffrage tient pour beaucoup à l’activité fébrile des dirigeants politiques de la droite brésilienne qui ont œuvré à la mise au rencart de la formation qui a gouverné le pays durant une décennie : le Parti des Travailleurs de Lula. Le travail de sape des institutions de la démocratie représentative qu’elle a conduit a commencé avec l’organisation du vote pour la destitution de Dilma Rousseff, puis par son remplacement par le vice-président, Michel Temer, qui, durant les deux années de sa fin de mandat, a fait adopter des mesures autoritaires votées à la hussarde (plans d’austérité, fermetures des services publics, réduction du budget de l’Etat, réforme des retraites, arrêt des aides aux familles, etc.) afin d’en finir avec les politiques de promotion sociale des plus pauvres. Elle s’est poursuivie avec l’inculpation de l’ancien président Lula sur la base d’un témoignage d’un industriel menacé d’une condamnation pour corruption, puis sa condamnation à douze années de prison afin de l’empêcher de se présenter aux élections présidentielles.
En somme, les forces politiques, économiques, religieuses et médiatiques de la droite brésilienne ont ostensiblement bafoué les règles de droit, de justice et de représentation de la démocratie, en attisant la haine de Lula et du Parti des Travailleurs. Ils n’en ont cependant pas tiré le bénéfice politique attendu. Elles ont été laminées par les électeurs et les électrices qui ont fait un triomphe brutal à Bolsonaro, candidat de seconde zone et affichant sa détestation des toutes les composantes « déviantes » de la société brésilienne (communistes, populistes d’extrême gauche, criminels, gangs, femmes, LGBT+, indiens, travailleurs sans terre, etc.) en promettant de les éradiquer, par la force au besoin.
La droite doit se ressaisir
La faillite politique et morale de la droite libérale, tétanisée par la détermination de ses minorités extrémistes et incapable de dénoncer leur surenchère antidémocratique, a ouvert la voie à l’accession au pouvoir de ces irascibles adversaires de la démocratie venus d’un autre âge que sont Trump et Bolsonaro. Comme en des temps plus sombres, un bloc de forces sociales dominantes a vite volé, avec plus ou moins de répugnance, au secours de la victoire de ces deux figures à la santé mentale douteuse, en fermant pudiquement les yeux sur l’envers de la pièce : l’accroissement de la répression, la réduction des libertés publiques (celles d’association, de réunion et d’expression) et, on peut le craindre dans le cas du Brésil, l’atteinte à la vie des opposants. Ces craintes ne sont pas des fantasmes que les droites traditionnelles peuvent aujourd’hui écarter d’un revers de la main.
Les discours, les programmes et les stratégies de communication de Trump et de Bolsonaro prônent de façon « décomplexée » le rétablissement de l’autorité du chef, l’exploitation intensive et sans entraves de la nature, le respect inconditionnel de la nation, la grandeur de la tradition et de famille, la réduction au silence des médias, la militarisation de la société ; et brûle d’en finir avec les droits humains, le pluralisme, la transparence, l’homosexualité, l’avortement et l’égalité de statut des femmes. Autrement dit, la droite ne peut plus ignorer le danger – sauf à s’aveugler ou à souhaiter l’instauration d’un régime autoritaire pour soumettre les rétifs à son ordre. Les forces de gauche combattront toujours celles d’extrême-droite : c’est leur vocation. Mais c’est aujourd’hui à la droite de se ressaisir pour faire en sorte que le totalitarisme ne finisse par suspendre les droits et libertés qu’assurent encore un peu les régimes démocratiques.
