Face au présent
Avant d’être face au présent, nous sommes dans le présent, puisqu’il est notre lieu et notre milieu. Nous sommes embarqués, et il en fut toujours ainsi pour toutes les communautés humaines. Se mettre face au présent, c’est déjà opérer une première mise à distance. Mais peut-on se mettre face au présent, à la façon du spectateur qui, pour saisir une vue d’ensemble du tableau qu’il a devant lui, recule de quelques pas ? Évidemment pas, puisque le présent n’est le même ni pour tous ni partout, et qu’il est bien difficile de lui assigner des limites sûres.
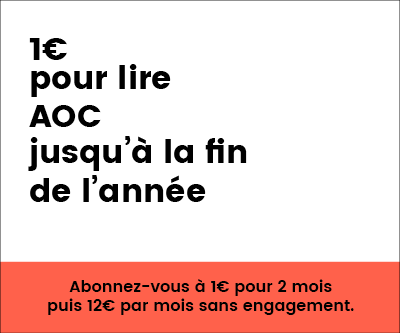
Malgré tout, existent nombre d’instruments de distanciation, puisque c’est la démarche même de toutes les sciences sociales : observer, mesurer, évaluer, interpréter, comparer. Grâce à ces enquêtes multiples, nous en savons donc, en fait, beaucoup sur le présent ou, plutôt, sur les différents présents. Et même de plus en plus, compte tenu des possibilités qu’ouvre le développement rapide du big data. Mais cet accroissement des connaissances risque aussi d’en accentuer le morcellement. Si nous savons de façon de plus en plus précise ce que c’est que vivre dans le présent (selon que vous êtes ouvrier, cadre, chômeur, jeune, vieux, migrant, etc.), nous ne voyons pas forcément mieux quel est ce présent : sa trame et sa texture. Pour reprendre l’image du tableau, nous en appréhendons de mieux en mieux les détails, mais pas forcément ce qui a présidé à sa composition. En ce point, l’historien peut apporter sa contribution, en proposant des allers retours entre présent et passé par le relais de la comparaison.
C’est ce que j’ai fait, il y a près de vingt ans, quand j’ai suggéré de nommer présentisme le moment contemporain. Ce diagnostic résultait d’une prise de distance maximale, puisqu’il s’agissait de comparer des présents du passé avec le nôtre, en s’arrêtant sur des moments de crise du temps. Que voulais-je dire, après d’autres et avec d’autres ? Que nous étions passés d’une configuration où le futur était la catégorie dominante à une nouvelle où le présent venait à se trouver investi de ce rôle. Quand le futur occupait le premier rôle, il éclairait, en effet, le présent et le passé et, porté par le progrès, il invitait, obligeait le plus souvent à marcher de plus en plus vite vers un avenir gros de promesses. Accélérer et moderniser ont été ses maîtres-mots. Toute une part du XIXe siècle a ainsi été intensément futuriste. Mais, deux guerres mondiales et quelques révolutions plus tard, alors que les promesses les plus radieuses avaient viré au cauchemar, il devenait impossible de croire que progrès et progrès de l’humanité marchaient de pair. S’est alors ouvert, dans les années 1970, ce qu’on a vite appelé une crise de futur, soit un futur qui se fermait, alors que, comme en contrepartie, le présent prenait une place de plus en plus grande. Si l’occasion en a été le premier « choc pétrolier » (1973) et ses suites sur les économies occidentales, la crise venait, en fait, de bien plus loin.
Ne jamais être en repos, être flexible, mobile, répondre à la demande, innover sans relâche sont les mots d’ordre.
Le présent est devenu à la mode et, très vite, une injonction : il faut non seulement être de son temps, mais travailler et vivre au présent. Ne jamais être en repos, être flexible, mobile, répondre à la demande, innover sans relâche sont ses mots d’ordre. Bien vite, les nouvelles technologies de l’information ont porté, diffusé, démultiplié les possibilités d’exploiter ce qu’on nommait le « temps réel ». Paradoxalement, alors que, d’un côté, le présent tend à presque s’abolir dans l’instant, il ne cesse, de l’autre, de s’étendre tant en direction du passé que de l’avenir : jusqu’à devenir omniprésent, cannibalisant les catégories du passé et du futur, c’est-à-dire fabriquant quotidiennement d’abord puis, à chaque instant et en continu, le passé et le futur, dont il a besoin. Un peu partout, la publicité ne manque pas de claironner que le futur commence « demain » ou, mieux, « maintenant ».
À ce présent oscillant entre le presque tout et le quasi rien, il faut ajouter encore une dimension. Car ces décennies sont aussi celles des « années-mémoire », selon l’expression de Pierre Nora. Shoah, le film de Claude Lanzmann, sorti en 1985, en témoigne avec une force singulière, tandis qu’entre 1984 et 1992, Les Lieux de mémoire de Nora font appel à la mémoire pour récrire l’histoire. Ce sont en ces années que « demande » de mémoire, « devoir » de mémoire, « droit » à la mémoire prennent une place de plus en plus grande dans les espaces publics (médiatiques, judiciaires, culturels). Bientôt, la mémoire devient une figure obligée des discours et des agendas politiques. Un peu partout les commémorations se multiplient et deviennent de grandes messes (nationales, patriotiques, chauvines parfois, protestataires aussi…) et des politiques mémorielles se mettent en place débouchant souvent sur des lois mémorielles. Le présentisme ne croit plus en l’histoire, mais il s’en remet à la mémoire, qui est, en somme, une extension du présent en direction du passé, par évocation, convocation de certains moments du passé (le plus souvent douloureux, cachés, oubliés…) dans le présent. Mais sans ouverture vers le futur, sauf celle que portent les « Jamais plus », qui indiquent d’abord un retour sur un passé dont on proclame la clôture. Souvent les parcours des musées de la mémoire, dont le nombre s’est multiplié à travers le monde, s’achèvent sur cette injonction morale : ne pas oublier pour ne pas recommencer.
L’Histoire, en revanche, celle dont le XIXe siècle avait fait sa divinité majeure, ouvrait vers le futur et était téléologique (que ses héros fussent la Nation, le Peuple, le Prolétariat). Ce faisant, elle était plutôt du côté des vainqueurs ou de ceux qui, provisoirement vaincus, seraient victorieux demain, alors que la mémoire est devenue l’instrument ou l’arme de ceux qui n’ont pu parler ou qu’on n’a pas entendus, des oubliés (de l’histoire), des minorités, des victimes. Mémoire et présentisme vont donc de pair. La mémoire permet d’échapper à un présent, où les repères s’effacent à grande vitesse, sans le quitter pour autant. Faire face à ce passé qui, comme on l’a dit, ne passe pas (celui des crimes contre l’humanité et des génocides), est donc aussi une des modalités du faire face au présent, puisque ce passé est non seulement encore présent, mais du présent. L’imprescriptibilité du crime contre l’humanité n’entraîne-t-elle pas que le criminel, sa vie durant, demeure contemporain de son crime ? Car, pour lui, justement le temps ne « passe » pas, mais, du même coup, pour nous nous plus.
Nous percevons de plus en plus nettement que des temporalités trop désaccordées entre groupes sociaux, classes d’âge ou classes sociales sont porteuses de dangers.
Faire face au présent, le diagnostiquer, c’est aussi percevoir qu’il n’y a pas un seul présentisme, le même pour tous, mais des présentismes. Au moins deux : il y a, d’un côté, celui qui est choisi, celui de ceux qui, connectés, mobiles, agiles, sont reconnus comme les « gagnants de la mondialisation » et, de l’autre, celui qui est subi, celui de tous ceux qui sont interdits de projets, qui, ne pouvant littéralement pas se projeter vers l’avenir, vivent, survivent même au jour le jour. Leur seul univers est la « précarité », voire la « grande » ou « très grande précarité ». Aujourd’hui, le plus démuni est le « migrant » (il n’est ni un émigré ni un immigré, mais un « migrant », comme s’il était enfermé dans le présent sans fin de la migration). Entre le présentisme le plus complètement choisi et le plus subi, existent assurément toutes les situations intermédiaires. Mais nous percevons de plus en plus nettement que des temporalités trop désaccordées entre groupes sociaux, classes d’âge ou classes sociales sont porteuses de dangers. La discordance des temps ne produit pas, mais alimente le conflit social. Quand des contemporains partagent le même présent, tout en étant simultanément dans un autre temps, le dénivelé, s’il grandit trop, peut nourrir des mouvements de repli, de refus, de colère. Les distances spatiales entre centre et périphérie sont au moins autant des distances temporelles. Depuis quelques années, l’Europe en fait presque quotidiennement l’expérience, avec les traductions politiques que l’on voit.
Aussi entend-on, ici et là, des appels à sortir du présentisme ou du court-termisme (terme emprunté à la finance) et à rouvrir l’histoire. S’opère une prise de conscience que cette bulle si en phase avec l’économie globalisée – celle d’un capitalisme financier et des grandes entreprises du net, pour qui chaque instant (même de l’ordre de la milli-seconde) doit générer des profits – est porteuse de dangers sérieux. Mais en finir avec le présentisme ne se décrète pas ! D’autant moins qu’en régime présentiste, le temps historique, tel que nous le connaissions, patine ou n’embraye pas. Le temps historique, porté par le futur, s’alimentait, en effet, de l’écart entre le champ d’expérience et l’horizon d’attente (pour reprendre les catégories de Reinhart Koselleck), – et un écart qui allait en augmentant plus l’attente l’emportait sur l’expérience. Or ce temps-là non seulement n’a plus cours mais on ne voit pas comment il reprendrait son cours dans le monde qui se dessine depuis le début du XXIe siècle. Rouvrir l’histoire passe par la formation d’un nouveau concept d’histoire qui, tout en récusant la tyrannie du présent, puisse rétablir une véritable circulation entre les trois catégories du passé, du présent et du futur et permettre ainsi de vraiment faire face au présent pour agir sur lui.
Le futur, d’abord perçu comme fermé ou se fermant (nos enfants vivront moins bien que nous), s’est mué de plus en plus en un futur menaçant (un temps de catastrophes). Venu du vocabulaire littéraire, la catastrophe est ce qui vous tombe dessus, un malheur et un renversement soudains. Face à elle, semble compter plus l’immédiateté de la réaction que la prévention. On mesure le temps qu’il a fallu aux responsables politiques pour venir sur les lieux mêmes (souvent pour « s’indigner » d’un délai perçu comme excessif). Puis, l’effacement de traces et le travail de deuil, quand il y a des victimes, doivent commencer aussi vite que possible. Mais avec les récents attentats terroristes, ce traitement présentiste-instantanéiste de la catastrophe rencontre sa limite, puisqu’ils ouvrent sur un présent qui dure, un présent traumatique qui, pour les survivants et leurs proches, est arrêt du temps. Une commémoration officielle ne peut suffire à le remettre en marche (d’autant moins que le temps du présentiste passe, mais ne « marche » pas).
Notre bulle présentiste a rencontré une menace d’autant plus grave qu’elle est portée par un temps radicalement nouveau, auquel nous ne savons pas comment faire face : celui de l’anthropocène.
On conçoit que, face à un futur gros de menaces, le régime présentiste permette la réactivation de schémas apocalyptiques ou millénaristes : films, séries, livres en témoignent. Cette industrie se porte bien. Si le moment est bon pour les prophètes de malheur (un malheur en général pas complètement sans retour), il l’est aussi pour les prophètes de bonheur, gourous et autres coachs, qui vous assurent qu’épanouissement, réussite, dépendent de vous et sont à portée de main : ici et tout de suite.
Depuis peu enfin, notre bulle présentiste a rencontré une menace d’autant plus grave qu’elle est portée par un temps radicalement nouveau, auquel nous ne savons pas comment faire face : celui de l’anthropocène. En effet, nous savons depuis peu que l’humanité est devenue une force géologique. Son activité a un impact sur ce que les scientifiques appellent désormais le Système-Terre. La manifestation la plus sensible en est le réchauffement climatique. Or le temps de la planète est sans commune mesure avec le temps de l’histoire, celui que nous avons produit pour notre propre usage, quand nous l’avons séparé de celui de la Nature. Il est celui grâce auquel nous avons construit nos récits, donné sens à nos actions et rythmé la marche des peuples. Mais il ne s’agit que de quelques siècles, face à des millions et des millions d’années.
Faire face au présent, c’est commencer par s’employer à en sortir pour en saisir la trame et la texture. Ce premier mouvement, toujours nécessaire, ne suffit plus, car il faudrait désormais, non seulement s’extraire de la bulle présentiste, mais aussi pouvoir regarder, cette fois, la Terre comme si on la voyait de l’extérieur ou depuis l’espace. Un exercice de regard éloigné plus difficile, mais la lucidité face au présent est à ce prix.
Ce texte, commandé par AOC, est publié en prélude à La Nuit des idées, manifestation dédiée le 31/01/2019 au partage international des idées, initiée et coordonnée par l’INSTITUT FRANÇAIS. Toute la programmation en France et dans le monde sur lanuitdesidees.com.
