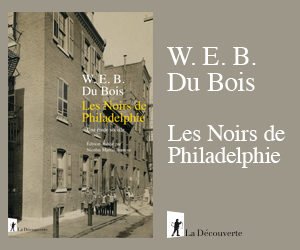Devenir étranger dans un monde en mouvement
En Europe, depuis les années 2000 et plus sensiblement depuis 2015, le drame des migrants aux frontières n’a cessé d’augmenter. Les gouvernements ont voulu se montrer protecteurs à l’égard de leurs citoyens en désignant les migrants comme une menace pour la sécurité et l’identité des pays.
Les murs, les expulsions, les contrôles de masse, la présence dissuasive de la police, la fermeture des ports aux bateaux de sauvetage… seraient censés rassurer des habitants apeurés, citoyens prêts à céder une part de leur propre liberté face au spectre de l’étranger dangereux, prédateur, profiteur, quitte à le priver, lui, des droits humains que nos pays considèrent pourtant comme universels, voire à le laisser mourir.
Si l’on connaît dans chaque recoin du monde la photo du petit Aylan qui ressemble tant à mon enfant, aimé, endormi, recroquevillé, le 3 septembre 2015 sur une plage turque, on connaît moins ou on ressent moins fortement ce que signifie le chiffre de 35 000 morts entre 2000 et 2018 en Méditerranée – cette mer qui nous est commune, Mare Nostrum, commune aussi à l’Europe, l’Afrique, et au Proche-Orient. Qu’avons-nous fait pour accepter de vivre à côté de cette hécatombe quotidienne dont l’histoire se souviendra ?
La Méditerranée, le Sahara, le désert mexicain, le golfe du Bengale sont devenus des tombeaux de l’universel, la preuve physique d’un dérèglement anthropologique global. C’est ce dérèglement qui doit nous occuper, nous inquiéter, nous faire peur oui : une partie de l’humanité est négligeable, oubliable, sacrifiée sans être jamais sacrée (comme Agamben l’a désigné par le nom de Homo Sacer), moins humaine donc comme si nous revenions au temps de la colonisation européenne du monde, au XVe siècle lorsque les Blancs se demandaient si les Amérindiens et les Noirs avaient une âme humaine. Comment est-ce possible ? Comment l’étranger peut-il être à ce point radicalement autre (radical, de radix : la racine) ?
Telle est la question à laquelle je vous propose de réfléchir, et pourtant en la dépassionnant, sans vous dire ce que certains clament, qu’il n’y aurait pas de frontières, ou qu’il faut les supprimer, et que personne n’est étranger sur la planète. Au contraire, ma réflexion part, non d’une utopie mais d’un constat, celui qui dit que nous sommes toutes et tous de plus en plus souvent étrangers dans le monde, en étant confrontés de plus en plus souvent à toutes sortes de frontières, administratives et géopolitiques, sociales, linguistiques, religieuses, et c’est comme cela que nous participons à ce monde tout en mouvement. Selon les cas, nous les passons ou restons bloqués, et c’est ce qui m’amène à interroger : comment devenons-nous étranger et comment cessons-nous de l’être ?
On pourrait dire que l’on naît tous étrangers, c’est-à-dire qu’on le devient dès qu’on « arrive au monde ».
Hospitalité et hostilité sont les deux faces d’une même question (Jacques Derrida évoquait l’« hostipitalité »). Cette proximité crée un inconfort, un malaise, elles interpellent toutes deux la figure de l’étranger en tant qu’« intrus » : « il faut qu’il y ait de l’intrus dans l’étranger, sans quoi il perd son étrangeté, nous dit Jean-Luc Nancy. Accueillir l’étranger, il faut bien que ce soit aussi éprouver son intrusion. Le plus souvent on ne veut pas l’admettre […]. (Une) correction morale suppose qu’on reçoit l’étranger en effaçant sur le seuil son étrangeté : elle veut donc qu’on ne l’ait point reçu. Mais l’étranger insiste, et fait intrusion. C’est cela qui n’est pas facile à recevoir, ni peut-être à concevoir »[1].
Pendant et au-delà du geste premier de l’hospitalité, la conception que chacun se fait de l’étranger est expérimentée, éprouvée, et chaque jour transformée. L’hôte-sse qui reçoit l’étranger peut mesurer lui-même très concrètement différents régimes et degrés de l’étrangeté de l’autre. C’est à partir de cette position, d’une anthropologie non de l’étranger mais de la relation qui se noue (ou pas) entre « moi » et « l’étranger », entre « nous » et les migrants, que je voudrais mener cette réflexion. Etranger oui, mais de quelle façon, et étranger à quoi ?
Pour l’anthropologue Julian Pitt Rivers[2], la question est : comment fait-on de l’étranger un hôte ? Et il évoque différents rituels, règles de lieux, temporalités, échanges. Mais en Andalousie dans les années 1950, l’étranger est celui qui vient du village d’à côté, et dans la province de Turin au XVIIIe (pour l’historienne Simona Cerutti), l’étranger vient de la ville ou de la province voisine, et l’historienne ajoute : l’étranger n’est pas nécessairement un « autre culturel »[3] . À l’inverse, en France aujourd’hui, comme en Italie, certaines personnes de couleur sont de nationalité française, ou italienne, et cependant traités comme les étrangers les plus radicaux, voire étrangers à l’espèce humaine, le racisme étant – par sa lecture biologique du social – la forme la plus exacerbée du rejet.
Répondre à la question « qui est l’étranger ? » n’est donc pas du tout une évidence. Il vaut mieux se demander comment on devient étranger. On pourrait dire qu’on ne « naît pas » étranger et qu’on le devient sous certaines conditions, bien sûr, et tout autant on pourrait dire que l’on naît tous étrangers, c’est-à-dire qu’on le devient dès qu’on « arrive au monde ».
Ce serait une première manière de déranger nos certitudes : savoir qu’on devient étranger dès l’instant de la naissance quand on sort du ventre maternel chaud et obscur pour d’un coup « venir à la lumière », « arriver au monde » et dans un cri découvrir l’hostilité ou l’hospitalité de l’air, des regards et des bras qui accueillent, et toute la vie consiste ainsi pour chacun à essayer d’être un peu moins étranger au monde, c’est ce qu’on appelle la socialisation des enfants. Mais si cela est vrai, et le plus profondément anthropologique, je vous propose quand même d’accélérer et d’arriver plus vite à ce qui nous questionne aujourd’hui, particulièrement en Europe, lorsque nous voulons réfléchir à nos rapports aux migrants. Cela consistera à déconstruire et reconstruire la condition d’étranger.
Alors, comment devient-on étranger ? En arrivant d’ailleurs, de dehors, et en dérangeant, même sans le vouloir, un ordre de places établi quel qu’il soit : l’ordre de la maison, du village, du quartier, de la ville, de l’État. Là, c’est l’extériorité qui fait l’étranger en tant que celui qui arrive (outsider en anglais, qui vient de dehors).
On devient étranger en franchissant une frontière administrative, institutionnelle, légale : c’est l’extranéité qui fait l’étranger (foreigner en anglais), celle ou celui qui est défini par son rapport (ou absence de rapport) à l’État du lieu dont il est étranger, et qui a besoin de droits pour, pas à pas, se rapprocher de la citoyenneté.
Nous devenons étrangers lorsque nous quittons ce qui nous est familier et découvrons un monde autre où tout semble étrange, et où tout est à réapprendre : c’est l’étrangeté relative de l’étranger (stranger).
J’ai déjà évoqué un état « radicalement » autre, c’est-à-dire autre à la « racine », en apparence à la limite de l’humain voire aliéné à un tout autre monde, ce qui rend possible son invisibilité, à partir de laquelle se libèrent les pires fantasmes, la fiction voire la science-fiction de celui ou celle que nous ne connaissons pas : c’est la radicalité de l’étranger absolu (l’alien). Je vais détailler un peu chacune de ces conceptions de l’étranger, ce qui devrait permettre à chacun-e de se reconnaître dans ces portraits, alors même que je parle d’étrangers.
L’outsider est décrit à travers une représentation géographique qui peut parfois devenir déshumanisante, à force de flux, flèches, stocks, et de limites spatialisées.
L’étranger qui arrive, l’outsider, est d’abord le simple nom d’une extériorité, il incarne la mobilité en général (le voyage, le monde) et un « dehors » indéterminé. Cette acception du terme est sans doute celle que nous voyons le plus aujourd’hui : c’est celle ou celui qui vient d’ailleurs sans que nous nous connaissions déjà, d’une manière ou d’une autre. L’outsider est décrit à travers une représentation géographique qui peut parfois devenir déshumanisante, à force de flux, flèches, stocks, et de limites spatialisées.
Cette définition évoque l’extériorité, en relation avec l’établi, les notions d’espace, lieu et territoire sont d’abord convoquées. De la manière la plus technique qui soit, pourrait-on dire, l’étranger qui arrive est un « intrus » qui, tel un corps étranger, impose sa présence en plus de l’agencement établi des choses, des places et des personnes. Il doit trouver une place dans un ordre local déjà existant avant son arrivée. Avec Jean-Luc Nancy, nous pouvons redire que nous aurions tort de lui nier cette intrusion qui le rend immédiatement et de toute évidence étranger.
Celui ou celle qui est établi quelque part regarde celles et ceux qui arrivent comme des étrangers, des outsiders : le mystère est total, on ne sait pas de quel pays, de quel village voisin, de quelle langue et culture ils arrivent. Et l’étranger qui vient est, de son côté, celui qui est et aura été ne serait-ce qu’une fois cet intrus, et qui gardera toujours une trace physique, linguistique, sociale, psychologique, mémorielle, de son extériorité première, peut-être ancestrale voire oubliée après plusieurs génération.
La version identitaire de cette géographie de l’outsider exacerbe cette définition-là de l’étranger, qui peut sembler d’abord la plus neutre, en la référant au territoire et à la fiction d’autochtonie. Un peu partout des oppositions font référence à l’inscription territoriale des uns et à l’intrusion physique des autres, où l’on retrouve des éléments naturalisants et biologisants : on parle d’« autochtones » (« sortis de la terre ») et « étrangers » selon les termes utilisés en Europe ; de « peuples autochtones » et de « colons » dans l’histoire des Amériques ; ou encore d’« autochtones » et d’« allogènes » (« issus d’autres gènes ») en Afrique de l’ouest aujourd’hui. Mais les contextes historiques sont déterminants et donnent un sens parfois inversé aux mêmes mots (par exemple l’autochtonie en Europe et aux Amériques). La complexité s’accroit alors que la mobilité se développe dans le monde et nous confronte tous à ce statut d’outsider. Si nous bougeons d’avantage alors nous sommes de plus en plus outsiders. Mais cela ne signifie pas automatiquement être étrangers dans les deux autres dimensions du devenir étranger, notamment celle du droit, que je vais évoquer maintenant.
Une deuxième conception de l’étranger est celle de l’appartenance ou plus exactement du « défaut d’appartenance »[4]. C’est le défaut d’appartenance à tel groupe familial ou clanique, telle communauté villageoise, telle province, ville ou enfin aujourd’hui à tel État national, qui détermine les différents degrés d’extranéité de l’étranger en tant que foreigner.
La condition d’étranger déterminée par l’extranéité est modulable, flexible. Nous le voyons grâce à l’enquête de l’historienne Simona Cerruti dans les archives de la ville de Turin aux XVIIe et XVIIIe siècles (la ville faisait alors partie des États savoyards). Etranger, dit-elle, est une condition, non une identité. C’est même une « condition provisoire » dans la vie d’un individu qui dépend de son degré d’extranéité, c’est-à-dire « le fait d’être étranger à un ordre social et à l’autorité qui le gouverne » ou encore étranger à une « communauté » villageoise ou urbaine. L’extranéité, du point de vue du droit, est l’ensemble des règles qui déterminent les droits dont jouissent les étrangers dans le pays d’accueil.
C’est bien la question de l’accès des étrangers aux droits d’un lieu dont ils n’ont pas la nationalité : droit civique, droit de propriété, droit de travailler, etc. On sait que selon les pays, ou selon la nationalité des étrangers, certains de ces droits existent ou non. Le « défaut d’appartenance » est variable sur une échelle définie par le fait d’avoir certains droits et devoirs au regard de ceux de l’appartenance complète, qui est celle du « citoyen ». Les étrangers ce sont donc des individus dont la citoyenneté est incomplète. C’est ce que montre le « droit d’aubaine » donné au prince sur l’étranger dans les États savoyards au XVIIIe siècle. Sous certaines conditions, le gouvernement d’une province a le droit de s’approprier les biens d’un étranger décédé sur son territoire.
La question posée est la possibilité de l’insertion, c’est-à-dire de faire une place à l’étranger dans le corps social. On trouve ce sens dans l’anglais foreigner, comme je l’ai dit, et aussi dans l’espagnol forastero ou encore le français forain : en vieux français, le forain est « l’étranger au village », « la personne qui n’est pas du lieu », puis finalement le marchand forain. L’appartenance ne se résume pas à une question de Droit, juridique, mais se réfère plutôt à celle des droits, considérés du point de vue plus généralement sociologique, celui de la place de l’étranger dans telle ou telle organisation sociale. C’est par exemple la figure du marchand telle qu’on peut la décrire dans les recherches sur les commerces à longue distance dans l’Afrique précoloniale : celui qui n’est pas membre d’un groupe social est celui qui peut faire du commerce, parce qu’il n’est pas pris dans les cycles locaux d’échange, pas pris dans les cycles de don et contre-don, il peut donc recevoir de l’argent contre les objets-marchandises qu’il fournit.
L’étranger commerçant est une fonction essentielle de l’existence des sociétés africaines, je l’ai étudié dans le fonctionnement contemporain d’une diaspora marchande, celle des commerçants haoussa en Afrique de l’Ouest, organisés de manière transnationale. Or, ce qui m’a paru aussi intéressant que l’existence d’une organisation sociale du groupe étranger commerçant, c’est la progressive transformation de la place des individus dans le groupe, dans la ville (en l’occurrence à Lomé, capitale du Togo) et dans le pays. Lors de mes enquêtes, plus de la moitié de ces « étrangers haoussa » était nés à Lomé et c’était le cas des trois quarts des moins de quarante ans, qui n’avaient aucune connaissance de leur pays d’origine, parlaient le français et l’éwé (langues officielles du pays et de Lomé), poursuivaient des études et se mariaient plus souvent que les anciens en dehors du groupe étranger.
Etre étranger n’équivaut pas à une absence de relations, loin de là. Se marier hors du clan, faire du commerce hors du cycle d’échanges, exercer certains métiers spécifiques : en Afrique précoloniale ou contemporaine, comme à Turin sous l’Ancien régime, il y a un besoin de cet étranger-là, le foreigner et celui-ci connaît une condition changeante.
C’est une figure d’étranger très moderne et urbaine, comme l’a montré le sociologue Georg Simmel, il peut être arrivé hier et ne pas repartir demain mais il n’a pas perdu sa « liberté d’aller et de venir ». Cette liberté peut fonder une culture propre, distinctive, c’est-à-dire un ethos de l’étranger, une condition faite culture en quelque sorte, j’y reviendrai un peu plus loin.
Mais restons encore un moment sur cette dimension-là de la condition d’étranger, l’extranéité, qu’on a évoqué du point de vue du droit ou de la politique. Simmel, lui, évoque « la forme sociologique de l’étranger » qui associe mobilité et liberté[5]. Cette liberté, c’est un peu le côté positif du « défaut d’appartenance » que je viens d’aborder. Plus encore, l’étranger dans ce cas n’est plus nécessairement extérieur. Il est bien là dans la société, dans la ville, mais en tant que « voyageur potentiel », position très singulière de l’étranger qui peut bien être un élément du groupe lui-même mais dont l’appartenance (ou le déficit d’appartenance) prend la forme d’une apparente extériorité ou d’une trace d’extériorité. Plus encore, Georg Simmel explique que l’absence de « lien organique » (parental, local, professionnel) permet « l’objectivité de l’étranger ». Et il prend l’exemple, lui aussi, des villes italiennes d’autrefois qui « faisaient appel à des juges venus d’ailleurs, dans la mesure où aucun citoyen n’était suffisamment libéré de ses attaches familiales, ni de ses intérêts factieux » pour pouvoir juger en toute objectivité, en toute liberté. Objective, libre, intermédiaire, entre-deux, la participation particulière de l’étranger est « semblable à l’objectivité de l’observation théorique » avance même le sociologue.
Toujours un peu décentré, l’étranger occupe donc une position de connaissance en occupant la place de l’observateur, pour qui la frontière peut être une « méthode » (c’est le sens de « border as a method » de Sandro Mezzadra et Brett Neilson, 2013). Mais la position est risquée. L’étranger peut toujours être considéré comme l’émissaire du « parti de l’étranger », on lui reprochera son manque de loyauté. On voit l’imbrication avec la dimension culturelle et anthropologique de l’étranger, que je voudrais aborder maintenant.
Une troisième composante de la définition de l’étranger, en effet, est une relation qu’on dit interethnique ou interculturelle, elle évoque l’altérité, elle correspond à la double étrangeté du stranger de la langue anglaise : la mienne vis-à-vis des autres et celle des autres pour moi l’étranger, autrement dit, elle concerne tout ce qui ne nous est pas familier : « People are strange when you’re a stranger » chantait Jim Morrison. Et inversement, tout semble étrange dans l’attitude d’un étranger. La tentation de figer, essentialiser, « ethniciser » cette étrangeté est grande, nous l’observons aujourd’hui en Europe : c’est une attitude quelque peu paresseuse, qui se contente de clichés, stéréotypes faciles, et refuse tout le bénéfice de la relation, de l’échange. C’est tout l’inverse que nous adoptons ici.
Si l’on élargit au-delà de la différence linguistique ou ethnique, on accède à ce qu’on appelle généralement l’altérité culturelle, mais celle-ci n’est jamais donnée une fois pour toute, c’est pourquoi je préfère la regarder comme une « étrangeté relative »[6], en transformation constante. Mon anthropologie ne nie pas l’intérêt de l’analyse structurale, mais elle veut faire une place essentielle au mouvement, aux dynamiques du changement.
Je voudrais brièvement rappeler un exemple new yorkais, celui du sociologue juif autrichien Alfred Schutz, exilé en juillet 1939 aux États-Unis, où il s’installe avec sa famille et vivra jusqu’à son décès vingt ans plus tard. Lui, l’émigré sociologue, s’aidera de sa propre expérience pour réfléchir à la phénoménologie de l’étranger, c’est-à-dire aux ajustements, interprétations et apprentissages que vit partout l’étranger. Il s’intéresse à la façon dont des modèles culturels se croisent et se superposent, en partie, pour engendrer une nouvelle « manière de penser habituelle », syncrétique, singulière. Car l’étranger arrive dans la nouvelle situation avec une manière de penser qui lui semblait évidente et naturelle, et il doit s’orienter dans un « nouveau modèle culturel » (langue, mœurs, lois, folklore, modes, etc.), il doit le comprendre pour l’utiliser. C’est l’étranger dans son labyrinthe.
Si l’on veut garder cette image de l’altérité du stranger sans la ramener à une identité ethnique déjà donnée, en essayant au contraire de la généraliser et de l’universaliser, on dira que la meilleure définition de cette étrangeté, c’est en effet le labyrinthe, c’est-à-dire la difficile épreuve de comprendre un nouveau lieu et savoir vivre et agir avec ses règles. De cette épreuve, l’étranger tire deux caractères fondamentaux, d’une part l’objectivité et l’« intelligence du monde » (il a découvert que « la manière de vivre normale est loin d’être aussi assurée qu’il y paraît »), d’autre part, encore, une « loyauté ambiguë » : réticent ou incapable de substituer entièrement un modèle culturel par un autre, l’étranger est un « hybride culturel qui vit à la frontière de deux modèles différents de vie, sans savoir vers lequel il doit aller[7] ».
Ces épreuves sont aujourd’hui bien plus nombreuses qu’au temps des digressions des sociologues Schutz et Simmel. Dans un cadre de plus en plus souvent cosmopolite où chacun se trouve impliqué, le partage entre l’étrangeté et la familiarité représente une épreuve habituelle. Des « situations de contact » étudiées par les ethnologues à l’époque coloniale lors de l’étude de groupes humains qui n’étaient pas réellement isolés, on est en train de passer aujourd’hui, dans le monde de la globalisation, à une généralisation des situations de frontière. C’est comme si l’on était toujours en train de découvrir quelque chose qui nous est étrange, quelqu’un qui nous étranger. C’est cela qu’il nous faut penser, et aussi accepter, et bien sûr, ce n’est pas facile. Penser cette condition d’étranger dans toute sa complexité et sa dynamique constante, peut nous aider non seulement à l’accepter mais à tirer de cette relation toute la richesse qu’elle nous apporte.
L’imaginaire esthétique et politique construit l’alien comme un « autre » absolu, radical qui n’est rien d’autre que nous-mêmes au plus bas du droit à la mobilité, des des droits civiques, de la relation culturelle.
Les trois définitions de l’étranger que j’ai décrites – l’extériorité de l’outsider, l’extranéité du foreigner, l’étrangeté du stranger – renvoient donc à trois frontières – géographique, sociopolitique, culturelle – régulièrement rencontrées dans nos vies, dès lors que nous nous déplaçons, par plaisir ou par nécessité voire urgence. Nous sommes tous amenés à vivre cette condition d’étranger, comme une séquence plus ou moins longue et provisoire de nos vies. Notre identité ne se réduit pas à cette condition provisoire et changeante, mais elle est travaillée par elle et devient plus hybride au long de ces épreuves d’étrangeté. Cette condition d’étranger, qui est, dans ce sens et malgré le paradoxe apparent, autant universelle que relative, est une combinaison toujours singulière, de ses trois « parts » que j’ai évoquées – géographique, sociojuridique, culturelle.
Imaginons maintenant, le long de chaque part ayant la forme d’un axe, un curseur qui se déplacerait vers le bas ou le haut : pour ce qui concerne l’extériorité, il irait depuis le confinement extraterritorial, les camps, les centres de rétention (au plus bas) jusqu’à l’ouverture des espaces, la libre circulation sur toute la planète (au plus haut) ; du point de vue de l’extranéité, il naviguerait depuis le déficit total de droits d’appartenance (au plus bas) jusqu’à la pleine citoyenneté (haut) ; et dans le cas de l’étrangeté, il irait de l’invisibilité extrême de sa personne et de sa culture (le bas) à la pleine reconnaissance et compréhension par et avec les autres (haut). La plus ou moins grande intensité positive ou négative de chacune de ces trois conceptions, et la combinaison entre elles, déterminent et relativisent les différentes représentations, les contextes et le traitement de chaque personne étrangère dans le monde contemporain.
Chacun ou chacune peut se situer à sa guise et selon ses expériences, sur un gradient ou l’autre de chacun des trois axes de la condition d’étranger – être plus ou moins chez soi partout, avoir plus ou moins de droits dans tous les pays, rencontrer plus ou moins de reconnaissance culturelle partout sur terre.
Si l’on pousse les trois curseurs vers le haut de chaque axe, on atteint la vie bonne et heureuse du citoyen du monde partout sur terre, une vie que personne ne connaît encore intégralement mais qu’on imagine bien (surtout quand on est, par exemple, blanc, européen, mâle) : ce serait la forme concrète de cette utopie cosmopolitique portée depuis le siècle des Lumières.
Mais si chacun peut ainsi « monter » le long de cette transformation de l’étranger en citoyen cosmopolite (et donc, si l’on veut, aller vers la disparition de l’étranger au sens où l’on pourrait dire en effet que « personne n’est étranger sur terre »), chacun peut aussi descendre au plus bas des trois axes, selon ses lieux de naissance, lieux de vie, contextes. Ce que je veux suggérer avec cette représentation imagée en axes et curseurs, c’est que nous ne changeons pas de monde et pas même d’identité lorsque les trois curseurs s’effondrent ensemble au plus bas et qu’ils forment la figure inverse mais symétrique à celle du bonheur cosmopolite : c’est celle de l’étranger absolu, invisible, sans droit, bloqué à la frontière, et pouvant même être laissé à mourir.
C’est ainsi que naît une quatrième figure, en forme de spectre ou de fantasme, qu’on peut rapprocher de la fiction de l’alien. L’imaginaire esthétique et politique construit l’alien comme un « autre » absolu et radical. Mais cet autre n’est rien d’autre que nous-mêmes au plus bas du droit à la mobilité, de la reconnaissance des droits civiques, de la relation culturelle.
C’est dans la langue anglaise, l’illegal alien, l’étranger illégal. C’est aussi l’image plus générique d’un alien appartenant à un autre monde, un autre univers, non humain ni terrien.
Tout au fond de cette descente en sous-humanité, se place l’assignation raciale qui serait en quelque sorte le mécanisme le plus rapide et automatique de sa mise en œuvre, de sa « réification ». Ainsi, par exemple, les policiers français qui surveillent les frontières de Vintimille savent qu’ils doivent faire le tri entre les résidents frontaliers ou les touristes d’une part, qui circulent librement (car la ville est au sein de l’espace Schengen), et les migrants indésirables ou les « illegal alien » d’autre part, suspendus dans leur marche en avant entre deux postes-frontières. En plus du visage lui-même – nécessaire mais insuffisant car il peut faire confondre, dans une ville méditerranéenne, l’habitant, le touriste et le vagabond –, c’est le corps de l’étranger indésirable que doivent apprendre à reconnaître les policiers de la frontière. Dans cette opération, qui rejoue à chaque instant l’association entre le « biologique » et le « social », ils mobilisent tout le savoir occidental, postcolonial, sur l’altérité raciale.
Le rejet, l’enfermement et la mort des étrangers tenus pour des aliens sont le contexte, pour beaucoup la honte et l’échec, des Européens d’aujourd’hui.
C’est ce qui nous ramène à cette régression dont je parlais au début, vers le regard de l’Européen du XVe et XVIe siècle, du temps de ses découvertes des autres mondes, se demandant si les Africains et les Amérindiens avaient une âme, s’ils étaient des humains. Voilà comment, à une autre frontière de l’Europe, la frontière externalisée au Maroc, un citoyen américain, Timothy Hucks, a pu se faire arrêter dans une rue de Rabbat, interroger sans fin, maltraiter, embarquer avec une quarantaine de migrants sub-sahariens, puis laisser avec eux dans une rue d’une ville inconnue à la frontière, puis a vécu reclus pendant plusieurs mois dans la peur… parce qu’il était Africain-Américain, et que les policiers marocains, moins experts peut-être en identification socio-raciale que leurs collègues de la PAF (Police aux frontières) française à Vintimille, l’ont pris pour un Noir Africain nécessairement illegal alien, et l’ont traité comme tel.
Timothy Hucks a compris qu’il pouvait passer, sur un coup de dés, par malchance, de la citoyenneté la plus valorisée au monde à la pire condition inhumaine, même s’il est toujours la même personne. Sa conclusion rejoint la mienne. S’il a pu finalement faire valoir ses droits et faire remonter d’un coup son curseur au sommet de l’axe du foreigner, il découvre que nous sommes tous plus ou moins étrangers sur terre : il écrit dans un tweet du 30 août 2019 « Qu’est-ce qui donne le droit à quiconque de traiter de la sorte des personnes qui ne sont pas américaines ? Personne ne devrait être traité comme ça, et quand cela vous arrive, vous ne savez pas pourquoi. Pensez-y avant de réserver votre billet d’avion. »
Entre l’étranger devenant de plus en plus cosmopolite et l’étranger descendant de plus en plus bas dans les ténèbres de l’alien, rien n’est jamais fini, jamais fixé, les curseurs de l’extériorité, de l’extranéité et de l’altérité ne cessent de bouger.
Le rejet, l’enfermement et la mort des étrangers tenus pour des aliens sont le contexte, pour beaucoup la honte et l’échec, des Européens d’aujourd’hui. Chaque jour, les morts en Méditerranée appellent le sauvetage pour lequel d’autres personnes se font hospitalières, en mer et dans les villes, même si toute l’imagination et la mobilisation des habitants ne compenseront pas l’hostilité de leurs États-nations. Que faudrait-il pour faire disparaître ce spectre de l’étranger absolu et radicalisé, l’alien, et lui substituer l’étranger égal en droits par une égale appartenance au même monde ? Rien d’autre que de pousser les trois curseurs vers le haut : plus de liberté de circulation ; plus de droit d’appartenance (jusqu’à l’appartenance à la planète entière, une citoyenneté qui se déplacerait avec les personnes, je l’ai appelée une citoyenneté nomade) ; plus de connaissance et reconnaissance de l’autre et des cultures partagées.
C’est là que l’agir politique doit reprendre la parole, car lui seul peut changer l’horizon des possibles. En commençant par un geste à l’égard de cette Méditerranée que nous connaissons et fréquentons tous et où il faudrait décider de ne plus se baigner tant qu’il y aura des étrangers laissés à la mort dans la même eau, pour lui reconnaître enfin une sacralité qui la sauverait, peut-être encore, du déshonneur.
NDLR : Ce texte afait l’objet d’une version orale lors d’une Lezione magistrale donnée le 14 septembre au festivalfilosofia 2019 (Modena, Carpi, Sassuolo). Il prend un thème plus largement développé dans M. Agier, L’étranger qui vient. Repenser l’hospitalité, Paris, Seuil, 2018. Voir aussi Babels, Hospitalité en France. Mobilisations intimes et politiques (sous la direction de M. Agier, M. Gerbier-Aublanc et E. Masson Diez), Lyon, Le passager clandestin, 2019. Et voir le dossier « Multitude migrante », n°3 de la revue Monde commun, PUF