Le procès Fillon: procès de la Ve République ?
L’ « affaire « Penelope/Fillon » a peut-être changé le cours de la Ve République. Elle a en effet précipité la défaite de celui que d’aucuns voyaient comme le grand favori de l’élection présidentielle de 2017. Ironie de l’histoire, quelques mois avant d’être mis en examen, François Fillon s’interrogeait à voix haute : « Qui imagine le général de Gaulle mis en examen ? ». Il assénait dans le même discours de campagne tenu dans la Sarthe, le 28 août 2016 : « avoir une haute idée de la politique signifie que ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être digne. » Une assertion qui ne l’empêcha pas finalement de confirmer sa candidature malgré sa propre mise en examen, reniant ainsi l’engagement moral qu’il avait également exprimé : retirer sa candidature « si [s]on honneur était atteint, s’[il] étai[t] mis en examen ».
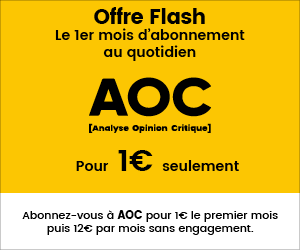
L’ancien Premier ministre comparaît désormais devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est poursuivi pour des chefs d’accusations aussi graves que le « détournement de fonds publics », la « complicité et recel » de ce délit, la « complicité et recel d’abus de biens sociaux », mais aussi le « manquement aux obligations déclaratives de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ». Derrière le procès des actes d’un homme – et de sa femme –, sont convoquées des mœurs politiques d’une Ve République qui vit au rythme de « scandales » et autres « affaires » illustrant la porosité de la frontière entre morale et politique, entre intérêt public et intérêt privé, entre vie publique et vie privée. C’est pourquoi, au-delà de son caractère purement judiciaire, le « procès Fillon » pourrait revêtir une portée symbolique et historique.
Si les scandales politico-financiers retentissants ne sont pas l’apanage de la Ve République[1], le régime a connu un tournant dans les années 1980-1990. Les « années Mitterrand » sont synonymes d’argent-roi, d’argent fou. Les scandales politico-financiers de financement occulte des partis politiques (de l’affaire Urba aux marchés publics de la région Île-de-France) éclatent dans les années 1980 grâce à l’action combinée de la presse et de la justice et mettent en lumière le rapport encore « problématique » entre l’argent et la vie politique : financement opaque/occulte des partis, comptes de campagnes électorales en inflation constante, comptes offshore, emplois fictifs, résidences d’élus, truquages de marchés publics, etc. Si la longue série d’affaires durant cette « décennie de la corruption » a abouti à la condamnation d’importants responsables politiques pour financement frauduleux/occulte de partis politiques[2], des condamnations pour enrichissement personnel sont également à signaler[3]. C’est dans cette longue dérive que s’inscrit l’affaire Fillon.
L’exercice des plus hautes fonctions de la République n’est plus un motif d’impunité de fait.
Ce procès témoigne de tendances de fond de la Ve République, dont la judiciarisation de la vie politique à travers une transformation des rapports entre juges et politiques : les « pratiques traditionnelles de collusion, consistant à fermer les yeux, dont ont pu bénéficier les hommes politiques […] de la part de juges pour lesquels de telles poursuites auraient été impossibles parce que largement impensables. Bien au contraire, tout tend désormais à se passer comme s’il allait de soi pour les magistrats de poursuivre justement ces individus : se mettent ainsi en place des pratiques conduisant […] à mettre en cause des “grands” et à démontrer que personne n’est à l’abri de la loi »[4]. Certes, le nombre de condamnations judiciaires pour des infractions à la probité publique de responsables politiques demeure faible, mais la multiplication des enquêtes judiciaires et les condamnations de M. Juppé (jugé et condamné en 2004 à 14 mois avec sursis et un an d’inéligibilité, pour prise illégale d’intérêt), de M. Cahuzac ou du couple Balkany (pour des affaires de fraude fiscale) sont symptomatiques.
L’exercice des plus hautes fonctions de la République n’est plus un motif d’impunité de fait. Ainsi, Jacques Chirac a été mis en examen dans deux affaires judiciaires, avant d’être condamné, le 15 décembre 2011, – dans un des deux volets de l’affaire des emplois présumés fictifs de la Ville de Paris qui remonte au début des années 1990, quand il était maire de la capitale – à deux ans de prison avec sursis pour « détournement de fonds publics », « abus de confiance » et « prise illégale d’intérêts ». Le tribunal correctionnel de Paris a jugé que « Jacques Chirac a manqué à l’obligation de probité qui pèse sur les personnes publiques chargées de la gestion des fonds ou des biens qui leur sont confiés, cela au mépris de l’intérêt général des Parisiens ». Son successeur Nicolas Sarkozy est le second ancien chef de l’État renvoyé devant un tribunal correctionnel sous la Ve République ; il est en outre impliqué dans une série impressionnante d’enquêtes et de procédures judiciaires liées à l’affaire des « écoutes judiciaires », à l’affaire « Bygmalion », à l’ « affaire du financement libyen » de la campagne présidentielle de 2007, à l’affaire des « sondages de l’Élysée », aux affaires des « frégates d’Arabie saoudite » et « des sous-marins du Pakistan »…
La seconde tendance de fond révélée par le procès Fillon porte sur la baisse de la tolérance sociale à l’égard de la corruption politique et le déficit de probité publique. La société française semble être arrivée à maturité sur ce point, à telle enseigne que l’on assiste à une montée en puissance de l’exigence citoyenne en matière d’exemplarité de son élite politique (l’élite économique étant elle singulièrement préservée). Ainsi, après la révélation des « affaires Fillon », on a assisté à des manifestations exceptionnelles, place de la République à Paris et dans des villes de Province, pour dénoncer la « corruption des élus »[5]. Formes particulièrement véhémentes de protestation, les dernières manifestations de rue contre un scandale de corruption remontaient au début des années 1970. Dans ce contexte, selon une enquête d’opinion[6], 65% des personnes interrogées estiment que l’honnêteté et la probité sont les qualités les plus importantes pour un président de la République, exigence plus marquée dans l’électorat de gauche que dans l’électorat de droite.
Troisième source d’intérêt du procès Fillon : l’insuffisance des réponses juridiques en matière de moralisation de la vie politique.
Ces chiffres montrent une tendance de fond, qui n’est pas purement liée à l’onde de choc des affaires Fillon. Quelques années auparavant, en pleine « affaire Cahuzac », une autre enquête indiquait pour sa part que l’honnêteté faisait partie des qualités auxquelles les citoyens disaient accorder le plus d’importance pour un responsable politique, juste après la compétence ; elle est même aussi importante que la compétence pour les jeunes de moins de 35 ans ; les ouvriers et employés estiment qu’il s’agit de la première qualité exigée[7]. Cette tendance de fond s’inscrit elle-même dans un contexte de forte défiance citoyenne : depuis sa création en 2009, le baromètre annuel de la confiance politique réalisé par le Cevipof (de Sciences Po) montre que les deux premiers sentiments qu’éprouvent les Français à l’égard de la politique sont la méfiance et le dégoût ; de plus, l’honnêteté s’impose comme une qualité impérative à l’endroit des responsables politiques.
Enfin, troisième source d’intérêt du procès Fillon : l’insuffisance des réponses juridiques en matière de moralisation de la vie politique. Si le quinquennat de la présidence d’Emmanuel Macron s’est ouvert par l’adoption des lois organique et ordinaire (du 15 septembre 2017) « pour la confiance dans la vie politique », ces dernières ne comportent guère d’avancées substantielles. La valeur ajoutée de ces textes sur le terrain de l’exemplarité et de l’éthique publiques est toute relative. En témoigne les carences en matière de lutte contre les conflits d’intérêts. Des angles morts et autres insuffisantes qui s’expliquent par le comportement même du législateur. Les lois de moralisation de 2013 (« post-Cahuzac ») et de 2017 (« post-Fillon) sont adoptées dans l’urgence, suivant un réflexe qui consiste pour les politiques à réagir prestement aux dernières affaires en date.
Or l’enjeu suppose des réponses plus structurelles à un problème systémique, plutôt qu’une kyrielle de mesures, purement réactives aux pratiques déviantes mises en évidence, et le plus souvent « contournables ». En attestent la manière dont nombre de parlementaires contournent l’interdiction des « collaborateurs familiaux », ou encore la découverte de la situation de conflits d’intérêts de Jean-Paul Delevoye. Ce dernier a traversé la vie publique de ces dernières décennies en cultivant un art du cumul des mandats électoraux (en nombre et dans le temps) ou publics (en tant président du Conseil économique, social et environnemental notamment), qui se conjuguait lui-même avec le cumul d’activités privées (rémunérées ou non) dans des secteurs particulièrement actifs en matière de lobbying auprès des pouvoirs publics.
C’est pourquoi une grande partie du changement des pratiques politiques se jouent à un niveau métajuridique, culturel. Pour preuve, l’adoption d’un arsenal juridique de plus en plus étoffé en faveur de la transparence et de la moralisation de la vie politique n’a permis ni d’éradiquer les comportements délictueux, ni de rétablir la confiance des citoyens dans les responsables et institutions politiques. En cela, il semble que la juridicisation du politique n’est pas une solution en soi : le législateur aura toujours une loi de retard sur le comportement individuel des responsables politiques. La moralisation comme la confiance politique dépend d’éléments essentiellement d’ordre métajuridique, culturel : le culte du secret et de la figure de l’« homme providentiel » sont autant de freins aux évolutions des pratiques/mœurs politiques. Aucun dispositif de contrôle – même a priori – ne remplacera une culture déontologique et le développement d’une éthique (pratique) en politique.
