Observations sur la fin de la mort par temps de pandémie
Au mois de mars, la mort déboula à une échelle de masse inconnue de nos vies pacifiques puisque l’estimation française porta à 600 000 le nombre de morts possibles du coronavirus si aucun confinement n’était réalisé. Ainsi, durant deux mois, la mort s’affirma, par décrets et ordonnances, comme l’horizon exclusif et enjoignit l’État à ordonner l’exode de la population à la maison. Ce faisant, la vie devint le centre de gravité de la politique et la législatrice de nos existences publiques – ou ce qu’il en restait – comme privées.
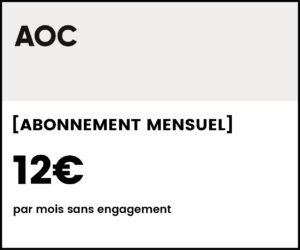
La vie devait faire plier la mort et l’affichage, par l’État, de son mépris soudain pour la croissance économique et ses points de PIB perdus, attestait de sa volonté comme de sa bonne foi. C’est ainsi que la fable de la mise entre parenthèses de l’économie prit corps puisqu’elle passait plus ou moins sous silence ceux qui pourtant travaillaient encore plus dur – chez eux, chez leur patron–, ceux qui, sans salaire ni réserve d’argent, avaient faim – familles populaires, ouvriers sans papiers, étudiants pauvres–, ceux qui rejoindraient Pôle Emploi, ou encore ceux qui mendieraient dans les rues. Mais qu’importe puisque dans le mot survie il y a celui de vie. Ainsi, la vie en tant que « souverain bien[1] » a été l’un des aspects de la séquence le plus commenté. Les analyses comme les critiques se concentraient sur le nouveau statut accordé au vivant, sur l’« étatisation du biologique », « la vie nue » ou encore, la mise en œuvre de la « république des médecins[2] ». La quintessence ou l’exactitude « biopolitique » et foucaldienne de ce moment étatique particulier fut alors, à raison, abondamment soulignée.
La vie mobilisa penseurs et intellectuels mais qu’en a-t-il été de la mort ? Devenait-elle, elle aussi, politique ? La mort n’était-elle que le simple pendant nécessaire et regretté de la vie ou bien a-t-elle été l’objet d’une réflexion particulière ? Les écrits sur la mort n’ont pas été absents mais force est de constater qu’ils furent moins nombreux ; ils se focalisaient, pour la plupart, sur le caractère tout à fait inédit de la suppression des cérémonies funéraires comme sur ses effets dès lors qu’elle annulait la possibilité du deuil de l’être aimé. Si la mort ne contient pas, en puissance, la vigueur analytique et critique d’un concept tel celui de biopolitique, l’on sait, notamment à la lecture de la somme écrite par Ariès, que la mort n’est pas uniquement ce par quoi la vie terrestre et biologique se conclut, ou encore, qu’elle ne se pense jamais de façon séparée de la représentation que l’on se fait, à une époque donnée, de la vie : les deux ne s’appréhendent pas séparément. Ariès en fait l’histoire, une histoire longue sur laquelle je veux revenir un instant du fait de son étonnante actualité comme de l’apport qu’elle constitue pour qui souhaite penser la mort aujourd’hui.
La mort n’a jamais été un phénomène neutre et toujours été considérée comme un mal-heur.
Ariès fait débuter cette histoire avec l’Antiquité romaine qui, refusant tout contact avec les morts considérés comme impurs, édifie ses cimetières en dehors des villes ou le long des voies fameuses telles que la via Appia à Rome : « trop proches » nous dit Ariès, ces morts « risquaient de souiller les vivants. Le séjour des uns devait être séparé du domaine des autres afin d’éviter tout contact, sauf les jours des sacrifices propitiatoires. » À cette « intolérance aux morts » succéda, du Ve au XVIIIe siècle, « une résignation naïve et spontanée au destin et à la nature », une longue séquence caractérisée par une « même familiarité indifférente à l’égard des sépultures et des choses funéraires », un « rapprochement des vivants et des morts » attesté par « la pénétration des cimetières dans les villes ou les villages, au milieu des habitations des hommes. » Cette séquence se clôt lorsque « cette promiscuité n’est plus tolérée. »
La mort, hier, « apprivoisée », est rendue à son « état sauvage », les codes existant autrefois pour « manifester aux autres des sentiments généralement inexprimés, pour faire sa cour, pour mettre au monde, pour mourir, pour consoler les endeuillés » n’étant plus en usage. Cet « ensauvagement » de la mort, ou « mort inversée », est contemporain du plein essor du rationalisme scientifique puisqu’il débute à la fin du XIXe siècle pour se poursuivre tout au long du XXe siècle. Ce processus résulte, nous dit Ariès, de l’expulsion de la mort de nos espaces sociaux dès lors qu’elle disparaît derrière la maladie, le malade d’aujourd’hui ayant pris la place du mourant d’hier. C’est selon cette logique que l’Église d’après Vatican II (1965) substitua au nom traditionnel de l’extrême-onction celui de « sacrement des malades ».
Hier publique et ritualisée, la mort se fait clandestine et dissimulée, assignée à l’hôpital où elle ne surgit plus qu’en termes d’« accident » ou de « maladresse ». La mort est l’objet d’un déni, le mot devient tabou et le deuil, considéré désormais comme un « drame personnel », se pare d’indécence. En effet, ce n’est plus la communauté qui se considère comme affectée par la perte de l’un des siens mais le seul individu que dorénavant l’on évite. Le deuil se trouve alors réduit à la peau de chagrin d’un processus individuel, solitaire et purement psychique où le « travail de deuil » prescrit par Freud dans Deuil et Mélancolie (1917) s’est substitué aux rites collectifs antérieurs. Des rites, nous dit Ariès, qui avaient précisément pour but de ne pas laisser la mort « à elle-même et à sa démesure », mais, au contraire, à « l’emprisonner dans des cérémonies, transformée en spectacle. »
L’exploration d’Ariès, si elle traverse les millénaires, établit que les attitudes face à la mort n’ont pas été si nombreuses au fil des siècles ; elles se comptent sur les doigts d’une main. Plus encore, il établit une constante : la mort n’a jamais été un phénomène neutre et toujours été considérée comme un mal-heur : « La mort peut bien être apprivoisée, dépouillée de la violence aveugle des forces naturelles, ritualisée, elle n’est jamais éprouvée comme un phénomène neutre. Elle reste toujours un mal-heur. Cela est remarquable dans les vieux langages romans, la douleur physique, la peine morale, la détresse du cœur, la faute, la punition, les revers de la fortune s’expriment par le même mot dérivé de malum, soit seul, soit associé avec d’autres ou modifié, comme le malheur, la maladie, la malchance, le Malin. »
La pandémie récente n’a-t-elle été qu’une inflexion du cadre proposé par Ariès ou bien a-t-elle été le théâtre d’un nouveau régime de mort ? Avons-nous assisté à un dédoublement du mourant entre, d’un côté, le malade – hospitalisé et soigné – et, de l’autre, le vieillard – laissé trop souvent à sa mort en Ehpad ? La conception de la vie à l’œuvre durant la pandémie a-t-elle eu des effets sur notre conception de la mort et, par conséquent, sur son traitement ? Telles sont les hypothèses à partir desquelles nous nous proposons d’examiner quelques aspects de la période actuelle. En effet, si Ariès nous dit que, aujourd’hui, « la société de masse » est dressée « contre la mort » en éprouvant à son endroit « plus de honte que d’horreur », au point de « faire comme si la mort n’existait pas », la mort, je crois, n’avait encore jamais été traitée, pour elle-même, en tant qu’ennemi public et politique.
Traiter la mort en ennemi, c’est exactement ce que fit le président de la République française lorsque, le 16 mars 2020, il déclara le pays en guerre contre elle. Si son assertion peut être qualifiée d’extraordinaire c’est que, sans doute pour la première fois de l’histoire de l’humanité, un État ne déclarait rien de moins que la guerre contre la mort ; le Président l’affirmait, elle ne passerait pas par nous. Dans ce combat opposant la vie et la mort, cette dernière ne l’emporterait pas et le pays se figea d’un bloc dans un sauve-qui-peut sa vie, laissant à l’abandon ceux qui n’avaient pas les moyens de suivre. Outre ses morts, la guerre avait ses « rescapés » et ses « survivants » car tels étaient nommés, dans la presse, les convalescents de la maladie. Cette guerre contre la mort – donc pour la vie – régla nos mouvements à un point tel que le Conseil d’État demanda sans ciller au Gouvernement de clarifier sa position sur l’usage de la bicyclette durant la période de confinement ; ce qu’il fit. Et l’on se mit à souhaiter que jamais il n’y ait d’épidémie plus létale, de guerre ou de mort de masse véritable.
Attentat ou pandémie, la mort est considérée par l’État comme un ennemi de la vie, péril battant en brèche le déni dont elle est d’ordinaire l’objet.
Que la vie ait la mort pour ennemi n’est pas, en France, une chose tout à fait inédite puisque c’est ce que François Hollande déclara au lendemain des attentats du 13 Novembre ; il ne déclara pas explicitement la guerre à la mort mais affirma que l’ennemi des terroristes, c’était la vie, notre vie : « Jamais ils ne nous empêcheront de vivre, de vivre comme nous en avons décidé, de vivre pleinement, de vivre librement. » Quel autre « crime » avaient commis les victimes du Bataclan si ce n’est précisément « d’être vivants » voire, comme il le dira quelque jours plus tard, d’incarner « la vie », raison pour laquelle ils furent assassinés ? Si Hollande ne déclara pas aussi explicitement la guerre contre la mort, l’antagonisme opposait néanmoins bien la vie à la mort selon une dualité essentialisée : « Que veulent les terroristes ? Nous diviser, nous opposer, nous jeter les uns contre les autres. (…) Ils ont le culte de la mort, mais nous, nous, nous avons l’amour, l’amour de la vie. »
Tout oppose, dans un pays en paix comme la France, l’exception de la mort par attentat et la généralisation de la mort par pandémie : l’attentat est solitaire, exceptionnel, intentionnel, culturel et politique ; la pandémie est générale, virale, biologique, apolitique, indéterminée, historique, naturelle. Si tout oppose ces deux régimes de mort, leur traitement politique contemporain n’est pas sans résonance : la mort n’est-elle pas, dans les deux cas, un surgissement impromptu et violent déréglant pareillement un espace social et culturel devenu inapte à l’inclure et à la traiter ? En effet, si les morts pathologiques de masse ne sont pas exceptionnelles, elles sont invisibilisées et/ou routinisées en étant absorbées par l’espace hospitalier[3]. Mais la contagiosité de la pandémie rompit les digues du champ médical et la mort se déversa au cœur de l’espace public ; chacun se trouva être désigné comme vecteur ou cible potentielle.
Apparemment, le lent mouvement d’extrapolation de la mort décrit par Ariès connaissait une inflexion temporaire mais notable ; apparemment car elle ne fit en réalité que consolider et amplifier son déni. En effet, attentat ou pandémie, la mort est considérée par l’État comme un ennemi de la vie, péril battant en brèche le déni dont elle est d’ordinaire l’objet. Morts d’attentats ou morts de pandémie, elles sont une même anomalie, des morts de trop en ce qu’elles auraient pu ne pas avoir lieu là où pourtant le grand irréversible a déjà frappé ; il en allait ainsi du décompte journalier et morbide, lors des mois de confinement, des morts nationales et mondiales, ce chiffrage nous disant en substance qu’elles auraient pu être évitées. Tel semble être aujourd’hui plus largement le message de l’État lorsque, par exemple, au mois de juillet, à la suite d’un accident de voiture absolument tragique coûtant la vie à cinq enfants sur l’autoroute A7, le président de la République et le Premier ministre firent des déclarations publiques tandis que les ministres de l’Intérieur et des Transports se rendirent sur place. In fine, l’évitement supposé de la mort, la proclamation de son caractère évitable, renforcent son déni tout en lui donnant une forme nouvelle.
Mon hypothèse est peut-être hardie mais je dirais que cette guerre contre la mort est l’un des symptômes d’un certain dérèglement de la question même de la mort ou, à tout le moins, qu’elle n’est pas sans conséquence sur elle. En effet, constituer la mort en ennemi, c’est la considérer en opposition avec la vie, c’est-à-dire tout à fait séparée d’elle ; l’ennemi, dans la guerre, c’est celui avec lequel je ne partage rien, celui auquel tout m’oppose et dont j’entends triompher. Cette séparation entraîne un détachement de la mort de nos vies, un détachement à l’origine d’un certain dérèglement que je repère, dans la séquence actuelle, à la fois dans le traitement ayant été réservé aux personnes vivant en Ehpad durant le confinement et dans celui des morts eux-mêmes.
En effet, n’avons-nous pas, ces derniers mois, assisté à un dérèglement symbolique et anthropologique affectant profondément les rapports unissant les vivants et les morts ? La suspension des rites funéraires n’a-t-elle pas rendu tangible cette séparation entre la mort et la vie au point de devenir étrangères l’une de l’autre ? N’a-t-elle pas rompu le lien symbolique assurant à la mort sa présence au sein des vivants pour la réduire à sa seule dimension biologique, toute liturgie, considérée comme subsidiaire, ayant disparu ? Car le symbolique est ce par quoi vie et mort tiennent ensemble au niveau collectif comme individuel : rites funéraires, commémorations ou deuils privés sont les accomplissements symboliques inscrivant les morts dans nos vies, vie de la nation ou vie personnelle ; Jean Allouch nous dit que, pour Lacan, c’est tout le symbolique qui se trouve être convoqué lors d’un deuil. Que ce symbolique vienne à se défaire ou se trouve être appauvri au point de ne plus tenir qu’à un fil, il ne demeurera que la mort nue, une mort sans statut, raison pour laquelle je parle de fin de la mort : il ne s’agit plus seulement d’accompagner le mouvement constant de son expulsion de nos espaces sociaux mais de rompre avec elle ; le coût de cette rupture est l’altération voire la destruction de son enclos ou coffrage symbolique.
Les projecteurs politiques et sanitaires étant braqués sur les urgences hospitalières, la clôture des maisons de retraite alla de pair avec la mise au secret de la mort.
La guerre contre la mort virale, si elle a eu des effets symboliques, a également eu des conséquences réelles et son lot de morts nues dès lors que la vie n’était pas pour tout le monde. En effet, si le confinement fut décidé par crainte d’une saturation accélérée des services de réanimation, il visait également la protection des personnes âgées, les plus fatalement vulnérables au virus. C’est à cette fin que l’on ferma les Ehpad qui, déjà contaminés et souvent privés de tout – protections, tests de dépistage, infirmiers, médecins– se transformèrent, en bien des endroits, en incubateur de virus et en accélérateur de mort ; le confinement se révéla pour nombre de résidents le plus sûr moyen de mourir. Les projecteurs politiques et sanitaires étant braqués sur les urgences hospitalières, la clôture des maisons de retraite alla de pair avec la mise au secret de la mort ; personne ne put y mettre son nez pour savoir ce qui s’y passait ou tout simplement pour aider.
En bout de chaîne de la vie, il fallut un temps avant que la presse ne documente ce qui, en certains lieux, était une hécatombe ; du temps pour que les statistiques nationales incluent ceux qui comptaient alors pourtant pour au moins un tiers des décès[4]. Hécatombe de désespoir et dénuement de solitude également dès lors que l’ensemble d’une vie se concluait, au mieux, par quelques secondes d’un échange vidéo via un smartphone. Le fils parfois traversa même la France pour voir le père mourant, attestations du maire comme du médecin en poche : mais le gendarme de la vie le lui interdit et le fils s’en retourna, lesté d’une amende de 135 euros. Il ne vit le père ni mourant ni mort : le président de la République avait prévenu : cette guerre, nous la gagnerions « quoi qu’il en coûte », expression contenant en puissance cette rupture symbolique entre les vivants et les morts.
Je parle ici de morts nues car, avec le confinement – à partir de ce que l’on sait, de temps à autre, sur ce qui se joua dans les Ehpad – certaines personnes connurent des agonies que l’on croyait réservées aux temps de guerre. Pour les vieux, ceux qui précisément n’étaient pas hospitalisés, nulle chambre d’hôtel où être isolé, nul afflux d’infirmières ou de médecins, nul retour provisoire possible chez les enfants quand ceux-ci en faisaient la demande mais des morts de faim, des morts de soif, des morts de douleur, des morts de solitude : soit que l’on redouta de s’approcher sans protection, soit que de médecins, de respirateurs et de morphine, il n’y avait pas. Un virus pourtant pas si létal interdit, au nom de cette séparation entre la mort et la vie, d’étreindre une dernière fois ; la mort en forme d’épouvante justifiant l’abandon pur et simple. La guerre pour la vie, revers de la guerre contre la mort, a un prix.
Ce ne fut pas le cas partout et que l’on me pardonne ce tableau sans nuance, mais ce fut le cas ; la figure le directeur d’établissement fut déterminante dans le déroulé de cette séquence. De même, des médecins œuvrèrent sans répit pour contenir le désastre, des agences régionales de santé (ARS) dépêchèrent des infirmières pour soulager ces ouvrières du soin que sont les aides-soignantes, débordées et parfois rares car également contaminées – c’est que les masques, pourtant présents, furent réquisitionnés au début de la pandémie. Si la figure du directeur fut déterminante, c’est que, comme partout – à l’hôpital, à l’école, à l’université, dans les associations – la gestion des situations reposa sur les gens eux-mêmes, leurs décisions, leur engagement, leur inventivité : un do it yourself généralisé souvent avec succès. Pour cette raison, en certains Ehpad, pas un seul résident ne fut touché tandis que dans d’autres, l’on parvint, sous certaines conditions, à voir ses parents.
À la faveur d’un renversement inédit en regard de ce que nous dit Ariès, l’hyper visibilité de l’hôpital fit de lui une grosse machine à réanimer, une grosse machine de vie et non plus le seul lieu de la mort invisible. La médecine de ville, au front durant des semaines[5] tout comme le parc hospitalier privé, négligés, passèrent à l’arrière-plan. Pour les maisons de retraite, hors-champ du spectre médical, le drame se joua le plus souvent à l’ombre selon une gestion aussi privée que secrète, au coup par coup. L’abandon dans lequel les résidents sont parfois laissés, les économies réalisées sur leur dos – moins de couches, moins de pains au lait au petit-déjeuner, moins d’aides-soignantes – tout cela a été documenté par temps de paix ; la cotation en bourse de certaines chaînes d’Ehpad, propriétés de puissants fonds de pension, également. Ce lean management fut d’autant plus fatal par temps de pandémie dès lors qu’il repose sur la sous-embauche de médecins et d’infirmiers, plus coûteux que des aides-soignants.
L’on apprit également par la presse que le salaire de certains directeurs d’Ehpad privés, en plus d’un fixe, en comprenait un variable ajusté aux économies réalisées dans l’établissement, à la manière d’une usine de chaussures ou d’un commerce quelconque. Le froid de la logique libérale fit que les vieux n’étaient pas des malades mais des mourants esseulés dont la vie pouvait être, à l’image de tout autre objet marchand, l’objet d’une politique de réduction des coûts. L’obscénité ne connaissant pas de limites, des familles apprirent, parfois par un texto impérieux des pompes funèbres, la mort de leur père ou de leur mère qu’on leur demanda de récupérer illico. Enfin, on mourrait seul et on serait enterré seul, en catimini, sans un pas vous accompagnant, sans personne pour dire sa vie : le sacré passait tout entier de la mort à la vie considérée comme « souverain bien » dès lors que, s’il était toujours possible de faire la queue au supermarché, enterrer ses proches ne l’était pas ; le deuil n’entrait pas dans le registre des activités essentielles autorisées par l’État.
Il apparaît nécessaire de donner un statut à la mort au risque de faire de nous, en ces temps de crise, des petits monstres innocents.
Les temps peuvent être à l’exception mais lorsqu’elles sont de cette ampleur, il faut les justifier autrement qu’en faisant s’équivaloir la fermeture d’une plage et la tenue d’obsèques ; les cimetières furent par conséquent fermés car les morts, s’ils pouvaient être comptés, ne devaient pas être publiquement vus : exemplification radicale, délibérée ou non, de l’effacement. Ainsi, c’est l’ensemble de la chaîne symbolique qui fut ici rompue et fit de ces morts des morts nues ; la guerre contre la mort pris également les traits d’une guerre hideuse contre les morts dès lors que le déni augmentait à mesure que les morts elles-mêmes se multipliaient. L’on se retrouve alors face à la situation analysée par Ariès lorsque les rites et codes disparurent : « Les sentiments qui veulent jaillir hors de l’ordinaire, ou bien ne trouvent pas leur expression et sont refoulés, ou bien déferlent avec une violence insupportable, sans plus rien pour les canaliser. »
Les vieux comme morts en sursis et inutiles sociaux dont le virus n’était que la pichenette les faisant tomber de l’autre côté ? Sans doute pour une partie d’entre eux : raison de plus pour s’approcher et entourer, raison de plus pour ne pas les laisser mourir de faim en faisant de la dignité « une activité essentielle ». Cela aurait-il-été différent si la mort avait d’abord touché les enfants ? Peut-être. Mais rappelons-nous la suspicion avec laquelle, au début du confinement, ils furent traités, les parents les tenant parfois au plus près d’eux dans la rue pour qu’ils ne soient l’objet d’aucune vindicte : chacun chez soi, chacun pour soi. Il n’est pas certain qu’une guerre pour la vie, sa vie, épargne quiconque.
Penser que l’on préserve la vie en déniant la mort et en opposant les deux est un leurre funeste. Il n’y a pas d’opposition entre la vie et la mort mais une intrication fragile parce que symbolique qui, dans la séquence actuelle, fut tout à fait suspendue, les morts n’ayant plus de présence au sein des vivants si ce n’est sous la forme d’un compteur dont la molette chaque soir égrenait les chiffres morbides. S’il apparaît nécessaire de donner un statut à la mort, c’est que son déni affecte toute sa chaîne, que ce soit au niveau biologique et social, au niveau réel comme symbolique. Chasser la mort de nos horizons de vie, c’est également s’interdire de la documenter dans ses formes contemporaines notamment lorsque le fatum y est façonné par le libéralisme actuel, qu’il s’agisse des morts d’obésité ou de désespoir.
Donner un statut à la mort au risque de faire de nous, en ces temps de crise, des petits monstres innocents. Ariès, dans les toutes dernières lignes de son livre, nous y invite : « Il n’est pas question de revenir en arrière, de retrouver le Mal aboli une fois pour toutes. […] La mort doit seulement devenir la sortie discrète, mais digne, d’un vivant apaisé, hors d’une société secourable que ne déchire plus ni ne bouleverse trop l’idée d’un passage biologique, sans signification, sans peine ni souffrance, et enfin sans angoisse. »
