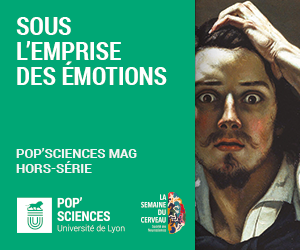Dystopie du confinement – sur Shining de Stanley Kubrick
Le cinéma a toujours été prolixe sur les sujets qui nous mobilisent en ce moment. Question pandémie, on pourrait citer Contagion, Epidemic, Virus, Pandémie, Mauvais sang, Rage, Les Oiseaux… et rayon confinement, tout film de lieu plus ou moins fermé ou isolé fait l’affaire : Rio Bravo, Alien, Fenêtre sur cour, 2001, La Maison du diable, La Maison des otages, Key Largo, Les Visiteurs (ceux d’Elia Kazan, à ne pas confondre avec la bande à Christian Clavier), Les Chiens de paille, Safe, The Thing, Panic room, Rebecca, ou même le récent Parasite voire le Portrait de la jeune fille en feu.
On pourrait même soutenir l’idée que le confinement est consubstantiel au cinéma puisque, même si les pratiques évoluent, voir un film consiste à se réfugier dans une salle obscure coupée du monde extérieur et social. Maintenant certes, on visionne plus de films dans son salon que dans une salle et l’on peut parier sans grands risques que cette activité sera l’une des principales de nos concitoyens confinés.
Le film qui vient le plus facilement à l’esprit des cinéphiles comme miroir de notre condition actuelle est Shining, de Stanley Kubrick, d’ailleurs déjà objet de blagues sur le net. Rappelons-en l’argument pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Jack Torrance (Jack Nicholson) est engagé comme gardien d’un majestueux hôtel isolé en pleine montagne pendant la saison de fermeture de l’établissement. Il débarque avec sa femme Wendy (Shelley Duval) et son fils Danny (Danny Lloyd) en espérant profiter de longs mois à l’écart du monde pour écrire un roman. Avant de leur confier les clés de l’hôtel, le directeur fait visiter les vastes lieux à la famille Torrance et prévient Jack d’un fait peu rassurant : le précédent gardien est devenu fou et a massacré toute sa famille à la hache.
Shining est évidemment célèbre comme classique du film d’horreur et les scènes empruntées au lexique gore y abondent : jeune femme instantanément transformée en cadavre putrescent, flots de sang se déversant d’un ascenseur, outils contendants (bat de baseball, hache…), massacre s’étant déroulé dans la fameuse chambre 237 (qui a elle-même suscité un documentaire riche en interprétations plus ou moins convaincantes, Room 237 de Rodney Ascher).
Ce registre gore se mêle à une dimension plus purement fantastique qui fait intervenir des boucles temporelles échappant à notre conception rationaliste et linéaire du temps : ainsi Danny est-il sujet à des visions horrifiques liées au massacre de la famille précédente. Cette qualité étrange est le « shining » du titre, sorte de don qui permet à Danny d’entrevoir un passé qu’il ne connaît pas, voire l’avenir. De son côté, Jack discute avec certains membres du personnels de l’hôtel qui semblent n’exister que dans son imagination puisque les Torrance sont censés être seuls.
La lecture du film qui rejoint le mieux notre présent est la plus prosaïque : celle d’un père de famille qui finit par péter les plombs à force d’isolement.
Que Jack délire dans sa solitude et finisse par imaginer de la compagnie, on le conçoit, mais ce qui est plus étrange, c’est qu’il semble connaître l’hôtel et ses serveurs, comme s’il en était un vieil habitué. Impression corroborée par l’énigmatique plan final du film : une photo du personnel de l’hôtel à l’occasion de la fête du 4 juillet 1921 au milieu duquel trône… Jack, soit quelques cinquante ans avant le présent du film. Jack est-il le fantôme des lieux ? Ou le descendant d’un précédent directeur ou client de l’hôtel ? En cet endroit reculé du monde, le temps n’existe-t-il plus, passé et présent ne feraient-ils qu’un ?
La dimension gore et paranormale de Shining a été abondamment commentée. Mais la lecture du film qui rejoint le mieux notre présent de confinés à domicile est la plus prosaïque, la plus frontale, la plus simple : celle d’un père de famille qui finit par péter les plombs à force d’isolement et d’enfermement. Pourtant, l’hôtel Overlook n’a rien d’une cellule de moine. La bâtisse est immense, confortable, luxueuse. Les cuisines et réserves sont copieusement achalandées. Et nul besoin d’attestation dérogatoire pour sortir se balader alentour, dans une nature immense, splendide et sauvage. Si l’on s’en tenait à un strict indice de confort, les Torrance bénéficient de conditions 5 étoiles.
Mais chacun est seul. Danny n’a pas de copains, et hormis ses horrifiques visions de « shining », son seul loisir consiste à pédaler sur sa petite voiture dans des couloirs interminables (labyrinthes spatial et temporel se superposent tout le temps dans le film). Wendy s’occupe de Danny, et à part ça, pas grand chose à faire : pas d’amies, pas de voisins, pas de centre-ville à proximité, pas de magasins, de cafés… Même solitude fondamentale pour Jack qui passe ses jours sur sa machine à noircir les pages de son roman. Du moins le croit-on, jusqu’au moment où Kubrick nous dévoile ce qu’écrit Jack : « all work and no play make Jack a dull boy/que du travail et pas de jeu font de Jack un garçon ennuyeux », ligne répétée x fois.
Ok, Jack devient dingue, et toutes les saynètes paranormales ou sanglantes ne sont peut-être que le pur produit de son imagination. Dans ces conditions, nulle surprise à ce que montent les tensions familiales et conjugales, les agacements, ressentiments, paranoïa et névroses bouillonnant comme dans une marmite qui n’aurait pas de soupape de sécurité. Engueulades, hurlements, bagarre, bat de baseball, hache, « heeeeeere’s Johnny ! »… Et l’on retrouve la boucle temporelle, la reproduction des traumas, la duplication des évènements : la famille Torrance connaît (presque) le même sort que la famille qui l’a précédé. L’avertissement du directeur (et du réalisateur) au début du film était comme une prophétie autoréalisatrice (et le programme du film annoncé au spectateur).
L’une des choses dites par Shining est que la solitude rend fou (ou exacerbe les névroses inhérentes à chacun), que l’isolement est un état invivable sur la durée, même si le lieu de vie est cossu. L’homme est peut-être un animal individualiste, solitaire, mais aussi et assurément un animal social. Vivre seul, ou confiné dans la cellule familiale (bonjour à tous !) ne fait pas une existence épanouie.
On a besoin d’échanges, de rencontres, de regarder les autres et d’être regardés par eux, de croiser pensées, opinions et sentiments. On a besoin aussi du corps des autres, du son de leur voix, de leur gestuelle, de la dimension physique, charnelle du contact, de la « présence » de l’autre (on aura compris que je ne parle pas forcément ici de relation sexuelle, mais du besoin de se sentir humain au milieu des humains). C’est ce manque du social, cette coupure d’avec l’Autre, dont nous faisons l’expérience en ce moment et qui sera probablement de moins en moins facile à vivre au fur et à mesure de la durée du confinement. En espérant quand même qu’aucun d’entre nous n’ira jusqu’à désirer trucider sa famille !
Stanley Kubrick, Shining, 1980.