Pourquoi ont-ils tous peur du postcolonial ?
Pour Edward W. Said (1935-2003)
et James Arthur Baldwin (1924-1987)
Contrairement à Edward Saïd, Homi Bhabha ou Gayatri Spivak, je ne suis pas un théoricien du postcolonialisme, encore moins l’un des grands prêtres de la pensée dite décoloniale et dont l’essentiel des thèses, tout comme au zénith de la théorie de la dépendance (ou de ce que l’on appelait alors « le développement du sous-développement »), nous viennent d’Amérique Latine. Des subaltern studies (un important courant de pensée historiographique né en Inde dans les années 1980), je n’en ai entendu parler qu’au début des années 1990, lorsque je me suis établi aux États-Unis après des études à l’université de Paris I-Panthéon Sorbonne et à Sciences-Po.
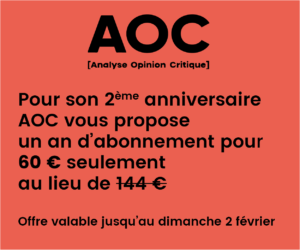
C’est vrai, j’ai publié en 2000 un essai intitulé De la postcolonie, une réflexion avant tout d’ordre esthétique qui tirait son inspiration de l’écriture romanesque et de la musique africaine de la fin du XXe siècle[1]. Passé sous silence en France, l’essai fut rapidement traduit en anglais et connut un remarquable succès aux États-Unis et dans les mondes anglo-saxons où il est devenu un classique[2]. Les « études postcoloniales » n’en constituaient pas l’objet. En vérité, il s’agissait d’une contribution à la critique de la tyrannie et de l’autoritarisme, ces facettes souvent inavouées et longtemps réprimées de notre modernité tardive.
J’interrogeais en particulier la manière dont les formations sociales issues de la colonisation s’efforcèrent, alors que les politiques néolibérales d’austérité accentuaient leur crise de légitimité, de forger un style de commandement hybride et baroque, marqué par la prédation des corps, une violence carnavalesque et une relation symbiotique entre dominants et dominés. À ces formations et à ce style de commandement, je donnais le nom de postcolonie, un terme inventé de toute pièce, qui jusqu’à ce jour, du moins à ma connaissance, n’existe d’ailleurs dans aucun dictionnaire français.
Ne me reconnaissant guère dans ces mouvements d’idées, je n’ai par ailleurs aucune raison de leur être hostile. À quoi cela servirait-il ? Comme tant d’autres courants issus d’autres traditions intellectuelles à diverses périodes de notre histoire, je les considère comme faisant partie des archives du Tout Monde, une part désormais inéradicable de nos multiples héritages, que ceux-ci soient assumés ou non. Ailleurs et dans le reste du monde d’expression française, beaucoup l’ont au demeurant compris. Pourquoi s’en priveraient-ils, alors que le nouveau siècle s’ouvre sur un déplacement historique majeur ? L’Europe, en effet, « ne constitue plus le centre du monde même si elle en est toujours un acteur relativement décisif » [3]. Pour avancer dans la nuit qui nous guette, ne vaut-il pas mieux rester éveillé, prêt éventuellement à accueillir l’inattendu, voire ce qui, à première vue, nous désoriente et nous déroute?
Toxicose
Hélas, telle n’est manifestement pas la sensibilité de l’époque. La preuve ? À peu près tous les deux ou trois mois, le public lettré d’expression française dans les quatre coins du monde est convié à un curieux sabbat au cours duquel des sacrificateurs auto-désignés procèdent à l’immolation rituelle non point d’un bélier, d’un agneau ou de tout autre bouc émissaire, mais de ces courants de pensée, auxquels il convient d’ajouter les études de genre ou de la race, et de leurs dévots supposés. Cela fera bientôt vingt ans que dure le manège et rien, en l’état actuel des choses, ne semble devoir l’arrêter. À y regarder de près, cette offrande à l’on ne sait quel dieu a toutes les apparences d’une tentative d’idéicide.
Il faut la qualifier d’idéicide dans la mesure où ce dont on cherche à empêcher la dissémination et ce dont on réclame à cors et à cris l’extirpation, ce sont des idées, quitte à blesser au passage ceux et celles qui les portent. Dans la langue des nouveaux sacrificateurs, plusieurs épithètes et sobriquets servent à typifier ces courants juges nocifs, et dont beaucoup, apparemment, redoutent ouvertement l’emprise sur les esprits et sur les institutions. « Obsédés de la race », « racistes anti-blancs », « bonimenteurs » en sont quelques-uns, sans doute pas les plus fleuris, d’une longue et scabreuse flopée. Que dire des multiples autres désignations, les unes plus sexistes que les autres, dont la fonction est, manifestement, de jeter le discrédit sur des pratiques et des univers cognitifs dont on ne sait pas grand chose, dont au fond on n’a cure (« féminisme radical, groupusculaire, vindicatif et victimaire »), ou que l’on réduit à une affaire de petits sous (vulgaire « business »), voire à une oiseuse et bruyante distraction (un simple « carnaval ») ?
Toutes ces épithètes, insultes et caricatures et tous ces sobriquets ont en commun une chose. Ils cherchent vainement à éloigner un spectre et à conjurer la terreur que ne cesse de provoquer un hideux fétiche mal acquis et mal dissimulé, le colonial ou, plus précisément, la colonialité, ses généalogies, ses structures et ses conséquences dans le présent. L’interminable campagne de stigmatisation et de dénigrement, et dans certaines circonstances d’intimidation pure et simple n’a, quant à elle, strictement rien d’un débat académique. Souvent menée à coup d’injures, ses véritables significations se trouvent ailleurs, et c’est sur ce dont elle est le symptôme (et non sur l’objet stigmatise) qu’il convient donc de se pencher.
Cette campagne de dénigrement est passée par plusieurs étapes. Au début des années 1990, très peu ayant pris la peine de s’informer, de lire les textes majeurs, de les traduire en français ou de les étudier sérieusement dans leur langue d’origine, ce ne furent que condescendance et indifférence, sarcasmes et quolibets, à quoi l’on ajoutait, de temps à autre, la traditionnelle dose de mépris. Ignorance, suffisance et arrogance ne parvenant guère à endiguer la vague, l’on passa au début des années 2000 au procès en illégitimité. Désormais, le temps est au combat frontal. Pour masquer la bêtise récurrente, l’on n’hésite plus à recourir aux injures ou à vilipender ce au sujet de quoi l’on ne sait strictement rien ou si peu. Du coup, ceux et celles d’entre nous qui s’attendaient à une véritable joute intellectuelle en sont pour leurs frais.
Car, à aucune de ces étapes, la raison n’aura avancé d’un seul pas. Au contraire, les approximations et raccourcis se multipliant, la pieuvre de l’ignorance et de la veulerie continue d’étendre au loin ses tentacules, recouvrant d’un assourdissant brouhaha les voix de ceux et celles, en vérité très peu nombreux, qui ont effectivement pris la peine de lire et d’étudier les dits courants de pensée afin d’en saisir le lexique, les méthodes, les énoncés exacts et leur impact réel ou supposé sur la compréhension de notre monde.
Comment expliquer autrement la confusion ambiante, entre ceux qui font semblant d’oublier d’où eux-mêmes parlent, et ces autres qui ne cessent de bégayer, de se mêler les pieds, de mélanger les noms, les dates, les lieux, les catégories et les arguments, de prendre le postcolonial pour le décolonial, le décolonial pour le racisme anti-blanc, la communauté pour le communautarisme (le vieux nouveau chiffon rouge), le racisme pour la race et l’étranger pour l’ennemi de l’universel ?
On le voit bien, nous sommes face à un cas de toxicose aigüe, du genre qui affecte les vieilles nations impérialistes lorsque, le deuil n’ayant vraiment jamais été fait de la colonie, sonne l’heure de la nostalgie et de la mélancolie. Hier, en effet, il s’agissait d’accaparer le monde au profit de quelques-uns. Telle était la définition, en dernière instance, du colonialisme. Dans un comique retournement de l’histoire, tout se passe comme si le monde qu’hier l’on croyait s’être accaparé cherchait aujourd’hui à nous dévorer de l’intérieur. La forteresse serait donc assiégée et prise d’assaut. D’où la panique. La bunkerisation. La volonté d’expurgation, l’irrépressible désir de violence en réponse au défi de la planétarisation du monde, ce vieux nouveau programme culturel européen.
À coup d’exhortations, d’appels répétés à la vigilance, à la dénonciation, à l’excommunication, voire à la répression bureaucratico-administrative, des personnages de diverses obédiences se sont donc mis à crier en chœur au loup. En ces temps où les plus forts se prennent pour des victimes, des gens qui ont tous pignon sur la place publique, dans les médias et dans les grandes institutions académiques et culturelles de la République, sans compter les grandes revues et les grandes maisons d’édition, se mettent soudain à pleurnicher. Afin de protéger de juteuses rentes de situation et de continuer de vivre et d’opérer dans une chambre d’échos, ils n’hésitent plus à en appeler à davantage de brutalité contre leurs propres collègues, voire leurs subordonnés sur lesquels ils veulent voir s’abattre la lourde main de l’État. Ravis de se retrouver entre soi, n’ont-ils pas pris l’habitude, des années durant, de pérorer sans interruption ni réplique à longueur de saisons ?
La communauté des nouveaux sacrificateurs se définit par son œcuménisme. L’on y retrouve, pêle-mêle, ceux pour qui la perte de l’Empire (et en particulier celle de l’Algérie française) fut une catastrophe, des marxistes dogmatiques pour lesquels la lutte des classes (et la question sociale) constitue le dernier mot de l’histoire, des anciens de la Gauche prolétarienne passés avec armes et bagages au néolibéralisme, des catéchistes de la laïcité défenseurs modèle républicain policier et autoritaire tout content d’éborgner à la pelle, des épiciers et pontificateurs de l’universalisme abstrait, des apologètes autoproclamés des valeurs de l’Occident ou encore de l’identité catholique de la France, des nostalgiques et orphelins de la culture classique, des lecteurs de Maurras et de Mao confondus, des tenants de l’antiaméricanisme de gauche comme de droite, des croisés anti-postmodernistes et adversaires de ce qu’ils nomment dédaigneusement la « pensée 68 », des fémonationalistes prêtes à reprendre le flambeau, à savoir le vieux « fardeau de l’homme blanc », et la foule des sans noms aux yeux desquels toute « personne de couleur » est par définition un « communautariste » qui s’ignore.
Mais de quoi ont-ils donc peur ? Qu’est-ce qui dans le discours post- ou décolonial ou les études de genre les traumatise tant, se demandent le prix Renaudot Alain Mabanckou et le critique américain Dominic Thomas dans une tribune récente. Il faut élargir l’interrogation et se poser la question de savoir quelle est cette figure de la panique et du traumatisme qui, subrepticement, s’empare du sujet apeuré et le pousse à hurler avec la foule et à ne plus s’exprimer que sur le mode du bégaiement, dans la langue de l’injure et en bordure de la diffamation ? En d’autres termes, de quoi cette panique et la façon dont elle se manifeste sont-elles le symptôme ?
Les nouveaux voyages de la pensée
Car, dans le reste du monde y compris d’expression française, la critique de l’esclavage, du colonialisme, du racisme et du patriarcat n’a pas commencé aujourd’hui. Elle a toujours consubstantielle à celle des Temps modernes. Après tout, le virage postcolonial dans les sciences sociales et les humanités (pour nous limiter à cette approche) a eu lieu il y a bientôt un demi-siècle. Depuis lors, la critique postcoloniale, au même titre que la critique féministe, pèse dans de nombreux débats politiques, épistémologiques, institutionnels et disciplinaires. C’est le cas aux États-Unis, en Grande Bretagne et dans nombre de régions de l’hémisphère Sud, de l’Asie du Sud et du Sud-Est, voire de l’Europe orientale. À ce que l’on sache, dans ces parties du monde, ce tournant n’a pas été à la source du genre de traumatismes que l’on observe dans la France d’aujourd’hui.
Dès sa naissance, la pensée postcoloniale a fait l’objet d’interprétations fort variées et a suscité, à intervalles plus ou moins réguliers, des vagues de polémiques et controverses, voire des objections totalement contradictoires les unes avec les autres. Elle a aussi donné lieu à des pratiques intellectuelles, politiques et esthétiques tout aussi foisonnantes et divergentes, au point que l’on est parfois fondé à se demander ce qui en constitue l’unité. Ces controverses, souvent d’une incontestable facture, se poursuivent allègrement, sans jamais déboucher sur la sorte d’hystérie autoritaire et néoconservatrice si typique de la scène intellectuelle française contemporaine[4].
La fragmentation de ce courant nonobstant, l’on peut affirmer qu’en son noyau central il se propose d’expliquer les conditions qui ont conduit à l’entremêlement de nos histoires et les conséquences de la concaténation de nos différents mondes depuis le début de l’ère moderne. Qui peut honnêtement nier que l’esclavage et surtout la colonisation, mais aussi la ponction des corps, l’extraction des richesses du sol et du sous-sol, le commerce et les migrations, la circulation des formes et des imaginaires ont joué un rôle décisif dans ce processus de collision et d’enchevêtrement des peuples ? C’est donc non sans raison que la pensée postcoloniale en a fait des objets privilégiés de ses enquêtes et de ses discours.
Dans leurs empires respectifs les puissances européennes avaient inventé des machines spécialisées dans la production de la différence. De tels dispositifs fonctionnaient, pour l’essentiel, sur des bases raciales. Des statuts juridiques différenciés et chaque fois infériorisants furent mis en place. En retour, au cours de leurs luttes pour l’abolition de la servitude et pour la remontée en humanité, bien des sujets colonisés procédèrent à la critique des torts qu’ils avaient subi, recourant à l’occasion à des contre-grammaires tirées de l’arsenal colonial lui-même. La pensée postcoloniale examine ainsi le travail accompli par ces dispositifs et d’autres technologies de la différence.
Elle s’intéresse par ailleurs à l’analyse des phénomènes de résistance qui jalonnèrent l’histoire coloniale, aux diverses expériences d’émancipation et à leurs limites, à la façon dont les peuples opprimés se constituèrent en sujets historiques et pesèrent d’un poids propre dans la constitution d’un monde transnational et diasporique, celui dans lequel nous vivons. Elle se préoccupe, enfin, de la manière dont les traces du passé colonial font, dans le présent, l’objet d’un travail à la fois politique et de resymbolisation, ainsi que des conditions dans lesquelles ce travail donne lieu à des figures identitaires inédites, hybrides ou cosmopolites.
Au passage, une immense contre-bibliothèque a pu être constituée, que l’on ne peut ignorer ou négliger qu’à ses propres dépens. Des savoirs autrefois insoupçonnés ont été sauvés de l’oubli et réhabilités. Des voix que l’on avait coutume d’étouffer se sont levées et ont prononcé des paroles neuves sur à peu près tout ce qui, auparavant, relevait de la seule parole des maîtres d’antan. Des institutions ont été mises en place. Des revues ont été créées dont le rayonnement international est sans conteste. Des littératures mineures ont enrichi le canon traditionnel. Il n’y a pas jusqu’à l’enseignement de la langue française à l’étranger qui n’en ait tiré de gros bénéfices, grâce en très grande partie à l’ensemble des créations d’expression française dans leur transnationalité.
De nouveaux voyages de la pensée ont donc été entrepris. Leur scène, ce n’est point une famille incestueuse dans laquelle règne en despote un père obsédé par la peur d’être évincé non pas par ses propres fils, mais par une descendance étrangère. Leur scène, désormais, c’est la planète tout entière. Ces voyages n’excluent guère l’Europe, mais ses principaux protagonistes ne se soucient plus guère d’en solliciter, comme auparavant ni la bénédiction, encore moins l’imprimatur. Incapables d’en faire le deuil, est-ce la fin du patriarcat épistémique longtemps exercé par l’Europe sur le reste du monde que nos sacrificateurs sont en train de vivre comme un parricide, reportant dès lors leur rage et leur traumatisme sur le mauvais objet ?
Capacité de vérité
Les vieilles nations ont en effet leurs façons d’inventer des moulins à vent. Quand elles jouent à se faire peur, il faut se méfier car c’est généralement dans le but de commettre un sinistre forfait aux dépens de plus faible qu’elles. On connait l’antienne. Les dominés seraient responsables de la violence qui s’abat sur eux. De cette violence, les puissants ne seraient guère responsables puisqu’ils ne l’exerceraient jamais que malgré eux, à contre-cœur, et souvent pour le bien même de ceux à qui elle est infligée puisqu’en fin de compte, il s’agirait de les protéger contre leurs mauvais instincts. Une telle violence ne serait donc pas criminelle. Relevant à la fois du don et de la miséricorde, elle serait éminemment civilisatrice.
La vérité, on s’en doute, est ailleurs. À la faveur du tournant autoritaire et néoconservateur d’une très large portion de la scène intellectuelle et culturelle française, beaucoup, de nos jours, ne veulent pas entendre parler du passé colonial. Ils prétendent que ce passé a été « globalement positif » (ce pour quoi les ex-colonisés devraient leur être reconnaissants), ou alors qu’il est cliniquement mort (pourquoi, des lors, le remettre en scène ?). Ils clament qu’en tout état de cause, ils n’en sont guère responsables, et que de toutes les façons seul importe le présent.
Ce pieux mensonge n’est pas seulement partagé par les milieux populaires supposément séduits par l’idéologie de la préférence nationale. Il est alimenté par des élites désireuses, elles aussi, de bénéficier de la rente de l’autochtonie. À titre d’exemple, ce présentisme radical (typique de la vulgate néolibérale) est l’un des fondements idéologiques de la politique africaine d’Emmanuel Macron : « Moi j’appartiens à une génération qui n’est pas celle de la colonisation, proclame-t-il fièrement. Le continent africain est un continent jeune. Les trois quarts [des habitants] de votre pays [la Côte d’Ivoire] n’ont jamais connu la colonisation. »
Dans sa vision du monde, le colonialisme, événement à géométrie variable, fut tantôt un « crime contre l’humanité » (sa déclaration à Alger) et tantôt une « erreur », une « faute de la République » (sa déclaration à Abidjan). Recourant volontiers à la ficelle générationnelle, il fait semblant de croire que le présent n’est jamais le produit du passé, ou encore que le rapport de l’un à l’autre est strictement de l’ordre de l’aléatoire. Il semble bien que pour lui, le passé colonial en tant que tel n’est pas passible de critique (tâche inutile). Il est inéluctablement voué à l’oubli. Et contrairement à ce que nous apprirent aussi bien son maître Paul Ricœur que les meilleurs des nôtres, il ne croit pas qu’il existe quelque relation que ce soit entre la mémoire et l’imagination[1]. Le fait pour une génération d’être née après un événement traumatique scellerait nécessairement l’innocence de cette génération, autorisant dès lors le déni de responsabilité à l’égard de l’histoire dont elle est, par ailleurs, structurellement l’héritière.
On a beau expliquer que le meilleur de la pensée postcoloniale ne considère la colonisation ni comme une structure immuable et a-historique, ni comme une entité abstraite, mais comme un processus complexe d’invention à la fois de frontières et d’intervalles, de zones de passage et d’espaces interstitiels ou de transit, rien n’y fait. On a beau affirmer que parallèlement, cette pensée fait valoir, à juste titre, que l’un des résultats de la colonisation fut l’institution, sur une échelle planétaire, de rapports de subalternité entre les puissances coloniales d’une part, et d’autre part des entités humaines qui auparavant jouissaient d’une relative autonomie, voire étaient indépendantes. Là n’est apparemment pas la question.
La bête à cornes et la saison des poisons
Puisqu’en vérité il ne s’agit pas d’un débat académique, il faut donc prendre le taureau par les cornes.
Le tournant autoritaire et néoconservateur de la pensée française coïncide avec la réactivation du mythe de la supériorité occidentale et la redistribution de la haine sur une échelle planétaire. La guerre apparaissant dans ce contexte comme le sacrement de cette nouvelle époque, celle du brutalisme. Exploitant à sa manière tout l’arc des émotions et passions populaires, la nébuleuse des sacrificateurs contribue à entretenir le fantasme d’une France débarrassée des créations de l’esprit venues de l’étranger et de la pensée des Autres, ces symboles par excellence de l’Ailleurs, de ceux-là auxquels nous ne pouvons guère nous identifier, et que l’on doit, dans tous les cas, empêcher de se glisser dans nos formes de vie, puisqu’ils finiront tôt ou tard par nous empoisonner.
Le risque d’empoisonnement se trouve donc au cœur de la panique actuelle. Haïr viscéralement ce que l’on ne connait pas, ce dont on a cure ou ce à l’égard duquel l’on n’éprouve qu’indifférence est notre nouvelle passion, la passion pour les poisons de tout genre. Celle-ci est la conséquence d’une lecture ultra-pessimiste du moment contemporain marqué, entre autres, par la redéfinition de l’étranger en tant que porteur de risques mortels (les idées y compris) contre lesquels il faut à tout prix se prémunir. Le statut polémique qu’occupent l’étranger et ses idées dans l’imaginaire et le champ français et européen des affects n’incite guère à l’optimisme. L’hostilité à l’égard des courants de pensée post- et décoloniaux et des critiques du féminisme civilisationnel participe d’une nouvelle forme de « commissariat », le commissariat pour la « protection du mode de penser européen » (à supposer qu’une telle curiosité existe), le pendant du portefeuille pour « la protection du mode de vie européen » concocté récemment par l’Union Européenne elle-même. Cette hostilité est le complément philosophique et culturel du désir renouvelé de la frontière. Elle va de pair avec la réactivation des techniques de séparation et de sélection généralement associées à toute institution frontalière.
Loin d’être à la repentance, l’ère est plutôt à la bonne conscience. À travers la colonisation, les puissances européennes cherchaient à créer le monde sinon à leur image, du moins à leur profit. « Rude et laborieuse race de mécaniciens, d’agriculteurs, de constructeurs de ponts » et de statues (dirait Nietzsche), les colons ne purent finalement accomplir que de grossiers travaux. Mais ils étaient armés d’une poignée de certitudes que la décolonisation n’a guère effacées et dont on peut constater la résurgence et les mutations dans les conditions contemporaines.
La première était la foi absolue en la force. Les plus forts ordonnaient, dictaient, agençaient, commandaient, et donnaient forme au reste du troupeau humain. La deuxième, toute nietzschéenne, était que la vie même était avant tout volonté de puissance et instinct de conservation. La troisième était la conviction selon laquelle les colonisés représentaient des formes morbides et dégénérées de l’homme, corps obscurs en attente de secours et qui réclamaient de l’aide. Quant à la passion de commander, elle se nourrissait du sentiment de supériorité à l’égard de ceux dont l’unique tâche était d’obéir et de se laisser instruire. S’y ajoutait l’intime certitude que la colonisation était un sublime acte de charité et de bienfaisance pour lequel les colonisés devaient éternellement témoigner de sentiments de gratitude, d’attachement et de fidélité.
Ce complexe idéo-symbolique sert de fondement à ce qui passe pour la bonne conscience européenne et à son fantasme-maître, le fantasme de l’innocence. Cette bonne conscience a toujours consisté en un mélange d’indifférence, de volonté de ne pas savoir et de pulsion de brutalité, notamment à l’encontre des non-parents. Elle a toujours consisté à vouloir n’être coupable de rien, la revendication d’un irénique état d’innocence qui trahit paradoxalement la peur de la vérité. Cette fuite permanente dans l’irénisme, cet attachement viscéral à un état illusoire d’innocence aura chaque fois poussé une certaine Europe à toujours vouloir nier ses crimes. Elle repose paradoxalement sur la conviction selon laquelle les instincts de haine, d’envie, de cupidité et de domination font partie de la vie, et qu’il ne saurait donc y avoir de morale valable pour tous, les forts comme les faibles. L’homme supérieur ne saurait être condamné sur la base de la morale du faible. Et, puisqu’il existe une hiérarchie entre les hommes, il devrait en exister entre les morales. Aux yeux des contempteurs des pensées minoritaires, la critique du passé colonial ne sert à rien, sinon à déviriliser l’Europe, à la dévitaliser et à en alanguir la volonté, c’est-a-dire la capacité de brutalisation.
Telle est la bête à cornes. Nietzsche disait qu’elle a toujours exercé le plus grand attrait sur l’Europe. Cet attrait ne s’est guère affadi. Bien au contraire, il est en pleine résurgence. Ceci étant, c’est son procès qu’il faut urgemment intenter si le monde tout entier doit redevenir le sol commun de toute l’humanité.
La pensée critique d’expression française se trouve à un véritable tournant. Si, comme l’explique la philosophe Nadia Yala Kisukidi, la colonisation a signifié l’accaparement du monde et du sol commun par quelques-uns pour le profit de quelques-uns, alors la décolonisation exige de « rendre à chaque partie du monde la possibilité de faire monde ». C’est à cette égale possibilité de faire monde que s’opposent les caporaux « du mode de penser européen ». Ils sont convaincus que de la liquidation des pensées venues d’Ailleurs dépend la survie de ce mode de penser. Ils ne veulent ni faire monde avec d’autres, ni habiter un monde commun.
Ainsi que je l’écrivais dans Critique de la raison nègre en 2013: « l’Europe ne constitue plus le centre de gravité du monde. Tel est en effet l’événement ou, en tous cas, l’expérience fondamentale de notre âge. Et, s’agissant d’en mesurer toutes les implications et d’en tirer toutes les conséquences, nous n’en sommes justement qu’au début. Pour le reste, que cette révélation nous soit donnée dans la joie, qu’elle suscite l’étonnement ou qu’elle nous plonge plutôt dans l’ennui, une chose est certaine : ce déclassement ouvre de nouvelles possibilités – mais est aussi porteur de dangers – pour la pensée critique » [5].
Dans le cas de la pensée critique d’expression française, ces dangers seront mortels si la raison défaite, l’intimidation, l’injure et la diffamation l’emportent sur la parole accueillante et dédiée à la seule tâche qui, aujourd’hui, vaut véritablement la peine, à savoir la réparation du monde et la réconciliation entre tous ses habitants, humains et non-humains.
NDLR Achille Mbembe est l’auteur de Brutalisme, paru en février 2020 aux Éditions La Découverte.
(texte modifié par l’auteur le 21 janvier, quelques heures après sa mise en ligne)
