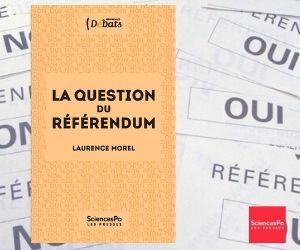La parole des Gilets jaunes face à la politique de « la langue »
Bon nombre d’analystes ont remarqué qu’un des mérites du mouvement des Gilets jaunes réside dans une volonté de prise de parole, une parole à la fois libre et signe d’une réappropriation du politique par tout un chacun, dont l’appel de Commercy a formulé l’exigence. Ce mouvement a trouvé sa pleine expression à la fois dans l’inventivité des formules et des slogans dont très vite des historiennes et des militantes ont saisi l’importance (le tout récent recueil Plein le dos en témoigne), et, ainsi que l’a souligné très justement dans AOC Emmanuelle Pireyre [1], dans l’élaboration patiente et en temps réel de la chose politique.
Ce phénomène, toujours réjouissant pour les anthropologues du langage et plus encore pour celles et ceux qui le vivent de l’intérieur, permet de saisir à chaque fois l’importance de la parole dans les rapports sociaux et de mesurer de quelle force émancipatrice se nourrit la construction d’un mouvement politique. Comme je l’avais déjà analysé[2] pour l’événement 68, à partir notamment des textes de Michel de Certeau et de Maurice Blanchot, il se passe donc quelque chose d’inédit du côté du langage lorsque des personnes qu’on n’attendait pas se mettent à prendre la rue, ou les ronds-points, pour porter une parole publique qui se construit en même temps qu’elle se formule, dans un agir commun.
Cet appel au dehors du discours – puisque cette parole ne reprend aucunement les schémas du discours politique auquel elle s’oppose – fait alors évoluer tous les détours des subjectivités en devenirs politiques, rehaussant la vie du langage telle que nous la vivons au quotidien depuis l’enfance, dans nos espaces plus ou moins privés et en dehors de toute injonction aux normes d’un discours formaté.
Au sein de cette vie du langage qui n’est autre qu’une pratique sociale, il n’y a d’ailleurs pas que les mots, mais tout un ensemble de signes, de regards, de mimiques, de tonalités, de rythmes, de gestes, de positionnements des corps, qui contribuent à l’élaboration des significations. C’est cet ensemble de pratiques partagées collectivement qui a su évoluer favorablement tout au long d’une année ponctuée par trois Assemblées des assemblées, pour concevoir progressivement un ensemble de préconisations et d’idées politiques visant à rompre avec les principes de la politique gouvernementale actuelle.
La préférence de l’expression directe par les réseaux sociaux, le choix de références en rupture avec l’élite, le refus de la politique professionnelle et des partis, sont autant d’éléments visant à l’élaboration d’un parcours singulier qui se définit plus que tout par sa défiance à l’égard du discours savant établi, sous toutes ses formes. Il n’en reste pas moins que l’hétérogénéité du mouvement ne permet en aucune façon de généraliser pour tous les ronds-points, sans compter que l’évolution des positionnements a été très nette au cours de l’année, ainsi que j’ai pu l’observer dans la petite ville de V.
Le spectre de la langue
Face à cette parole libre, les analystes opposent régulièrement les discours de la communication politique et médiatique, renommés selon les cas novlangue, novlangue managériale, discours managérial (les références à Orwell sont monnaie courante depuis plusieurs années) ou L.T.I. (en référence cette fois à Klemperer) : on ne compte plus les ouvrages, les sites, les blogs qui tentent d’expliquer combien les mots sont dévoyés, notamment en étant promus à des significations nouvelles souvent opposées à celles du sens courant. Cette nouvelle manière d’envisager les rapports humains en termes marchands, comptables et évaluables se double ainsi d’une série de procédés discursifs (dont l’euphémisation, très prisée) et s’impose dans l’espace de la communication.
Le problème qui se pose face à ce phénomène généralisé concerne le recours à la vieille métaphore biologique de la « maladie » de la langue, de sa « décomposition », « dégénérescence », « altération », « corruption », etc. Henri Meschonnic a montré déjà depuis longtemps combien ce fantasme de la « détérioration » de la langue s’inscrit dans une longue histoire de la pureté comme fondement de l’ordre de la langue.
Appréhendée comme un organon avec sa vie propre (sa naissance et sa mort redoutée), la langue présente tous les attributs du corps malade dont le renvoi à l’origine se meut en une fiction totalisante. Cette vision essentialiste est propice au surgissement de tous les démons de l’altérité venant « souiller » la pureté de cet idéal d’homogénéité.
Penser que la langue est « contaminée » par ces procédés, c’est aussi supposer qu’elle a enregistré des définitions de mots de manière définitive et immuable. On sait pourtant que les dictionnaires, garants de cette supposée stabilité de « la » langue, sont eux-mêmes des livres écrits, qui n’ont pas valeur de code législatif, et sont sujets à des modifications car la langue est bien tout sauf ce répertoire fixe, naturalisé et idéalisé qu’on aimerait qu’elle soit. On sait au contraire que la variabilité des significations est au principe même de la vie du langage, tout comme la variabilité des écritures est au principe du livre.
L’erreur, certes véhiculée depuis très longtemps et confortée par le structuralisme tout au long du XXe siècle, est de continuer à penser que, d’une part, la parole est issue de la langue qui viendrait en garantir la forme ; et, d’autre part, que cette supposée langue reflète la vision du monde et la pensée de ses locuteurs (du « peuple »), vieux restes de l’hypothèse de Whorf (mal nommée Sapir-Whorf) dont les prémisses se trouvent bien avant dans les écrits des penseurs européens du XIXe siècle, chez Humboldt notamment.
Bien au contraire, la langue est une construction politique qui a été initiée en France au début du XVIIe siècle afin de circonscrire puis de réifier, déjà à cette époque, l’hétérogénéité et la plurivocité de la parole, soit l’expression de toute forme langagière. Cette longue histoire de l’invention des langues en lien à la construction des nations est très complexe, et je n’y reviendrai pas ici puisque tout cela a été démontré ailleurs. Toutefois, elle doit nous permettre d’envisager autrement la question qui se pose à nous aujourd’hui.
Si chacun est libre de s’amuser avec les mots, d’en changer, d’en fixer, d’en inventer les significations (c’est le propre de la poésie que de jouer avec la plurivocité du langage : analogies, implicites, équivoques, recours au figural, etc.), pourquoi les transformations des significations entamées par les managers, qui sont maintenant au pouvoir, nous posent-elles problème ? Comment soutenir qu’une partie de la population aurait le droit de transformer le langage et pas l’autre ? Au nom de quel principe moral ? Peut-on mettre en avant « nos » mots (les bons) contre les « leurs » (les mauvais) ?
Les mots sont-ils des choses ?
À se poser ces simples questions, il vient une évidence : la langue n’est pas en cause, car la langue est sans qualité aucune, chacun peut faire ce qu’il veut avec. La langue n’est ni trahie, ni meurtrie. Dans son principe même, la langue suppose une multitude de significations, le tout possible du dicible, mais aussi du non-dicible voire de l’indicible. L’enjeu est donc ailleurs : il réside dans l’ordre politique du contrôle des significations, soit la réduction de la polysémie par l’imposition d’un seul sens obligatoire, qui conduit alors à se poser une autre question : qui a intérêt à ce qu’un terme ne possède plus qu’une seule signification ? Qui a intérêt à astreindre un mot à une chose ou à une seule idée ?
Cette approche purement référentielle du langage, est justement au cœur de la conception qui est imposée par le pouvoir actuellement, de manière cette fois systématique par tous les membres du gouvernement. Elle implique qu’à un signifiant corresponde une seule signification, et conduit à des attitudes singulières de « mise en quarantaine » des mots : exactement ce qui constitue le travail des idéologues dans 1984, soit l’éradication des anciennes significations et leur remplacement par de nouvelles. Autrement dit : une simple tâche de substitution reposant sur la même considération figée, la même logique organique du langage.
Si aucun mot ne peut exister sans discours, sans la complexité des sens dont il a été affublé au cours de l’histoire, certains voient parfois leur sens se cristalliser, notamment lorsqu’ils s’inscrivent dans des événements socio-politiques puissants. Ce sont justement ces mots liés à des événements symboliques qui sont visés, et ainsi vidés de leur sens, lorsque les termes qui les décrivent sont redéfinis.
Plus que la langue, c’est donc le réel (historique) qui est visé : ce à quoi se livrent les dirigeants, ce n’est pas une atteinte à la langue ou au langage, mais une chose bien connue : le mensonge, la mystification, la calomnie. À en croire le président, par exemple, cette année pourtant sanglante en matière de répression policière, a été marquée par le « dialogue respectueux » avec les Gilets jaunes. La logique gestionnaire du capitalisme et sa propension à tout remodeler pour ses propres besoins aboutissent ainsi à la mise en cause de toutes les références historiques mais aussi à la fabrication déjà dans le présent d’une histoire écrite par le pouvoir dans le déni pur de tout réel.
Parler malgré tout
L’hétérogénéité de la parole des Gilets jaunes (et bien d’autres) en témoigne : parler reste indéniablement vital car nous ne pouvons nous passer de la plurivocité et de ce qui atteste le lien du langage non aux objets seuls mais, au-delà, aux contextes, à tout ce qui inscrit le réel dans le langage et vice versa. Cette organisation langagière porte le nom d’indexicalité, en ce qu’elle assure le lien du langage à l’environnement social immédiat, mais aussi au déjà-dit, aux discours antérieurs, et donc à son histoire sociale et politique. Ce principe, qui fait que nous parlons toujours avec les mots des autres, est impossible à abolir, quelles que soient les tentatives de type orwellien.
Ainsi, parler c’est aussi rompre avec la force régulatrice de l’imposition de la langue, quelle qu’elle soit. C’est en ce sens que la parole des Gilets jaunes vient tantôt se réapproprier des significations mises en péril (la Révolution, la Commune, le Front populaire, les acquis sociaux, etc.), tantôt inventer des expressions (« on est pas si fist », « gilet jauner », « raz-le-bol », « « veni vidi vomi », « Gilets jaunes sans culotte », etc.), tout cela dans l’enthousiasme d’une liberté assumée au sein de laquelle il n’est parfois pas nécessaire de s’attarder sur l’orthographe, sur les règles de grammaire, etc. À V., les seuls moments où des discours normatifs sont apparus, parce que touchant à l’image extérieure du groupe, ont été ceux consacrés à la rédaction d’affiches ou de tracts, dont bon nombre ont toutefois été marqués d’un certain nombre d’erreurs, sans que cela n’émeuve outre mesure.
L’hétérogénéité des écritures, la pluralité des manières de parler, le jeu permanent avec les significations se joignent, alternent et concourent à constituer une résistance forte qui semble se renouveler actuellement, visant les formes d’autorité imposées que sont à la fois la langue en tant qu’institution normative révélatrice, si ce n’est productrice, d’inégalités douloureuses, et le discours managérial en tant que détournement du réel. Paradoxalement, la libération de la parole se produit d’autant plus aisément que la mise en cause d’une domination linguistique des élites met inévitablement en lumière le fait que celle-ci a trop longtemps servi à mépriser les moins dotés en « capital culturel ».
Ce mouvement langagier, de par sa puissance collective, fait probablement advenir cet agir commun cher à Pierre Dardot, qui « produit un sujet collectif en opérant une transformation des singularités », en ce sens que les Gilets jaunes sont tout entier pris (et probablement pour longtemps encore) dans une subjectivation collective qui s’invente à mesure qu’elle se construit.