Une politique étrangère américaine en miettes
L’assassinat illégal du général iranien Qassem Soleimani a rouvert la boite de pandore des pathologies américaines en matière de politique étrangère. À l’heure où démarre au Sénat le procès d’impeachment de Donald Trump, les Démocrates accusent l’administration d’avoir recouru à l’une des plus vieilles ruses de l’histoire : faire oublier un ennui domestique par une aventure militaire étrangère. Sans surprise, les Trumpistes appellent de leur côté à se réunir autour du drapeau national. La tentative de réimposer le pouvoir du Congrès américain sur les questions de guerre et de paix, par une résolution votée à la chambre de représentants, frappe quant à elle par son inconséquence tardive.
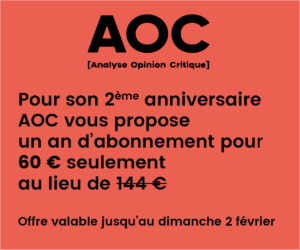
Il serait toutefois trop facile d’imputer cette crise aux humeurs de Trump, ce serait ignorer le climat intellectuel qui règne dans les couloirs de Washington et dans les salles de rédaction étatsuniennes. Climat parfaitement exprimé par les titres des essais récents des mandarins de la géopolitique américaine, tel l’essai de Robert Kagan, The Jungle Grows. Back America and Our Imperiled World (« La jungle est de retour : L’Amérique et notre monde en péril », non traduit). Pour le politologue néoconservateur, la seule chose qui nous sépare de 1938 et des accords de Munich – la référence à l’apaisement pour expliquer le rapport aux ennemis du monde occidental étant la sine qua non de la légitimé intellectuelle – ce serait le déploiement franc et sans scrupules du pouvoir militaire américain.
Cette affaire iranienne – certes exceptionnelle du fait de l’importance de Soleimani dans la hiérarchie politique de l’Iran et du fait qu’elle nous éloigne encore plus de l’ouverture diplomatique amorcée en 2015 – révèle donc, malgré ce que l’on aimerait croire, une pratique devenue banale : la présidentialisation du pouvoir militaire.
Ce que reprochent les éditorialistes du New York Times au président Trump, ce n’est pas tant le principe selon lequel les États-Unis devraient intervenir militairement, suivant leur gré, aux quatre coins du monde. « La vraie question à se poser concernant la frappe par drone qui a tué le général Quassem Soleimani n’est pas si elle était justifiée ou pas » écrit ainsi l’éditorial du New York Times du 3 Janvier, « mais s’il était prudent. » Pour traduire : s’agissait-il d’une bonne application du droit d’exception dont disposent les États-Unis dans la politique mondiale ? A-t-on affaire, en bref, à une faute purement tactique ?
Cette drôle d’opposition entre le nationalisme de Trump et une posture soi-disant « réaliste » sonne ainsi de plus en plus creuse, dans un pays épuisé par les guerres interminables menées depuis plusieurs décennies. Les condamnations franches et sans nuances d’une partie croissante de l’opinion publique, et les manifestations qui ont déferlé dans des dizaines de villes américaines contre une éventuelle escalade militaire, nous donnent au moins une raison de nous réjouir. La politique étrangère fait enfin débat aux États-Unis.
Il devient impossible d’ignorer qu’il existe une erreur, un mal, et un danger profond dans la manière dont les États-Unis se comportent dans les affaires internationales. Erreur qui se traduit par l’énorme gâchis que représentent nos dépenses militaires, dont le montant va passer de 719 à 738 milliards de dollars en 2020. Mal, au vu de la destruction humaine et sociale dont sont victimes les pays cibles des croisades américaines. Danger, puisque rien ne mine plus un système international fondé, en théorie, sur le droit et la délibération, que la violation de ses principes par l’État qui prétend en être le garant.
La ligne America First ne signifie en rien le retrait des États-Unis des affaires mondiales.
Rien ne semble plus étranger pour nous aujourd’hui que cette vieille rengaine dans le lexique politique américain : « Politics stops at the water’s edge » (la politique s’arrête au bord de l’eau). On est en 1948, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Arthur Vandenburg, Républicain à la tête de la puissante commission aux affaires étrangères du Sénat, pourrait enterrer les projets ambitieux du président Démocrate Harry Truman de doper la puissance américaine par un vaste appareil d’institutions et d’accords internationaux, dont l’OTAN. L’accord de Vandenburg n’avait rien d’évident — un mouvement prétendu isolationniste avait ainsi mis fin à une tentative similaire de Woodrow Wilson en 1919. Pourtant, le sénateur du Michigan donna son feu vert, adhérant ainsi, avec son parti, aux initiatives du président et à un rôle radicalement nouveau des États-Unis sur la scène internationale.
Ce que l’on nommerait désormais le « consensus bipartisan » signifiait l’accord de l’élite politique américaine sur la volonté des États-Unis de se servir de sa puissance politique, économique et surtout militaire afin d’assurer un ordre international basé en principe sur le libre-échange et la loi internationale. En principe, au moins, car une lecture plus sceptique de la politique étrangère des États-Unis depuis 1945 inscrirait le nouvel internationalisme dans l’histoire longue de l’interventionnisme américain, au nom surtout des intérêts économiques nationaux. Depuis le premier tiers du XIXe siècle, et la fameuse Doctrine Monroe qui étendait l’influence étatsunienne sur tout le continent, la politique américaine n’avait en effet rien d’isolationniste.
Les États-Unis se devaient de créer une sphère continentale protégée des ingérences européennes, pacifiée par la douce tutelle du commerce. Le cas échéant, les États-Unis ont su préserver l’ordre dans son « arrière-cour » continentale par l’intervention militaire, comme le déploiement quasi-perpétuel à partir de 1898 des forces militaires américaine à travers l’Amérique centrale en atteste.
À l’heure de la guerre froide, le consensus bipartisan marquait donc la mutation d’un accord sur la responsabilité des États-Unis à gérer les affaires continentales, en une extension de la sphère légitime des intérêts nationaux au monde entier. Certes, des éventuels désaccords divisaient, et divisent encore, l’élite américaine quant à sa manière d’exercer cette responsabilité auto-déclarée.
Pour gagner la guerre froide, par exemple, la politique du containment impliquait-elle le déploiement équilibré et tactique de la puissance américaine là où avançait l’influence communiste, dans l’espoir qu’avec le temps l’union soviétique s’effondrerait de ses propres faiblesses ? Ou bien, comme les faucons le prônaient au cours des années 1950 – à l’instar d’un John Foster Dulles –, est-ce qu’elle nécessitait une stratégie explicite de roll-back, de faire reculer les tentacules communistes par l’utilisation des armes nucléaires si nécessaire ?
Mais de tels désaccords ne sauraient cacher une entente plus profonde : les États-Unis, du fait de leur rôle prépondérant dans l’économie mondiale, seraient responsables d’agir en garant de la prospérité. La destinée manifeste impose d’assurer la paix internationale au seul pays porteur des valeurs libérales.
Les chroniques et les livres déplorant l’épuisement de la puissance américaine et la fin du consensus bipartisan abondent dans la presse et l’édition outre-Atlantique. À lire cette littérature, les États-Unis seraient retombés depuis l’élection de Trump dans une vision étroitement isolationniste et nationaliste de leurs intérêts. Si les retraits de l’accord de Paris sur le climat, ou de l’accord nucléaire iranien, marquent l’abandon d’un certain internationalisme américain, sur d’autres dossiers, l’administration Trump se révèle tout aussi internationaliste que ses prédécesseurs, de manière exclusivement belliciste cependant.
Si l’on considère la tentative ratée d’acter la chute du régime de Nicolas Maduro au Venezuela, ou bien celles jusqu’ici inabouties de certaines factions au sein de l’administration de fabriquer une guerre ouverte avec l’Iran, la ligne America First ne signifie en rien le retrait des États-Unis des affaires mondiales.
Mettant en cause les réalistes du parti Démocrate, la nouvelle gauche accuse ceux dans leur propre parti qui ont soutenu la guerre en Irak.
Or ce qui devient de plus en plus difficile à ignorer est le fait que le « consensus bipartisan » ne tient plus. On assiste, et heureusement, à une remise en cause de ses présupposés, à des désaccords profonds quant au rôle que devraient jouer les États-Unis dans la politique internationale. Et la contestation ne vient plus uniquement de la droite et de son virage nationaliste. La renaissance d’une gauche américaine avec l’ambition de prendre le pouvoir a changé la donne : on voit s’esquisser les bases d’un véritable internationalisme progressiste et démocratique.
L’élément déclencheur de ce clivage au sein de la gauche est bien sûr le désir général de tourner la page d’une longue série d’interventions militaires coûteuses et sanglantes, qui ont suscité de surcroît l’opposition de l’opinion internationale, que les États-Unis ont mené au Moyen-Orient et ailleurs. Mettant en cause les réalistes du parti Démocrate, la nouvelle gauche accuse ceux dans leur propre parti qui ont soutenu la guerre en Irak. Les années Obama ont-elles véritablement marqué un retournement de l’interventionnisme va-t-en-guerre de Bush ? Cette nouvelle gauche en doute et accuse les démocrates modérés d’avoir simplement changé de tactiques, préférant des manières dites « smart » ou « intelligent » de faire la guerre, comme par exemple l’utilisation des drones sur un terrain de guerre élargi, allant de l’Afrique au Pakistan, en dépit de son impact souvent dévastateur sur les civils dans les endroits touchés.
Si la nouvelle gauche ne minore pas les menaces tel le terrorisme, elle repense ses racines. Écartant le récit d’un conflit civilisationnel qui rendrait incapables les pays majoritairement musulmans de prendre la voie de la démocratie pluraliste, Bernie Sanders met en cause la connivence américaine avec les gouvernements autoritaires telles l’Arabie Saoudite et l’Égypte, allant jusqu’à mettre en accusation le coup d’État de 1953 en Iran lors d’un grand discours sur la politique internationale donné dans le Missouri en 2017.
Un moment rare dans la politique américaine est survenu pendant le débat télévisé du 20 Novembre dernier : Sanders a eu l’audace de critiquer une politique américaine trop indulgente à l’égard d’Israël, indulgence qui se traduit par un soutien verbal pour une solution binationale entre l’Israël et la Palestine, tout en acceptant de fait l’extension des colonies et le recul des droits palestiniens.
Mais la nouvelle gauche n’a pas l’intention de se limiter à un regret des échecs du passé : elle propose de revoir les institutions et les politiques du Consensus de Washington, celles qui ont formé le socle économique de l’ordre mondial américain depuis plusieurs décennies. Dans un article paru au début de 2019 dans la prestigieuse revue Foreign Affairs, la sénatrice Elizabeth Warren a sonné l’alarme, et accusé la dérégulation, la privatisation et la défiscalisation prônées par les institutions internationales tel le FMI d’attaquer les bases des institutions démocratiques à travers le monde, laissant ainsi un terrain fertile aux mouvements et aux idées autoritaires de s’incruster parmi les déçus de la mondialisation.
Les américains ont l’habitude de penser la politique étrangère de leurs dirigeants en termes d’une longue succession de doctrines. Dans le sillage de la doctrine Monroe, on peut citer, entres autres, la « doctrine » du président Eisenhower qui déclarait que les États du Moyen-Orient se sentant menacés par l’ingérence Russe pouvaient demander l’aide militaire et économique américaine, c’est-à-dire que les affaires de la région faisaient désormais partie de l’intérêt national des États-Unis.
S’il est trop tôt pour imaginer ce que serait la doctrine d’un président Sanders, par exemple, on peut au moins en imaginer les grands axes : réduction des dépenses militaires allant de pair avec une réduction du déploiement militaire américain ; refonte des institutions internationales en vue d’endiguer la montée des inégalités sociales et d’assurer la protection des droits des travailleurs contre un capitalisme débridé ; la participation active des États-Unis dans la lutte contre le dérèglement climatique, question intrinsèquement géopolitique en raison des inégalités en terme de pollution entre les différentes régions du monde, rendant inexorable une forme globale du Green New Deal.
À l’heure où les forces autoritaires avancent partout dans le monde, l’ironie dans toute cette histoire est que l’ambition avouée de Bernie Sanders d’inscrire les États-Unis dans un internationalisme démocratique et progressiste pourraient tout à fait réactiver un certain consensus bipartisan. Avec une modification, certes. Moins ambitieuse mais réaliste, la question devant nous semble être : l’Empire, peut-il être de gauche ?
