La suppression du CNU n’est pas une mesure néo-libérale
Proposer la suppression du Conseil national des universités (CNU) est souvent considéré comme une hérésie par beaucoup d’universitaires français. Pourtant, plusieurs des craintes que cela suscite sont infondées car cela fait déjà plusieurs décennies que le CNU n’est plus l’instance de contrôle d’une profession universitaire régulée par des concours nationaux, sans que cela porte atteinte au statut de la fonction publique ou soit la cause de l’accroissement de la compétition.
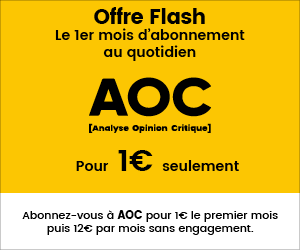
Comme le montre très bien les travaux d’Emmanuelle Picard, la régulation de notre profession universitaire a longtemps été caractérisée par un contrôle de l’accès et du déroulement des carrières par une instance nationale, aujourd’hui appelée CNU mais qui a connu beaucoup d’autres appellations depuis son ancêtre créé au début du XIXème siècle.
À travers l’inscription sur des listes d’aptitude (qui permettaient de se porter candidats) et la possibilité de modifier ou de refuser les propositions de classements émanant du niveau local, les recrutements ont longtemps fonctionné comme un concours national pour lequel les postes ouverts étaient considérés comme équivalents. Autrement dit, les établissements n’étaient pas censés avoir des besoins spécifiques ou rechercher des profils particuliers : un poste était égal à un autre poste, même si les postes parisiens étaient en général plus prestigieux et accessibles seulement en fin de carrière pour les professeurs.
Depuis les décrets de 1984 qui définissent le statut d’enseignant-chercheur tel qu’on le connaît aujourd’hui et qui a été en partie modifié par les décrets de 2009, mais surtout depuis la réforme de 1992 qui a retiré au CNU sa capacité de contrôle sur les classements mais lui a donné la possibilité de décider si un docteur est qualifié (selon l’expression consacrée) ou non à se présenter sur les postes ouverts, s’est opérée une transition de concours nationaux vers un marché du travail. L’existence du CNU ne l’a en rien empêchée. De ce point de vue, dire aujourd’hui que la suppression du CNU est une mesure néo-libérale qui conduit à mettre les enseignants-chercheurs en compétition, et qui menace une régulation nationale de la profession, est sans fondement car ce marché est déjà en place.
L’indifférenciation des postes qui faisait que n’importe quel candidat ou candidate ayant un dossier satisfaisant (inscrit sur la liste d’aptitude) pouvait aller sur n’importe quel poste (en dehors de Paris) et qui était au fondement du concours national n’est qu’un lointain souvenir ! Il suffit d’avoir participé à un comité de sélection ou de regarder les postes ouverts pour l’observer.
Aucune – ou alors très peu – d’universités se paieraient aujourd’hui le luxe de publier un poste sans préciser de manière détaillée les attentes, c’est-à-dire les enseignements que la personne recrutée devra assurer, les thématiques de recherche sur lesquelles elle est attendue, l’équipe de recherche qu’elle rejoindra… Réciproquement très peu ou aucun candidat ou candidate n’envoie plus de dossier standard, identique quel que soit le poste. Chacun et chacune essaie d’ajuster son CV à l’annonce, de montrer que les cours qu’il ou elle a donnés témoignent de ce qu’il ou elle est prêt à assurer ceux qui sont annoncés, que ses thématiques de recherche couvrent celle de l’équipe qu’il ou elle rejoindra.
La profession universitaire française fonctionne comme un marché du travail public. Le CNU n’est en rien un rempart contre cette évolution.
Bref, en France, comme dans beaucoup d’autres pays, et malgré le CNU, les recrutements universitaires se font sur un marché du travail, par la rencontre entre une offre et une demande. C’est déjà ce que j’avais observé lors d’enquêtes menées en France (mais aussi en Allemagne et aux Etats-Unis) à la toute fin des années 1990 et qui m’avaient conduite à rédiger un chapitre sur la variation de ce que signifiait « la qualité » d’un département universitaire à un autre.
J’avais en effet été frappée par le fait que pratiquement toutes les personnes rencontrées dans les trois pays et dans toutes les institutions étudiées affirmaient vouloir recruter le « meilleur candidat » mais qu’elles donnaient une définition assez différente de cette expression, d’un département à un autre, en fonction de leurs besoins, de leurs orientations, de leur public étudiant, des contraintes institutionnelles auxquelles elles étaient confrontées…
Observons par ailleurs que ce marché du travail universitaire n’est pas incompatible, en France comme en Allemagne, avec une fonction publique universitaire et même, dans le cas allemand, avec une négociation des conditions de travail (budget de recherche alloué, nombre de postes d’assistants attribués, heures de secrétariat accordées, et montant du salaire dans le cadre d’une fourchette depuis 2002) pour les professeurs, alors qu’ils sont fonctionnaires d’État.
Dans le cas français, cette forme du marché du travail s’est consolidée et la compétition s’est accentuée, CNU ou non, dans les années 2000 et 2010, non seulement parce que le nombre de postes ouverts a fortement décru (il a été divisé par deux entre 2005 et 2020) mais aussi et surtout parce que « la longue marche des universités » que j’ai décrite dans un ouvrage paru en 2001 s’est poursuivie. Les universités sont de plus en plus présentes institutionnellement dans le paysage universitaire français, avec des priorités, des projets, des profils particuliers qui les conduisent à rendre leurs offres d’emploi de plus en plus différenciées et liées aux objectifs du département ou du centre qui recrute.
Il est indéniable que cela est encore plus marqué depuis la loi de 2007 et surtout depuis la disposition prévoyant le passage aux « responsabilités et compétences élargies » ou RCE, qui a conduit à laisser aux universités la gestion de leur masse salariale et donc de leurs postes, dans la limite de plafonds d’emploi. Les réouvertures et les profils de poste ne sont plus validés par le ministère mais décidés au niveau des établissements, ce qui laisse encore plus de marge dans l’adaptation des postes aux besoins spécifiques des établissements.
La profession universitaire française, tout en gardant le statut de la fonction publique échappe ainsi de plus en plus au modèle du concours national et fonctionne comme un marché du travail public. Le CNU n’est en rien un rempart contre cette évolution.
Puisque le CNU n’a pas empêché la mise en place d’un marché du travail universitaire et que cela n’a pas menacé le statut des enseignants-chercheurs, il est spécieux de voir dans cette proposition de suppression une mesure qui aurait des conséquences néo-libérales. Quelles sont alors les justifications que l’on peut trouver à son maintien ? Pourquoi ne pas laisser aux établissements la responsabilité du choix des personnes alors qu’elles ont celle des postes ?
La raison la plus communément invoquée est que le passage par cette instance nationale garantit un minimum de qualité des candidats et candidates. En n’accordant la qualification qu’à certains titulaires du doctorat, ils réduisent la masse de ceux et celles qui peuvent se présenter sur les postes ouverts au recrutement aux seuls candidats et candidates remplissant un minimum de critères dont la plupart des sections du CNU ont précisé la liste : qualité de la thèse, publications dans des revues à comité de lecture, expériences d’enseignement, sont des éléments très souvent a minima attendus dans les dossiers de candidature pour être qualifiés.
La seule question qui vaille est de savoir si on a encore besoin de sections nationales qui siègent plusieurs jours pour garantir la qualité attendue.
Le CNU aurait ainsi un rôle de filtre que l’on soupçonne les commissions locales des universités de ne pas savoir tenir. Les membres de ces dernières sont notamment suspectés de ne pas savoir résister à la pression morale que peuvent exercer les doctorants et doctorantes formés sur place et en attente d’un poste, de ne pas être aussi exigeants sur la qualité scientifique que les instances nationales, ou de donner la priorité à des candidats ou candidates dont ils sont sûres qu’il ou elle acceptera le poste s’il lui est proposé, plutôt que de prendre le risque de le ou la voir préférer une autre offre… J’ai aussi souvent entendu des justifications plus méprisantes quand les défenseurs du CNU expliquent que les membres des commissions locales ont peur des candidats ou candidates meilleurs qu’eux et recrutent donc systématiquement de plus médiocres pour ne pas se mettre en danger.
Mais le CNU est-il vraiment le seul moyen d’être un rempart contre une qualité insuffisante ? Certainement pas ! Il semble d’ailleurs que la définition de la qualité soit assez différente d’une section à une autre. Les taux de qualification varient de manière impressionnante pouvant atteindre 80% des candidatures dans certaines sections – ce qui revient à laisser quasiment toute marge de manœuvre aux établissements qui recrutent – mais chuter à 30% dans d’autres, ce qui au contraire limite les capacités locales. Mais laissons là, l’épineuse appréciation du travail mené par les sections et le vain débat sur la qualité et l’impartialité de leurs décisions.
La seule question qui vaille est de savoir si on a encore besoin de sections nationales qui siègent plusieurs jours pour garantir la qualité attendue. Or il me semble que tout comme le statut de la fonction publique n’est pas lié au maintien du CNU, la qualité des recrutements peut être respectée sans le CNU. D’autres dispositifs peuvent conduire aux mêmes résultats.
On pourrait par exemple donner aux établissements, et notamment aux instances universitaires que sont le Conseil d’Administration (CA) ou le Conseil Académique (CAC) restreints aux seuls universitaires et chercheurs, la possibilité de contrôler les décisions prises par les comités de sélection constitués pour chaque recrutement par la discipline concernée.
Les classements établis par ces derniers devraient pouvoir être modifiés, ou refusés par les pairs des instances centrales de l’université. Cela supposerait que les comités défendent leurs classements devant le CA ou le CAC restreints et que ces derniers définissent les niveaux de qualité attendus des recrutements de leur établissement, qu’ils aient pour mission de contrôler que les propositions de recrutement les respectent et qu’ils puissent barrer ou modifier un classement si ce n’est pas le cas.
Même si cela m’a toujours semblé une solution extrême qui ne devrait être que temporaire, rien n’empêcherait ces instances universitaires d’adopter pour principe que les recrutements locaux sont interdits, ou de spécifier les cas exceptionnels où ils pourraient être permis.
Par ailleurs, plutôt que de demander à des collègues d’autres universités de siéger dans nos comités de sélection (aujourd’hui ils doivent constituer 50% de chaque comité), de financer les déplacements des membres extérieurs (plutôt que ceux des candidats que l’on auditionne, ce qui serait plus logique ) et de limiter à une petite journée la réception des auditionnés parce qu’on ne peut abuser plus du temps de collègues venant d’ailleurs, pourquoi ne pas non plus modifier le rôle des extérieurs ? Solliciter deux ou trois personnes et leur demander comment ils classeraient les quatre candidats et candidates convoqués à l’audition et pourquoi, serait plus judicieux et donnerait aussi des éléments de jugement au CA ou CAC restreint quand leurs membres devraient se prononcer sur un classement.
Ce ne sont là que quelques pistes et il y a probablement d’autres solutions et d’autres aménagements envisageables pour mettre en place une délégation du contrôle de la qualité aux établissements. Il va de soi que cela ne fait sens que si la mise en situation professionnelle (le fait de donner une leçon ou de faire un séminaire de recherche si on est auditionné) est effectivement généralisée, le nombre d’auditionnés moins important, le temps consacré aux recrutements plus long…
Plusieurs conséquences positives pourraient en découler. Ainsi, on pourrait attendre d’une telle évolution que les associations professionnelles de disciplines se saisissent d’un rôle que l’existence du CNU les empêche de jouer vraiment alors qu’elles sont pourtant légitimes à définir leurs contours, à se constituer en groupes de pression, à suivre les carrières de leurs membres, à définir leurs niveaux d’exigence. Une autre conséquence serait de rendre nos modalités de recrutement plus compatibles avec celles de nos collègues européens qui ont bien du mal à comprendre les subtilités de la qualification !
Bref, ne déplorons pas la suppression d’une institution qui date du XIXème siècle et ne lui attribuons pas un rôle de protection du statut la fonction publique qu’elle n’assume en fait pas ou de garant de la qualité que d’autres mécanismes pourraient jouer. Garder le CNU n’aurait de sens que si on redonnait au ministère la gestion des postes et au CNU le contrôle des classements. Cela fait longtemps que ce temps est révolu. Saisissons plutôt l’opportunité pour repenser les régulations professionnelles, de les rendre plus en phase avec les évolutions récentes sans pour autant renoncer ni au statut de la fonction publique, ni à la gestion des pairs par les pairs.
