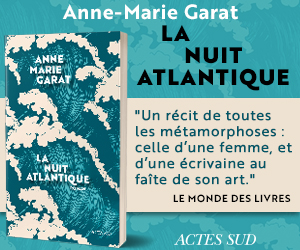Les ouvrières de la mode, entre luxe et blouse
Que vous apparteniez à la catégorie de celles et ceux qui pendant le confinement n’ont négligé aucun élément de leur accoutrement, ou alors que vous n’ayez pas quitté pendant plusieurs semaines vos vêtements de sport, vous aurez probablement constaté que vous avez beaucoup trop d’habits.
L’industrie de la mode est en France plus puissante que celles de l’automobile et de l’aéronautique. En 2016, elle représentait 150 millions d’euros de chiffre d’affaire direct, 2,7 du PIB et 580 000 emplois directs. Cette économie de la richesse va de pair avec une économie du gaspillage et de la pollution : 30 % des habits achetés par les Français ne sont jamais portés et s’entassent dans les 600 000 tonnes de textile qui sont jetées chaque année.
Les habits sont une affaire sérieuse en France, et ils occupent une place importante dans les consommations, les métiers, les désirs, les villes, les rues et les espaces de rangement des Français·e·s. Fermez les yeux un instant, et essayez de vous figurer tous les vêtements qui depuis le début du confinement attendaient dans les magasins de votre ville. Parcourez-les, ces rues marchandes, ces grands magasins, ces centres commerciaux, ces rayons, ces étagères, ces cintres, et multipliez-les à l’échelle de la nation. C’est vertigineux.
On pourrait se dire que ces habits-là, ceux de la fast fashion, produits par les nouveaux esclaves du capitalisme, ne sont pas ceux qui font la puissance de la France dans la mode. Ce n’est que partiellement exact : seulement une infime partie des produits made in France sont fabriqués dans l’hexagone. Pour pouvoir afficher le label made in France, il suffit qu’une moindre partie du coût final de production (aux alentours de 30%) ait été réalisé en France. Donc si le coût global de votre chemise faite en Bangladesh, en Inde, en Chine, en Éthiopie, en Turquie, au Vietnam, au Cambodge, au Mexique, au Venezuela, est de trois euros, mais que l’application des boutons a été faite en France et que celle-ci a couté trente centimes sur les trois euros, alors votre chemise sera made in France. Elle pourra dès lors être vendue cent fois, voire plus, le prix de production.
C’est ainsi que fonctionne une grande partie de l’industrie du luxe. Le Made in France et les conglomérats de marques de luxe français LVMH et Kering pèsent lourd dans l’économie de la nation, et rayonnent dans les imaginaires globaux de l’élégance en vendant, avant tout, l’imaginaire de qualité et de raffinement lié à la France. L’industrie de la mode française fonde sa puissance sur la production d’un rêve de luxe et de beauté.
On s’habille pour communiquer, certes, mais avant tout on se couvre pour se protéger.
C’est bien ce rêve-là, avec le désir de se transformer dans son corps, dans son statut social, dans son identité, qui explique que nous ayons tout·e·s bien plus d’habits que nous n’en avons besoin pour nous couvrir. Il n’y a rien d’amoral à cela : les vêtements sont la peau que nous choisissons. Depuis la nuit des temps et dans toutes les latitudes du globe, nous disons quelque chose de nous, de comment notre société est organisée et de la place que nous y occupons, par les habits. La confection, à laquelle s’est ajoutée ensuite sa variante industrielle, la mode, a transcendé et survécu aux époques, aux crises, aux grandes transformations, car elle occupe une fonction à la fois culturelle et vitale. On s’habille pour communiquer, certes, mais avant tout on se couvre pour se protéger.
C’est dans ce contexte d’accumulation et de surproduction d’habits et d’immense pouvoir économique de la mode française que Mediapart a publié, le 7 avril 2020, une enquête relative au manque de sur-blouses et de blouses dans les hôpitaux français. Celles et ceux qui sont en première ligne dans la confrontation avec le virus Covid-19 risquent leur vie, car elles et ils n’ont pas de quoi se couvrir correctement. Dans une situation d’urgence, de drame, de danger, comme celle qui est vécue présentement dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, les habits sont soudainement dépouillés de leur fonction distinctive, sociale, esthétique pour investir complètement leur fonction primordiale : protéger.
Mais la France, où la mode est la deuxième industrie la plus puissante après le pétrole, n’est pas en mesure de couvrir pour sauver celles et ceux qui sont dans un corps à corps avec la maladie. Si nous « endurons », pour reprendre le registre sémantique martial cher au Président de la République, nous concluons que celui-ci envoie ses soldats dénudés sur le front.
Nombreuses ont été les pénuries qui nous ont mis face aux dramatiques conséquences des délocalisations et des multiples démantèlements du pouvoir de l’État face à la puissance du capitalisme néolibéral. Nous l’avons vu bien sûr avec les médicaments, le gel hydroalcoolique, les masques. Mais la symbolique des soignants réduits à se couvrir de sur-blouses réalisées avec des sacs-poubelle par le personnel administratif des hôpitaux, et des soignants contraints, par la carence, de garder les blouses sales, propageant ainsi le virus, est tout de même frappante.
Dans un communiqué de presse émis le 21 mars et largement diffusé par les médias, le groupe LVMH, dont le patron est Bernard Arnaud, la deuxième fortune de la planète avec un patrimoine estimé en 2019 à 91,7 milliards d’euros, informe avoir pris la décision de « trouver un fournisseur industriel chinois capable de livrer dix millions de masques en France dans les prochains jours (sept millions de masques chirurgicaux et trois millions de masques FFP2). L’opération pourra être renouvelée durant au moins quatre semaines dans des quantités similaires (soit environ 40 millions de masques). »
Et encore : « Afin de sécuriser cette commande dans un contexte extrêmement tendu et de permettre à la production de commencer dès aujourd’hui, Bernard Arnault a souhaité que LVMH finance intégralement la première semaine de livraison, soit environ cinq millions d’euros, indique le communiqué. Le Groupe LVMH assurera ensuite la gestion, la livraison et le dédouanement de l’ensemble des livraisons. Grâce à cette contribution et à la mobilisation de son réseau, LVMH devrait acheminer les premiers masques aux autorités sanitaires françaises en début de semaine prochaine. »
Les grandes entreprises, ou plutôt les grands patrons, les mêmes qui pratiquent l’optimisation et l’évasion fiscale, disposent des moyens économiques, structurels et logistiques pour combler les lacunes de l’État. L’État se montre incapable de produire, de protéger, de réagir, de réquisitionner, de réorienter les productions (comme on ferait par ailleurs en temps de guerre, si de guerre il s’agissait) et se montre ainsi à la merci du capital.
Un autre aspect de la relation entre crise sanitaire, capitalisme et mode mérite d’être relevé. Il s’agit du maillon de la chaîne du travail de la mode française impliqué dans la confrontation avec le virus : les couturières. Le 31 mars, la marque Dior (LVMH) a publié sur son compte Instagram un post en anglais : « nous sommes fiers d’avoir rouvert nos ateliers officiels à Redon, qui depuis hier ont commencé la production continue de masques sur base volontaire. Dior est engagé activement dans l’assistance et la protection de ceux qui sont quotidiennement sur le front. Merci à toutes nos merveilleuses petites mains [en français dans le post] qui, dans une exceptionnelle démonstration de solidarité, travaillent inlassablement pour les protéger. » Ce texte légende trois images de couturières en blouses blanches et masques, adonnées à la tâche de confectionner les masques. Une de ces images est un gros plan sur les doigts d’une couturière, qui tient le masque à proximité de l’aiguille de la machine à coudre.
Le travail de celles qui réalisent la matérialité des produits de la mode gagne soudainement le centre de la scène.
Comme dit plus haut, les productions de la mode réalisées en France sont principalement immatérielles. C’est en France, et à Paris surtout, qu’une multitude de designers ; créateurs ; stylistes ; chasseurs de tendance ; travailleurs en bureau de style ; mannequins ; photographes ; chefs de production ; coiffeurs ; graphistes ; maquilleurs ; retoucheurs ; manucures ; journalistes ; blogueuses ; influenceuses ; set designers ; web designers ; stagiaires ; responsables commerciaux ; responsables marketing ; vendeurs ; visual marchandisers ; directeurs de collection ; directeurs créatifs ; directeurs artistiques ; pour citer quelques uns des nombreux métiers de la mode, travaillent pour assurer les gains de cette industrie à l’excellente santé financière.
Elles et ils travaillent énormément, avec passion, dévouement et compétence. Et ce, en étant très souvent récompensé·e·s non pas en argent, mais en prestige social, en espoir d’un poste ou d’un salaire à venir et, avant tout, en visibilité. Car ce sont les travailleur·euse·s créatif·ve·s, celles et ceux qui font les images et les imaginaires qui attisent les désirs de consommation par les pages de papier glacé, les défilés et les campagnes publicitaires, qui sont habituellement au centre des représentations médiatiques du monde de la mode. C’est cette multitude-là, celle d’une élite symbolique qui incarne et produit les imaginaires désirables, que l’on voit habituellement sur les réseaux sociaux, dans la presse dans les nombreux documentaires sur les coulisses de la mode. Ce ne sont pas les couturières.
Lorsque le capitalisme a viré dans sa phase néolibérale et que l’Europe a démantelé son tissu industriel en le délocalisant, la notion de créativité a gagné une place centrale dans le travail. Dans la mode, au cours des quarante dernières décennies, les couturiers et modélistes sont devenus créateurs ou directeurs artistiques, et l’image a radicalement pris le dessus sur la matière. Mais en temps de confinement et de crise sanitaire, cette foule créative s’éloigne dans une nébuleuse et laisse la place, dans les images, les discours et les usines, aux ouvrières. Le travail de celles qui réalisent la matérialité des produits de la mode (les imaginaires servent d’abord à vendre le produit : sans produit, il n’y a pas d’industrie de la mode), ce travail habituellement invisibilisé ou occulté par les imaginaires, les métiers et les corps désirables, gagne soudainement le centre de la scène.
Les images mises en circulation par le post Instagram de Dior sont fascinantes pour ce qu’elles exposent. On y voit des ciseaux ; des machines à coudre ; des mains non manucurées ; des néons ; des espaces sans fenêtre ; des corps ordinaires ; des poubelles à papier ; du linoléum au sol ; des câbles. Elles sont également fascinantes pour ce qu’elles ne montrent pas. Dans ces images de Dior, marque phare du groupe LVMH et emblème mondial du luxe à la française, aucun élément ne renvoie à Dior ou au luxe : pas de corps retouchés, d’habits cossus, d’objets fétichisés, de lieux emblématiques. Nous y voyons une usine textile, avec des ouvrières à l’œuvre. Une situation qui a relativement peu changé depuis l’essor de la machine à coudre autour de la moitié du XIXe siècle.
C’est comme si, soudainement, tout le dispositif mis en place pour produire le rêve de la mode (les caméras ; les podiums ; les projecteurs ; les images twittées, postées, diffusées ; tout l’apparat de dentelles, de paillettes, de maquillage ; tous ces corps disciplinés et voués à l’esthétique), s’était écroulé. Et ce qui reste, ce sont celles qui font. Ce sont celles qui sont derrière leurs machines et qui savent les faire fonctionner, qui savent assembler la matière pour la transformer en ce dont nous avons besoin, en l’occurrence des masques et des blouses.
Comme pour les soignantes, les aides-soignantes, les assistantes de vie, comme pour les caissières, les enseignantes, les mères, la situation présente, dans son bouleversement carnavalesque, dévoile le travail invisibilisé mais nécessaire des couturières. Un travail qui, aussi bien dans sa version industrielle que dans sa version artisanale et à domicile de confection, est historiquement relégué à des femmes, souvent exploitées et mal rémunérées. Un travail par ailleurs « volontaire » (payé par qui ? Par l’entreprise ou par les caisses du chômage ? Payer comment et combien ?), qui est en ce moment au service de celles et ceux qui soignent. Un travail qui couvre et qui protège.
Ce travail, à l’instar de celui du care et de tous ces métiers qui « tiennent la société », est très peu valorisé dans les économies symboliques de la mode et du capitalisme contemporain. Preuve en est de l’appellation de « petites mains », par laquelle on désigne les ouvrières de la mode en France. Une métonymie qui réduit l’expertise, les gestes corporels et les subjectivités à l’œuvre dans l’activité de coudre à une partie du corps. Des mains qui sont petites non pas par stature, mais par statut. Par cette nomenclature, les ouvrières sont placées dans une sphère « affectueusement subalterne », qui par un même geste réduit et dépolitise.
L’étymologie du mot crise renvoie à la notion de séparation et de choix. Ce sont des mots qui en ce moment n’ont rien d’une métaphore. Chez nous, nous vivons éloigné·e·s, écarté·e·s les un·e·s des autres. Dans les lieux de soin et dans les choix politiques nous sommes aussi, dramatiquement, trié·e·s. C’est ce que nous subissons malgré nous. Mais nous pouvons aussi profiter de ce moment précieux, parce qu’il donne à voir ce qui en temps ordinaire est bien là, mais hors scène. Un temps de crise alors pour sortir de nos placards et choisir ce à quoi nous tenons, afin de lui donner une place opportune, et nous débarrasser une fois pour toutes de l’inutile et du nuisible.