Au jardin des raisons adverses – de l’attention retrouvée au détail des choses
Durant des semaines, nous avons été confinés : assignés à des confins. Sommés d’habiter un territoire-limite, astreints à faire de nos paliers des zones frontalières et de nos balcons des avant-postes. Rendus par la force des choses au détail de ces dernières, nous avons réappris à les observer au fil du cycle de leurs apparitions. Une jardinière, un pot de fleurs, la trouée arborée entre deux immeubles se sont transformés, jour après jour, en petits théâtres du monde. La ramille du peuplier de la cour, le cotylédon d’une courge plantée dans une boîte en fer pour l’ébahissement et l’instruction des tout-petits, le vol d’un verdier, le bourgeon charnu d’une glycine : tout est devenu objet de notre attention – et de nos attentions.
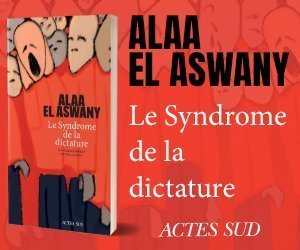
Nous avons scruté – consigné parfois – le déploiement des tiges, le mûrissement des baies, l’éclosion des petits êtres de sève. Nous nous sommes essayé, ne serait-ce que mentalement, à décrire ce qui germait et croissait devant nous – et nous avons peiné à trouver nos mots pour dire le tumulte des feuillaisons.
Cet art de l’observation du monde en ses surgissements, de l’inventaire chose par chose du réel, avait autrefois – il y a longtemps, mais pas si longtemps – rang de savoir. Les plus grands esprits s’abîmaient dans la contemplation du minuscule : l’élytre du scarabée, un éclat de quartz, l’épillet d’une graminée décidaient de vocations savantes et présidaient à de hautes carrières académiques. Voyez Darwin qui, sitôt installé dans ses douillets appartements de Christ’s College, à Cambridge, s’en va courir les bois en quête de panagées et de cicindèles – et qui écrit dans son autobiographie, un demi-siècle plus tard : « Chaque fois que j’entends parler de la capture d’espèces rares de scarabées, je me sens comme un vieux cheval de guerre au son du clairon ». Et voyez celui qui est alors son héros : Alexandre de Humboldt, dont les voyages en Amérique du Sud et au Mexique, de 1799 à 1804, eurent des décennies durant, pour tout jeune naturaliste, valeur d’épopée. Humboldt qui avait gagné, enfant, le surnom de « petit apothicaire » tant il excellait à rassembler en de surprenantes compositions les insectes, les pierres et les lichens glanés dans le parc du château familial de Tegel, aux portes de Berlin.
Humboldt est l’incarnation par excellence de la passion de la mesure du monde, qui puise aux sources du projet encyclopédiste des Lumières. Le canon de ce projet est aussi simple dans ses attendus que compliqué pour ce qui est de sa mise en œuvre : chaque chose doit être arrimée à ses propriétés, c’est-à-dire lestée de ses coordonnées – altitude, longitude, latitude, masse, densité, superficie, température, etc. Humboldt ne se déplace jamais sans ses carnets, ni sans ses nombreux instruments de mesure. Boussoles de déclinaison et d’inclinaison de Le Noir, montre à longitude de Berthoud, sextant de Ramsden, quart de cercle de Bird (pour les mesures angulaires), pendule et chronomètre de Seyffert, microscope de Hoffman, télescope de Caroché, aréomètre de Nicholson, thermomètre de Fortin, hygromètres de Saussure, théodolite de Hurter (pluviomètre), eudiomètre à phosphore (pour mesurer les variations de volume des mélanges gazeux), « bouteilles de Leyde » (agissant comme condensateur) : c’est toute la boutique de l’ancien régime des savoirs qui trouve place dans les bagages de Humboldt. Il n’est pas jusqu’au bleu du ciel dont la teinte ne se puisse mesurer, et ce grâce au nuancier à seize tons du cyanomètre construit à Genève par M. Paul – l’horloger attitré des naturalistes.
À l’instar de tant de grands noms de l’Académie qui font leurs armes dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, et qu’habite encore et toujours le rêve d’une science soustraite aux tyrannies du pouvoir et de l’opinion, Humboldt ne jure que par l’intelligence géométrique du monde – un monde réduit aux clefs mathématiques de ses proportions, ramené au juste et intangible rapport de ses volumes et de ses surfaces, à la vérité adamantine de ses angles. Si d’aucuns ont pu voir en Humboldt le « dernier savant universel », c’est qu’à travers lui se réitère un très ancien défi : celui d’une « histoire naturelle » de plain-pied avec le monde, capable de prendre dans les rets de son récit la totalité des êtres et des faits, quelle que soit la taille de leurs causes ou l’envergure de leurs conséquences. Ainsi écrit-il en 1834 à propos de son Cosmos, qu’il considère à juste titre « l’œuvre de sa vie » puisqu’il ne l’achève qu’en 1865, un an avant sa mort : « J’ai la folle idée de décrire, dans un seul et même ouvrage d’un style vif et d’une forme attrayante, tout le monde physique, tout ce que nous savons, depuis les nébuleuses jusqu’à la géographie des mousses sur les rochers granitiques. »
L’inventaire des phénomènes n’est cependant que le prélude à la mise en exergue des rapports qui les gouvernent : ce dont il est question, c’est de « saisir le monde des formes physiques dans leur connexité et leur influence mutuelles ». Les « lois de la nature » sont des liaisons, ou plus exactement des règles – mathématiques en leur principe – de co-variation des phénomènes : augmentez d’un degré la température, réduisez de deux centilitres l’hygrométrie, et la donne d’une flore et d’une faune change du tout au tout. Pour expliquer « la nature en grand », il faut donc s’armer d’une myriade de « connaissances spéciales », autrement dit de savoirs techniques particuliers. Le bon naturaliste se doit d’être tout à la fois géologue, chimiste, historien, botaniste, physicien, zoologue, paléontologue, météorologue, astronome, etc.
Cette « folle idée » d’une description qui ne retranche rien de ce qu’elle décrit, qui fait la part égale au gigantesque et à l’infinitésimal, à la galaxie et au lichen, on la trouve formulée depuis des siècles chez tous ceux – alchimistes, scoliastes et philosophes – qui rêvent d’une carte générale de la Création. Pour être folles, les idées n’en ont pas moins la vie dure, et un carnet de bal bien rempli. Qu’est-ce par exemple que la rêverie de Rousseau, sinon l’expression de ce même désir incandescent de donner de la nature une description exhaustive, de tenir un minutier de la réalité où tout se trouve dit sitôt que vu, consigné sitôt que contemplé ?
Les apparences ne sont pas trompeuses : elles sont tout ce que le monde nous concède pour le décrire.
À l’automne 1765, persuadé d’être la cible de toutes les perfidies, Rousseau cherche asile sur l’île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne, près de Berne. Délaissant sa correspondance, se refusant même à ouvrir les malles qui lui tiennent lieu de bibliothèque, il arpente chaque jour de long en large les bois, les prairies et les vergers de son refuge. Fasciné par la flore locale, il se met en devoir de l’inventorier, non pas en termes génériques, mais brin par brin. S’armant de la classification de Linné comme un sourcier d’une baguette de coudrier, il s’essaie, le nez dans les ronces, à épuiser les fleurs par les phrases :
« J’entrepris de décrire toutes les plantes de l’île sans en omettre une seule, avec un détail suffisant pour m’occuper le reste de mes jours. On dit qu’un Allemand a fait un livre sur un zeste de citron, j’en aurais fait un sur chaque gramen des prés, sur chaque mousse des bois, sur chaque lichen qui tapisse les rochers ; enfin je ne voulais pas laisser un poil d’herbe, pas un atome végétal qui ne fût amplement décrit. En conséquence de ce beau projet, tous les matins après le déjeuner, j’allais une loupe à la main et mon Systema naturae sous le bras, visiter un canton de l’île que j’avais pour cet effet divisée en petits carrés dans l’intention de les parcourir l’un après l’autre en chaque saison. […] La fourchure des deux longues étamines de la brunelle, le ressort de celles de l’ortie et de la pariétaire, l’explosion du fruit de la balsamine et de la capsule du buis, mille petits jeux de la fructification, que j’observais pour la première fois, me comblaient de joie, et j’allais demandant si l’on avait vu les cornes de la brunelle comme La Fontaine demandait si l’on avait lu Habacuc[1]. […] Je sens des extases, des ravissements inexprimables à me fondre pour ainsi dire dans le système des êtres, à m’identifier avec la nature entière. »
« Faire un livre sur chaque mousse des bois », doubler tout phénomène de sa description, indexer la moindre corolle, la plus petite ramille, et pour être certain de n’omettre aucun bourgeon, recommencer à chaque lunaison : quoi de plus insensé ? D’autant que le lac et les cieux cessent bien vite d’être, pour ce promeneur si obstinément occupé de sa solitude, des nappes de reflets offrant accès au tressautement du vivant. De surfaces chatoyantes ouvrant sur le mystère du « système des êtres », les voici devenues de simples miroirs, de ternes étendues où plus rien ne se lit que le sentiment de celui qui s’y mire : « De quoi jouit-on dans une pareille situation ? De rien d’extérieur à soi, de rien sinon de soi-même ». La chevauchée savante a tourné court, qui se promettait le bout du monde et s’achève au coin de l’âme.
D’où la première leçon de nos balcons : on peut regarder longtemps une fleur sans la voir. C’est ce qu’énonce, sentencieux, Alberto Caeiro – l’un des nombreux hétéronymes de Fernando Pessoa – dans Le Gardeur de troupeaux (1925) :
« Ce que nous voyons des choses, ce sont les choses.
Pourquoi verrions-nous une chose s’il y en avait une autre ?
L’essentiel, c’est qu’on sache voir,
Qu’on sache voir sans se mettre à penser […].
Il ne suffit pas d’ouvrir la fenêtre
Pour voir les champs et la rivière.
Il ne suffit pas de n’être pas aveugle
Pour voir les arbres et les fleurs.
Il ne faut avoir aucune philosophie.
Avec la philosophie il n’y a pas d’arbres : il n’y a que des idées.
Il n’y a que chacun d’entre nous, pareil à une cave[2]. »
Les apparences ne sont pas trompeuses : elles sont tout ce que le monde nous concède pour le décrire. Les choses ne sont donc pas, comme le voulait Jean Moréas dans son manifeste symboliste (1886), de « somptueuses simarres », la garde-robe des « Idées primordiales » : elles sont le réel à la manœuvre, la nature en bleu de travail. Et Caeiro-Pessoa, le vieux professeur de nominalisme, de conclure : « Mieux vaut voir toujours une chose pour la première fois que la connaître ». De Rousseau à Pessoa en passant par Humboldt : l’itinéraire peut surprendre. Mais les idées taillent toujours plus grand que ceux qui les ont – c’est ce qui fait que beaucoup les portent. La rêverie de Jean-Jacques est tout sauf solitaire.
En ouverture de ses Epoques de la nature (1780), Buffon, le grand ordonnateur du vivant, juge lui aussi sans limites le territoire de l’« histoire naturelle » : « L’Histoire naturelle embrasse également tous les espaces, tous les temps, et n’a d’autre limites que celles de l’Univers. La nature étant contemporaine de la matière, de l’espace et du temps, son histoire est celle de toutes les substances, de tous les lieux, de tous les âges. » La toile n’aura donc pas de bords : reste le problème du chevalet. L’insistance de Humboldt sur la nécessité de rendre compte d’un même mouvement, et d’un même style, non seulement des différentes composantes d’un paysage, mais aussi des relations d’interdépendance qui les unissent, l’amène à porter une attention particulière aux outils de la description.
Lors de son voyage aux Amériques, il emporte un exemplaire du Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre (1788). Or, s’il en critique les imprécisions scientifiques – l’ouvrage est, hélas, « déparé par de graves erreurs de physique » –, il en loue sans réserve le réalisme : « L’aspect de la mer, les nuages qui s’amoncellent, le vent qui murmure à travers les buissons de bambous, les hauts palmiers qui courbent leur tête, sont décrits avec une vérité inimitable ». Faute d’une syntaxe aussi fluide que la brise, il est toutefois extrêmement difficile de rendre, au moyen des mots et des mots seulement, une scène naturelle. Bernardin de Saint-Pierre s’en désolait déjà dans son Voyage à l’Île de France (1773) : « À force de nous naturaliser avec les arts, la nature nous devient étrangère ; nous sommes même si artificiels, que nous appelons les objets naturels des curiosités […].
Ce qui nous manque, pour dire un paysage, ce n’est pas la litanie des latinismes, mais des dictionnaires entiers de formes, de couleurs et de textures.
L’art de rendre la nature est si nouveau que les termes mêmes n’en sont pas inventés. Essayez de faire la description d’une montagne de manière à la faire reconnaître : quand vous aurez parlé de la base, des flancs et du sommet, vous aurez tout dit. Mais que de variété dans ces formes bombées, arrondies, allongées, aplaties, cavées etc. ! Vous ne trouvez que des périphrases. C’est la même difficulté pour les plaines et les vallons. Qu’on ait à décrire un palais, ce n’est plus le même embarras : […] du socle à la corniche, il n’y a pas une moulure qui n’ait son nom.
Il n’est donc pas étonnant que les voyageurs rendent si mal les objets naturels. S’ils vous dépeignent un pays, vous y voyez des villes, des fleuves et des montagnes, mais leurs descriptions sont arides comme des cartes de géographie : l’Hindoustan ressemble à l’Europe. La physionomie n’y est pas. Parlent-ils d’une plante ? Ils en détaillent bien les fleurs, les feuilles, l’écorce, les racines ; mais son port, son ensemble, son élégance, sa rudesse ou sa grâce, c’est ce qu’aucun ne rend. »
Citadins retranchés dans nos terriers de béton, nous en sommes toujours là : les atlantes et les cariatides qui soutiennent nos balcons nous sont plus familiers que les lépismes et les tégénaires qui fréquentent nuitamment nos appartements. Décrire une façade, ses linteaux et ses cimaises, nous est plus facile que de croquer une prairie grêlée de cirses et d’achillées. Tégénaires et achillées : le problème n’est en vérité pas celui de la méconnaissance des noms propres, même si nommer les êtres est une première marque de considération à leur endroit – la moindre des politesses, pour être exact. Les tégénaires sont de grosses araignées noires à longues pattes, les achillées des plantes auréolées de fleurs blanches ou mauves : quand on a dit cela, on n’a rien dit encore du cliquetis d’ocres de l’une, non plus que des plates-formes précautionneusement étagées de l’autre. Les taxons sont les cache-misères de la description. Bernardin de Saint-Pierre ne s’y trompe pas : ce qui nous manque, pour dire un paysage, ce n’est pas la litanie des latinismes dont ces messieurs du Muséum affublent les plantes et les formations rocheuses, mais des dictionnaires entiers de formes, de couleurs et de textures.
Lors de son premier voyage en Suisse, en 1775, Goethe se trouve lui aussi rendu à ce point-limite où les mots font tout bonnement défaut pour dire les êtres naturels – et surtout les tableaux éphémères qu’accolés ils composent. Au beau milieu de l’ascension du défilé de la Reuss, dans le massif du Saint-Gothard, son compagnon de voyage le presse de croquer les cascatelles et les éperons embrumés. Las, la tentative se solde par une débâcle : « Je réussis à tracer les contours, mais rien ne ressortait. Je n’avais point de langage pour de pareils objets. » Pour peu que les choses haussent le ton, le poète courbe l’échine. Un violent orage surprend les randonneurs. Bravache, Goethe veut dompter les éléments par les mots, rendre chaque nuance, chaque note du ciel enténébré. Incapable cependant de ponctuer la bourrasque, le voilà qui abdique toute syntaxe : « Neige rocher nu et mousse et vent de tempête et nuages le bruit de la chute d’eau le tintement du mulet. »
Tout n’est pas qu’affaire de lexique, mais aussi – et surtout – de phrasé : il n’y a pas de mais entre le vent et la feuille, pas de si entre l’herbe et la pluie. Par effet de grammaire, la hiérarchie des causes et des conséquences rompt le cours des choses. Elle y dépose une nécessité qui leur est étrangère, les soumet à une mesure dont leur exubérance n’a que faire. Et cela, en pure perte : on ne passe pas le licol à un nuage, non plus que les fers à une forêt. Sauf à lui faire injure, le mouvement des fleuves et des ramées ne s’énonce pas dans les catégories de l’action humaine.
C’est ce qu’affirme Hölderlin, lui aussi grand praticien, dans ses derniers poèmes, de la parataxe – la suppression des mots de liaison entre les segments de phrase :
« La roche appelle l’entame,
Et la terre le sillon ;
Tout serait impraticable, sans nul répit ;
Mais ce qu’il fait, lui, le fleuve,
On ne sait. » (« L’Ister », 1843)
La Nature est, dans les termes de Francis Ponge, le « Jardin des raisons adverses » : le langage ne peut que plier devant ses élans. Même dans la plus modeste des jardinières gîtent des êtres – plantes, insectes, animalcules, bacilles – dont les lois de conservation et d’expansion défient notre rapport au temps et à l’espace : autant de petites ontologies bardées d’ocelles et de mandibules. Il faudrait, pour les décrire dans le respect de la distance qui nous sépare de leur façon d’exister, mille vocables nouveaux. Michelet, qui croyait avoir compris les oiseaux, s’avouait ainsi démuni face aux insectes : « Trouvé, pris, ouvert, disséqué, vu au microscope et de part en part, l’insecte nous reste encore une énigme. Une énigme peu rassurante, dont l’étrangeté est près de nous scandaliser, tant elle confond nos idées. Que dire d’un être qui respire de côté et par les flancs ? […] Quel langage vais-je inventer, quels signes d’intelligence, et comment m’ingénier pour trouver moyen d’arriver à lui ? » (L’Insecte, 1867)
La reddition, cependant, ne vaut pas renoncement. Si c’est d’abandon dont il s’agit, c’est au sens amoureux du terme, à la façon d’un lâcher prise consenti, d’un laisser-aller vers le mystère de l’autre, et donc de la capacité retrouvée du récit à accueillir la rime du réel, à s’accorder au tempo allegro de la nature – ce que Goethe nomme, dans sa Théorie des couleurs (1810), « l’aspir et le respir du monde ». Nulle obligation, ici, pour citer le commandement de Wittgenstein, de « taire ce dont on ne peut parler ». Plutôt l’envie d’entendre ce qui déjà converse, de noter tel quel le dit des choses : de n’être plus, faute d’avoir son talent, que le scribe de la nature. Car s’il est si difficile de mettre des mots sur les choses, c’est que celles-ci possèdent leur propre langage – un sabir d’échos et de concordances.
Le malheur du naturaliste, sa tristesse aussi, est par conséquent de manquer de mots pour dire les choses.
Dans Les disciples à Saïs (1798), Novalis – qui est tout à la fois l’admirateur et l’adversaire littéraire de Goethe – écrit : « Les hommes vont de multiples chemins. Celui qui les suit et qui les compare verra naître des figures qui semblent appartenir à cette grande écriture chiffrée qu’on entrevoit partout : sur les ailes, la coquille des œufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux et la conformation des roches, sur les eaux qui se prennent en glace, au-dedans et au-dehors des montagnes, des plantes, des animaux, des hommes, dans les lumières du ciel, sur les disques de verre et les gâteaux de résine qu’on a touchés et frottés, dans les limailles autour de l’aimant et dans les conjonctures singulières du hasard.
À présent, le Maître retrouvait partout des choses connues – mêlées seulement et appariées étrangement – et ainsi, souvent, des choses s’ordonnaient d’elles-mêmes en lui, extraordinaires et rares. De bonne heure en tout il remarquait les combinaisons, les rencontres, les coïncidences. Il finit par ne voir plus rien isolément. Les perceptions de ses sens se pressaient en grandes images colorées et diverses : il entendait, voyait, touchait et pensait en même temps. Il se réjouissait à assembler les choses étrangères. Tantôt les étoiles étaient des hommes, tantôt les hommes des étoiles, les pierres des animaux, les nuages des plantes. Il jouait avec les forces et les phénomènes. Il savait où et comment trouver ceci et cela, et il pouvait le laisser apparaître. Et c’est ainsi qu’il touchait lui-même aux cordes profondes, cherchant sur elles et s’approchant des sons purs et des rythmes. »
Héritier du mysticisme ésotérique de Jakob Böhme, et par son entremise de la connaissance par assonances de la Renaissance, laquelle, voletant d’éclat en éclat, trace à la surface des choses de sinueux chemins de significations, Novalis fait du poète l’équivalent prophétique du « savant universel » : un Maître de haute magie, capable d’entendre et de transcrire le chant du monde. Il ne s’agit pas de traduire les « sons purs » de la Nature, moins encore de les gloser – tout juste de les recueillir.
Le malheur du naturaliste, sa tristesse aussi, est par conséquent de manquer de mots pour dire les choses – de mots justes, qui ne ternissent ni n’embellissent à outrance les réalités naturelles, de mots qui, au sens propre, ne dénaturent pas une montagne en faisant de ses pics des beffrois. Mine de rien, c’est toute la vision romantique de la nature qui se trouve révoquée par cette exigence d’une langue qui ne soit plus ajustée à la vérité intérieure de celui qui observe, mais à celle, extérieure, de cela même qui se trouve observé : les romantiques fardent chaque paysage de sentiments criards quand il faudrait, au contraire, peindre le monde au saut du lit. Chez Klinger, chez Coleridge, et pire encore chez Wordsworth et Shelley, on aurait bien du mal à trouver un « objet naturel » qui ne soit d’emblée grimé en rêverie ou travesti en émoi. Que voit Shelley lorsqu’il contemple le Mont-Blanc un radieux matin de l’été 1816 ? « Sa propre imagination, séparée de lui-même ». Et qu’entend Chateaubriand quand il écoute le chant de la grive musicienne ? Un « son magique » qui le « transporte subitement dans le passé », c’est-à-dire à Combourg, là où la joie de son enfance s’est figée.
Ce dont, par contraste, se languit Bernardin de Saint-Pierre, c’est d’un verbe limpide, d’un parler épuré de tout affect – autrement dit, d’une écriture en forme d’écrin, susceptible d’accueillir les êtres et les choses sans empiéter sur leurs formes propres, ni mêler sa substance à la leur. De cet audacieux projet Goethe détaille, en 1793, non seulement la possibilité, mais aussi le péril – car il faudrait être le soleil pour ne plus voir le monde à l’aune de l’homme et prendre enfin place, en paix, dans le « cercle des choses » :
« Celui qui, mu par un instinct puissant, veut connaître les objets en eux-mêmes et dans leurs rapports réciproques, entreprend une tâche difficile ; car le terme de comparaison qu’il avait en considérant les objets par rapport à lui-même, lui manquera bientôt. Il n’a plus la pierre de touche du plaisir ou du déplaisir, de l’attraction ou de la répulsion, de l’utilité ou de l’inconvénient, ce sont des critères qui lui manquent désormais complètement. Impassible, élevé pour ainsi dire au-dessus de l’humanité, il doit s’efforcer de connaître ce qui est, et non ce qui lui convient. Le véritable botaniste ne sera touché ni de la beauté ni de l’utilité des plantes, il examinera leur structure et leurs rapports avec le reste du règne végétal. Semblable au soleil qui les éclaire et les fait germer, il doit les contempler toutes, d’un œil impartial, les embrasser dans leur ensemble, et prendre ses termes de comparaison, les données de son jugement, non pas en lui-même, mais dans le cercle des choses qu’il observe. »
Comprendre les choses, c’est prendre souci d’elles.
En Goethe le poète et le savant incessamment conversent, qui tous deux mettent en garde contre l’idée qu’il puisse exister un au-delà des apparences, et que le monde ne soit pas à lui-même sa seule vérité : « Les théories marquent d’habitude la précipitation d’un entendement impatient, qui voudrait être libéré des phénomènes, et qui, pour cela, met à leur place des images, des concepts, et même, souvent, rien d’autre que des mots. […] La plus élevée des choses que nous puissions comprendre, c’est que tout ce qui est de l’ordre des faits est déjà théorie. La couleur bleue du ciel nous révèle la loi fondamentale du chromatisme. Ne cherchons rien derrière les phénomènes, ils sont la théorie elle-même. »
D’où ce plaidoyer – assurément sans rival dans l’histoire moderne des sciences – pour une connaissance sensible, un savoir énamouré du monde, « un empirisme tendre, qui s’identifie profondément avec l’objet, et, par-là, devient une véritable théorie ». Comprendre les choses, c’est prendre souci d’elles. Ayant appris au fil des jours ce qu’il faut d’eau et de soleil au plant qu’il couronne, voyez combien soudain vous importe le devenir de ce bouton de géranium : sa loi vous est donnée par le soin que vous en avez.
On pourra objecter qu’il est impossible d’atteindre à la vérité de la chose même, que toujours subsiste dans les êtres quelque chose du regard porté sur eux. Mais c’est justement pour cela que chez Humboldt, la mesure du monde importe tant. Deux savants peuvent bien avoir du Mont-Blanc des perceptions distinctes, infléchies par leurs états émotionnels respectifs : pourvu qu’ils usent de la même manière du même instrument, l’altitude de l’Aiguille du Midi ne variera pas d’un iota. Le réel, c’est ce qui reste après deux regards.
Le problème du rendu réaliste des « scènes naturelles » ne s’en trouve pas résolu pour autant. L’« élégance » du palmier – son quant-à-soi pour ainsi dire – ne se déduit pas de ses mensurations. Une fois établis les attributs spécifiques d’une plante, une fois élucidés les principes de sa croissance et de sa fertilité, une fois posée l’équation climatique et altitudinale de sa distribution géographique, une fois inventoriés ses emplois, demeure le mystère de sa présence. Pour Humboldt, l’énigme du « port » du palmier est donc celle, qui surgit très exactement à mi-chemin de l’œil et du monde, de sa saillance :
« Le simple aspect de la nature, la vue des champs et des bois, causent une jouissance qui diffère essentiellement de l’impression que fait l’étude particulière de la structure d’un être organisé. Ici, c’est le détail qui nous intéresse ; là, c’est l’ensemble, ce sont des masses, qui agitent notre imagination. Quelle impression différente cause l’aspect d’une vaste prairie bordée de quelques groupes d’arbres, et l’aspect d’un bois touffu et sombre mêlé de chênes et de sapins ? Quel contraste frappant entre les forêts des zones tempérées et celles des zones de l’équateur, où les troncs nus et élancés des palmiers s’élèvent au-dessus des acajous fleuris, et présentent dans l’air de majestueux portiques ? Quelle est la cause morale de ces sensations ? Sont-elles produites par la nature, par la grandeur des masses, le contour des formes, ou le port des végétaux ? »
Pourquoi le regard du naturaliste – celui de Bernardin de Saint-Pierre à l’Île-de-France, celui de Humboldt en Amazonie – butte-t-il inéluctablement sur la silhouette du palmier, et non sur celle d’autres végétaux aux formes ou aux dimensions tout aussi inhabituelles pour le voyageur venu d’Europe ? Très probablement car cette silhouette, qui jure par sa verticalité avec le moutonnement des champs et de la canopée, déjointe les plans perspectifs, donc disloque le paysage. L’élancement esseulé du palmier induit une rupture d’horizon. Le regard doit choisir, qui ne peut embrasser en même temps la plante et le panorama.
Hanté par l’idée de la description juste des choses, Humboldt se prend un temps à croire qu’il est possible de réduire un paysage à une combinaison de seize « formes principales de végétation » – pins, fougères, bruyères, cactus, liliacées, etc. À l’instar des couleurs primaires, des figures géométriques ou des runes de l’ancienne Germanie, ces formes végétales, bien qu’en nombre limité, permettent de tout dire d’un lieu naturel : « Sous la main de l’artiste, le grand tableau de la Nature se décomposera en quelques grands traits simples ; comme dans tous les écrits des hommes, tous les mots se résolvent en quelques caractères primitifs ». Or, la première de ces formes, « la plus élevée et la plus noble, celle à laquelle les peuples ont adjugé le prix de la beauté », c’est celle du palmier. Fût parfait que couronne une gerbe d’arches, le palmier se prête particulièrement bien à ce jeu de glyphes, puisque sa silhouette se résume au syntagme « ligne + demi-sphère ». Mais que l’ondée et la brise s’en mêlent, que les palmes ondulent ou frémissent, et il faut reprendre l’esquisse. Le jeu du vent ne fait jamais celui du peintre : il suffit que les feuillages faseyent pour que le paysage mette à la voile.
La nature n’a pas besoin qu’on s’épanche sur son épaule, ni qu’on lui adresse des billets doux, mais simplement qu’on lui prête l’oreille.
Si encore il ne s’agissait que du portrait d’un arbre ! Mais par où commencer si tout est dans tout, si les faits sont reliés par d’innombrables réseaux d’influence ? Où enter une périphrase, où la clore, si la circonférence du réel est infinie et que c’est de cette infinité même dont il faut faire récit ? Dans le tome premier de ses Etudes de la nature (1784), Bernardin de Saint-Pierre s’essaie à faire l’histoire du fraisier qui pousse sur le balcon de son appartement parisien. Dépité, il y renonce au bout de quelques pages. Car pour décrire avec une égale précision tout ce qui influe sur la croissance de la plante, de la larve de charançon qui grignote ses radicelles jusqu’au soleil qui fortifie ses bourgeons, c’est de l’univers entier dont il faudrait traiter : « L’histoire complète du fraisier suffirait pour occuper tous les naturalistes du monde ».
Dans son Voyage à l’Île de France (1773), il interrompait déjà ses considérations sur l’homologie de forme entre les nautiles et les anatifes – de petits crustacés qui se fixent sur la coque des navires – par cet aphorisme aux relents de défaite : « La nature a fait tout ce qui était possible, non seulement les chaînes d’êtres entrevues par les naturalistes, mais une infinité d’autres qui se croisent, en sorte que tout est lié dans tous les sens ». Bernardin de Saint-Pierre est intraitable sur ce point de l’exhaustivité de la description. Ainsi affirme-t-il que dans un récit de voyage, pour ne pas plus lasser l’intérêt du lecteur que son intelligence, « il faut parler de tout ». Peuples, ruines, villes, climat, plantes, paysages, animaux, insectes doivent paraître sur la scène.
Comment ils se donneront la réplique, là réside le problème. Humboldt en convient, qui a longuement fréquenté Goethe et Schiller à Iéna, en 1795-1797, et porte lui aussi une attention inquiète à ces questions d’écriture. Il concède à la poésie un pouvoir d’évocation, mais prend garde de lui assigner des limites. S’il flanque les mots de chiffres et de dessins comme d’autant de chaperons, c’est précisément qu’il sait les phrases volages. Un document entre tous illustre cette tension périlleuse entre le rendu poétique d’un paysage et le commentaire savant de ses particularités : une gravure du volcan Chimborazo, situé au centre de l’Equateur et considéré au XIXe siècle, avec ses 6 200 mètres, comme le plus haut sommet du monde.
Humboldt et Aimé Bonpland – son indéfectible compagnon de voyage – en réalisent l’ascension le 23 juin 1802. Bien qu’ils ne parviennent pas à gravir son pic culminant, faute d’un équipement approprié pour franchir les cascades de glace qui le ceignent, l’exploit leur vaut le titre d’« hommes les plus hauts du monde ». N’imaginons pas, cependant, une cordée héroïque animée de l’esprit de record : Humboldt s’intéresse moins aux sommets qu’aux pentes de la montagne. Il s’arrête sans cesse pour tout mesurer – pression de l’air, altitude, tons du ciel –, ainsi que pour inventorier la flore. Le résultat en est un dessin bifide du volcan, un croquis à la pointe sèche scindé de bas en haut par une ligne incurvée. La moitié gauche présente une vue perspective où s’étagent, sur les flancs bombés de la montagne, les halliers, la canopée, la roche dénudée et les sommets enneigés. La moitié droite est un lacis de mots sur fond jaune coquille d’œuf : il s’agit des noms savants, disposés en quinconce, des plantes et des mousses identifiées au fil de l’ascension – lichens, rubiacées, scitaminées, graminées, umbilicariacées, etc.
Singulier tableau du monde en deux volets, qui tente de parquer l’œil et l’esprit dans des enclos mitoyens, le regard à gauche, la pensée à droite. Les deux moitiés de l’esquisse ne forment pas les deux segments d’une même phrase : elles tiennent sur le volcan des discours distincts. On ne peut pas plus coudre bord à bord le palmier et son nom que le lin et la pierre. Loin de combler le fossé entre les mots et les choses, la gravure le rend donc plus visible, plus sensible que jamais. Mais comme dans l’art japonais du kintsugi, qui use de pâte d’or pour restaurer les porcelaines cassées, il s’agit moins d’abolir la brisure que de la conjurer, de déjouer son péril en l’exposant. Le portrait du Chimborazo d’Alexandre de Humboldt est donc un échec glorieusement exhibé : non la preuve d’une victoire, mais le vestige d’une audace.
Une fois encore, le problème vient des mots – non plus de leur défaut, mais de leur débord. Croyant s’abandonner au monde quand ils ne font que se retrancher en eux, les poètes en font souvent trop lorsqu’ils parlent de la nature. Or celle-ci n’a pas besoin qu’on s’épanche sur son épaule, ni qu’on lui adresse des billets doux, mais simplement qu’on lui prête l’oreille. Il faut, en conclut Humboldt, savoir tenir sa langue :
« Tous les détails n’étant pas susceptibles d’être présentés sous une forme littéraire, comme les combinaisons générales de la science naturelle, il n’y a que des faits coordonnés en peu de mots – presqu’à la manière d’une table […]. Les défauts principaux de mon style sont une malheureuse tendance à employer des formes trop poétiques, une construction vague, embarrassées de participes, trop d’idées et de sentiments concentrés dans une seule période. Je crois que ce défaut radical inhérent à mon individualité pourrait être un peu racheté par une simplicité sévère […]. Un livre de la nature doit produire la même impression que la nature elle-même. Mais ce à quoi j’ai donné une attention toute particulière dans mes vues de la nature, et par où ma manière diffère essentiellement de celle [de] Chateaubriand, c’est que j’ai constamment cherché en décrivant, en peignant, à être toujours vrai, même scientifiquement, sans tomber dans la sécheresse de la science pure. »
« En peignant » : cette formule échappée à Humboldt fait peut-être allusion au dialogue qu’il noua, à partir de 1835, avec Carl Gustav Carus – à qui il rendit visite à Dresde, puis qu’il revit à Paris. Passionné de géologie et diplômé d’obstétrique, Carus mène une double vie : médecin attitré du roi de Saxe la semaine, il devient peintre le week-end. Passé sa rencontre avec Caspar David Friedrich, qui l’initie d’un même mouvement au dessin des scènes naturelles et à un mysticisme exalté, Carus se fait non seulement praticien, mais aussi théoricien de la « peinture de paysage ». Il lui consacre en 1835 un traité où il affirme, à l’unisson des romantiques, que « les mouvements du cœur et les états de la nature se correspondent », et que « le beau est le triple accord de Dieu, de la nature et de l’homme ».
Puisque Dieu est dans les détails, ce sont ces derniers que l’artiste se doit de rendre, non afin de magnifier leur fugacité, mais au contraire de rappeler que l’éclat de leur présence n’est qu’un entracte dans le cours de leurs métamorphoses.
Mais à l’exemple de Goethe, à qui il voue un véritable culte, Carus ne s’en tient pas à cette prime équation. Ce à quoi il souhaite parvenir en conjuguant art et science, c’est à une « image de la vie de la Terre (Erdlebenbild) » dans laquelle les êtres et les choses ne se réduisent pas à ce que l’homme en pense, mais restent animés de leur mouvement propre. Il faut, dit-il, « être capable de ressentir selon le sens de la nature », « vivre avec l’intuition profonde des puissants mouvements vitaux de la terre, qui s’entrecroisent indéfiniment ». Tout comme Goethe puise le nom savant des nuages dans un essai du météorologue Luke Howard (On the modification of clouds, 1803), Carus cherche les lois du teint des lichens et des clavaires dans Le Système des champignons du mycologue Nees von Esenbeck (1817). Sa faculté d’observation du monde naturel est telle qu’il est le premier, dans un court traité publié en 1827, à détailler le système vasculaire des insectes à partir de l’étude des membranes de l’aile d’un éphémère, autrement dit à déduire le mouvement profond de la vie des êtres des seuls plis de leur surface.
À l’instar de toute une génération d’hommes de lettres, Carus vit sous l’empire de la « philosophie de la nature (Naturphilosophie) ». Celle-ci se trouve esquissée dès 1797 par Schelling, selon qui la conscience individuelle et l’« âme du monde » ne font qu’un, étant entendu que « le système de la nature est simultanément le système de l’esprit ». Goethe s’y abreuve, pour qui la nature est cette « chose totale, unique et éternelle, toujours changeante, toujours constante », et que tarabuste, à compter de son voyage en Italie, en 1787, l’idée ténébreuse d’un « phénomène originaire (Urphanömen) », d’un « modèle primitif, identique à tous les cas », auquel il serait possible, par équarrissements successifs, de réduire le pullulement des existences. Goethe qui, déambulant dans les allées du Jardin public de Palerme, se prend à rêver d’une rose qui soit toutes les roses :
« Les nombreuses plantes que d’habitude je ne vois qu’en caisses et en pots, et même la plus grande partie de l’année en serre, poussent ici en plein air, joyeuses et vivaces, et parce qu’elles remplissent parfaitement leur destination, nous les déchiffrons plus facilement. À la vue de tant de créatures neuves et renouvelées, mon ancienne lubie me revint à l’esprit. Ne pourrais-je pas découvrir parmi cette troupe la plante primitive ? Une pareille plante doit bien exister ! À quoi sans cela reconnaîtrais-je que telle ou telle forme est une plante, si elles n’étaient pas toutes faites d’après un modèle ? »
Quoique dotée d’un impressionnant pédigrée littéraire, la « philosophie de la nature » n’acquiert ses lettres de noblesse scientifique qu’au tournant des années 1810, par le moyen des travaux de Lorenz Oken. Anatomiste de renom pour qui l’homologie de forme entre les vertèbres et les os crâniens valide l’antique théorème mystique du « résumé du macrocosme dans le microcosme », Oken lègue à Carus et à Humboldt une vision immanentiste de la Création, l’image d’un univers où la divinité ne prend jamais de repos : « La philosophie de la nature est la science de l’éternelle transformation de Dieu au sein du monde ». Oken est en sus un formidable portraitiste des surfaces de la nature. De plumes en cristaux, de pelages en écailles, il traque les « formes primordiales (Urformen) » du vivant, celles dont les déclinaisons et les enchevêtrements épellent les contours les plus intimes des êtres.
Portant lui aussi à son point d’incandescence l’intuition de la sacralité du monde, le maître de dessin de Carus, Caspar Friedrich, s’écrie : « J’ai souvent vu Dieu ; je l’ai rencontré un jour au milieu des roseaux ». Carus lui emboîte le pas : puisque Dieu est dans les détails, ce sont ces derniers que l’artiste se doit de rendre – et ce non afin de magnifier leur fugacité, mais au contraire de rappeler que l’éclat de leur présence n’est qu’un entracte dans le cours de leurs métamorphoses.
« Tout aspect de la vie de la Terre, même le plus paisible et le plus simple, est un digne et bel objet de l’art, à condition que l’on saisisse exactement son sens propre et l’idée divine qu’il cache en lui-même. […] Le coin de forêt le plus tranquille, avec toute la diversité de sa végétation, le tertre vert le plus simple, avec ses plantes gracieuses, vu dans le bleu de l’horizon et sous l’azur du ciel, fourniront l’image la plus belle de la vie de la Terre. »
Et de fait, les plus saisissants tableaux de Carus ne sont pas ceux où il peuple de ruines et de pèlerins de vastes panoramas montagnards, mais ceux où il met tout son art à croquer, comme un personnage à part entière, un orme dépenaillé, une souche moussue ou un jeune hêtre assailli par la vigne vierge. L’idée d’une « haute et authentique vérité de la nature », irréductible et indifférente à ce qu’elle fait naître chez qui la contemple, le conduit, et dans son sillage Humboldt, à ne plus faire du sentiment humain l’étalon de la majesté des choses. Rejetant comme une supercherie la « peinture de perspectives », qui grandit à outrance l’homme et rapetisse à l’excès les forêts, Carus finit par peindre le monde à taille réelle, sans plus fausser l’échelle de la vie.
Rendre justice à toutes les créatures, c’est ne pas se soucier de leur taille, puisque la cruauté dont l’homme accable certaines d’entre elles se justifie trop souvent du préjugé qu’il attache à leurs dimensions.
C’est un épisode narré par Humboldt – sa remontée du cours supérieur de l’Orénoque, en Amazonie – qui donne le mieux la démesure de ce projet. Par l’usage d’un « style vif », Humboldt réussit ce prodige de transformer un cheminement laborieux le long des sentiers battus de la Mission en une avancée martiale, ponctuée de hauts-faits de collecte. Surtout, il tient son pari d’une description uni-modale des différents règnes, puisqu’il s’attarde aussi longuement, et avec un égal souci de précision, sur la constitution et les mœurs des indiens Caribe que sur la physionomie des palmiers ou la morphologie des sols :
« Nous arrivâmes le troisième jour aux missions caribes du Cari. Nous vîmes dans ces contrées le sol moins crevassé par la sécheresse que dans les Llanos de Calabazo. Quelques ondées avaient ranimé la végétation. De petites graminées, et surtout ces Sensitives herbacées, si utiles pour engraisser le bétail à demi-sauvage, formaient un gazon serré. À de grandes distances les uns des autres s’élevaient quelques troncs de palmiers à éventail (Corypha tectorum), de Rhopala (Chaparro) et de Malpighia à feuilles coriaces et lustrées. Les endroits humides se reconnaissent de loin par des groupes de Mauritia, qui sont les Sagoutiers de ces contrées. […] Des insectes et des vers, partout ailleurs si rares dans les Llanos, s’y rassemblent et s’y multiplient […].
Nous arrivâmes le 13 juillet au village du Cari, la première des missions caribes qui dépendent des moines de l’Observance du Collège de Piritu. Nous logeâmes comme de coutume au couvent, c’est-à-dire chez le curé. […] Nous trouvâmes plus de 500 Caribes dans le village de Cari. Je n’ai vu nulle part une race d’hommes plus élancés (de 5 pieds 6 pouces à 5 pieds 10 pouces) et de stature plus colossale. Les hommes, et cela est assez commun en Amérique, sont plus couverts que les femmes. Celles-ci ne portent que le guajuco ou perizoma, en forme de bandelettes ; les hommes ont tous le bas du corps jusqu’aux hanches enveloppé d’un morceau de toile bleu foncé, presque noir. […].
Le grès rouge, renfermant quelques débris de bois fossile (de la famille des Monocotylédonées), se découvre partout dans les steppes de Calabazo ; plus à l’est, des roches calcaires et gypseuses lui sont superposées et le dérobent à la recherche du géologue. Le gypse marneux, dont nous avons ramassé des échantillons près de la mission caribe de Cachipo, m’a paru appartenir à la même formation que le gypse d’Ortiz. Pour le classer selon le type des formations européennes, je le rangerais parmi les gypses souvent muriatifères qui recouvrent la pierre calcaire alpine. »
La symétrie des attentions trouve ses limites, puisqu’Humboldt manifeste plus de respect pour le génie des épiphytes que pour celui des indigènes – lesquels, brisés par la Conquête, ne sont plus qu’une « race dégradée », les « débris d’un vaste naufrage ». Le simple fait qu’Humboldt accorde une égale considération au gypse marneux et à l’indien Caribe, autrement dit qu’il en traite tour à tour sans rupture de style, pourrait laisser penser qu’il participe pleinement des préjugés racistes de son temps. Les choses sont en réalité plus compliquées que cela. Humboldt ne critique pas une déficience congénitale des Indiens mais leur déchéance, laquelle n’est jamais qu’une circonstance – le fruit d’une dévastation dont l’Europe doit seule endosser la responsabilité. Partisan résolu de l’unité de l’espèce humaine, Humboldt rejette « la distinction désolante de races supérieures et de races inférieures ».
Puis, l’arasement narratif entre les règnes signe moins l’acte de décès de l’humanisme que celui de l’anthropocentrisme. Ce n’est pas que la compassion s’absente du récit, mais plutôt qu’elle se distribue désormais entre l’ensemble des êtres qui le peuplent. Ainsi le naturaliste s’émeut-il non seulement du malheur de l’enfant, mais aussi de la beauté des graminées – non par défaut ou restriction de charité, mais par surcroît d’attendrissement.
Qu’il n’y ait pas de malentendu : Humboldt ne parle pas des hommes, des minéraux, des animaux et des végétaux dans les mêmes termes, mais sur le même ton – à même hauteur de casse. Chez lui, la taille de la police (des mots) n’est pas une police de la taille (des choses) : tout est majuscule, qui requiert admiration et mérite description. L’importance des êtres n’est donc pas – surtout pas – celle qu’aveuglément ils se donnent. Rendre justice à toutes les créatures, c’est ne pas se soucier de leur taille, puisque la cruauté dont l’homme accable certaines d’entre elles se justifie trop souvent du préjugé qu’il attache à leurs dimensions. Michelet note à ce sujet que si l’on tue l’insecte avec désinvolture, « c’est qu’il est si petit qu’avec lui on n’est pas tenu d’être juste ».
L’attention aux êtres en leur singularité, en leur particularité la plus ténue, détourne d’un autre entendement du monde, à savoir la pensée par séries, qui abstrait et agrège en catégories.
On se souvient de la thèse avancée par Michel Foucault dans Les Mots et les choses (1966), à savoir que se dessine au sortir du XVIIIe siècle, à partir d’un bric-à-brac de savoirs qui ne voient dans les individus et les populations que des sommes d’utilités, une figure de l’homme qui se veut universelle mais n’est, tout bien considéré, que provisoire : « L’homme est une invention dont l’archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Et peut-être la fin prochaine ». Or ce que révèle la prose niveleuse de Humboldt, dans laquelle l’« histoire naturelle » jette au même instant son plus bel éclat et ses derniers feux, c’est que cet anthropocentrisme radical n’emporta pas si facilement la partie. Liguées en une ultime conjuration, de très anciennes lignées de savoir, qui réunissaient humains et non-humains dans un même amour algébrique du monde, lui opposèrent une brève mais féroce résistance.
La « folle idée » de Humboldt d’un portrait du monde en ses moindres détails ne disparut d’ailleurs pas du jour au lendemain : elle mit du temps à mourir, en sorte que son histoire, s’il fallait la conter toute entière, serait aux deux tiers celle de son agonie. En 1869 encore, le géographe Elisée Reclus ouvre son Histoire d’un ruisseau par ces lignes : « L’histoire d’un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, est l’histoire de l’infini. Ces gouttelettes qui scintillent ont traversé le granit, le calcaire et l’argile ; elles ont été neige sur la froide montagne, molécule de vapeur dans la nuée, blanche écume sur la crête des flots. […] Tous les agents de l’atmosphère et de l’espace, toutes les forces cosmiques ont travaillé de concert à modifier incessamment l’aspect et la position de la gouttelette imperceptible, elle aussi est un monde comme les astres énormes qui roulent dans les cieux, et son orbite se développe de cycle en cycle par un mouvement sans repos. »
À l’égal de Bernardin de Saint-Pierre qui voyait l’univers dans son fraisier, Reclus contemple l’infini dans un ruisselet. Traiter du globe et de la gouttelette à même hauteur de ton : il y a du Humboldt dans cette prétention. Reclus vient d’ailleurs de s’essayer à une volumineuse Description des phénomènes de la vie du globe (1867-1868) qui rappelle immanquablement, dans son ordonnancement même, le Cosmos de l’érudit prussien. Mais le compte n’y est pas. Alors qu’avec Humboldt, on est toujours là et pas ailleurs – puisque les choses et les êtres, lestés de leurs coordonnées, sont saisis dans la singularité de leur surgissement –, l’Histoire d’un ruisseau n’est l’histoire d’aucun ruisseau en particulier. Plutôt une série de digressions sur l’imaginaire de la source et du méandre, entrelardées de réminiscences sentimentales qui dégouttent sur les horizons comme une gouache sur un pastel. Encombrée d’elle-même, l’idée bave sur le phénomène jusqu’à émousser sa silhouette, pèse sur ses contours jusqu’à les ébrécher. C’est la nature, oui, mais en pointillé.
La passion du détail de Bernardin de Saint-Pierre, de Rousseau, de Goethe et de Humboldt ne tient pas d’une lubie d’esthètes frivoles : elle s’enracine dans de puissantes philosophies de la singularité, qui affirment la primauté de l’individu sur l’espèce, du phénomène sur l’archétype, de la contingence sur l’essence. C’est cela, leur plus formidable leçon : l’attention aux êtres en leur singularité, en leur particularité la plus ténue, détourne d’un autre entendement du monde, à savoir la pensée par séries, qui abstrait et agrège en catégories.
L’époque que nous vivons est tissée d’une semblable tension entre l’amour retrouvé du détail des choses et leur dilution dans de vastes entités statistiques. L’homme lui-même n’est plus que chiffres : 350 000 morts, 5 400 000 « contaminés », et rarement un visage. C’est le retournement triste de la « folle idée » de Humboldt. Car sitôt qu’il cède à la passion morbide des « types » et autres « formes originaires », dès lors qu’il ne discerne plus dans les silhouettes que des séries, le rêve moniste de l’inventaire du monde se mue en une apologie de l’uniformité. Alors vient le temps du gouvernement par les grands nombres : « cohortes » de cobayes réduits à ce qui fait leur ressemblance, « échantillons » de votants anonymes – « populations » et cheptels.
À la suite de ceux qui ne voulaient plus voir dans la nature qu’un lacis de catégories, nous nous sommes fait une idée de la théorie qui n’est jamais que la vieille théorie de l’Idée : peu ou prou celle de Platon, pour qui les choses ne méritent pas nos regards, puisqu’elles ne sont que les ombres de splendeurs lointaines, des ersatz de vérité. La théorie, pour nombre d’entre nous, n’est jamais que l’Idée au singulier : une loi qui, procédant par abrasement des discordances, équarrissant le réel, résume à grands traits une myriade de phénomènes. Or, c’est méconnaître qu’en grec ancien, une théorie désigne aussi un cortège, une procession, un défilé sacré. Et par extension : une légion, un bataillon – l’armée des choses. Avec Bernardin de Saint-Pierre, avec Goethe, avec Humboldt, avec Francis Ponge encore, le pluriel du monde est de retour : l’infinie variété des êtres vivants à nouveau se donne à voir. L’arbre compte plus que la forêt, l’oiseau plus que la nuée.
Durant ces deux mois où nous avons vécus repliés sur d’infimes territoires, nous nous sommes faits ornithologues à la petite semaine et botanistes du dimanche – et qu’importe, puisqu’il n’y avait plus de lundis ? Nous avons ainsi retrouvé – par bribes, par à-coups – ce goût du détail des choses qui était autrefois l’étai d’un puissant savoir, et le lieu même où conversaient les arts et les sciences. Par une étrange réminiscence, nous avons goûté à un passé dont nous avons tout oublié : un temps révolu où quelques-uns des plus grands noms de l’Europe savante poursuivaient la « folle idée » de décrire le monde d’un seul tenant aussi bien qu’en chacune de ses aspérités, sans omettre aucune des existences qui le trament. Si nous n’avons pas tous vu – comme Bernardin de Saint-Pierre – l’univers dans nos jardinières, nous avons du moins pris souci et soin de quelques présences dont nous n’avions plus même conscience.
Puis nous avons coupé les fleurs pour faire des bouquets.
NDA. — Ce texte reprend – et souvent développe et complète – quelques-unes des réflexions présentées dans Le Détail du monde. L’art perdu de la description de la nature (Seuil, 2019). Les références exactes des citations de Bernardin de Saint-Pierre, Rousseau, Goethe, Humboldt, etc., se trouvent dans l’appareil de notes de cet ouvrage.
NDLR : en mars 2020, Romain Bertrand a fait paraître Qui a fait le tour de quoi ? L’affaire Magellan aux éditions Verdier.
