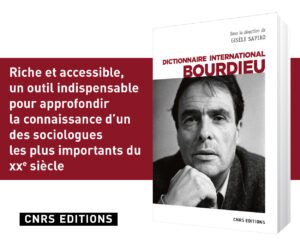Maradona, il était le ballon
Pour qui se demandait quel était le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé ou Maradona, ou animés par une certain penchant pour la nostalgie, Platini ou Cruyff, voire Zidane, Ronaldo et Messi pour ceux qui sont leurrés par le présentisme que décrit et critique si justement François Hartog, pour qui se poserait cette question qui n’a bien entendu qu’un intérêt tout relatif, pourquoi vouloir établir un classement entre Shakespeare, Montaigne et Cervantes, la nouvelle d’hier vient d’apporter une réponse éclatante. Ce n’est ni la première ni la dernière fois que la mort d’un individu contribue à éclairer sa vie. L’âge y fait aussi. Soixante ans c’est encore jeune. Soixante ans pour un garçon né en 1960, ça relève d’une perfection arithmétique.
L’écho planétaire de sa disparition dépasse de très loin l’imaginable et la raison. Bien entendu, j’ai trouvé déplacées les images du ballet habituellement obscène des caméras, quand bien même elles témoignaient, en vivo, de la tristesse de la population argentine. Voir les motos suivre l’ambulance dans laquelle la cadavre est transporté pour l’autopsie ajoutait au sentiment d’une défaite de la pensée mais n’en est pas moins significatif. J’ai trouvé à tout ça un petit côté lady Di, mais avec une différence de taille. Le côté princesse du peuple de Lady Di ne fut, comme on l’a bien vu dans le film de Stephen Frears, The Queen, qu’une invention du cabinet de Tony Blair, ce que la saison 4 de The Crown confirme, s’il en était besoin.
« El pibe de oro » n’a pas besoin de ce type de trouvaille et on devine que ses funérailles seront encore plus grandioses que celles qui furent réservées à Ayrton Senna, devenu avant même sa mort une idole, sans comparaison avec Pelé, non seulement parce que le peuple avait l’occasion de vibrer lors des Grands Prix seize fois par an, au lieu d’une Coupe du monde tous les quatre ans, mais parce que le peuple méprisait la vanité et la vénalité de Pelé et appréciait au contraire la sensibilité de Senna. Maradona était de la famille de Senna.
Le seul qui leur fut comparable, qui suscita une passion et une compassion analogues, ce fut Garrincha, l’Ange aux jambes tordues, dont on disait que grâce à lui la joie gagnait les stades. À sa mort, le peuple le lui rendit bien. Esquinté par la misère et les alcools, étourdi par les alleluias au citron vert et au blanc d’oeuf, il était mort une nuit dans l’anonymat à l’hôpital. Mais pour ses funérailles, une foule immense suivit le camion de pompiers qui transportait son cercueil et s’était amassé sur les ponts pour le voir passer ; une différence toutefois, les va-nu-pieds se pressaient autour de la tombe et au moment de descendre le cercueil il avait fallu donner des coups de pioche pour agrandir la fosse parce qu’on avait mal calculé.
Plus que tout autre, Maradona aimait le ballon, il avait du ballon comme on disait autrefois au bord de la pelouse, il était le ballon.
Dieu est mort : voilà le titre du journal L’Équipe ce jeudi matin. Il n’empêche, il faut se méfier de l’hyperbole et des exagérations. À le prendre au mot, à reprendre Le Gai Savoir, Nietzsche nous avertit que c’est nous qui l’avons tué, que ce sera difficile de nous en consoler et que nous n’aurions plus qu’à devenir nous-mêmes des dieux. Si c’est bien ce que Maradona a fait, l’histoire ne peut tourner qu’en boucle. En tout cas, le Crépuscule des idoles lui allait comme un gant et il y a sûrement dans ce que fut le crépuscule de sa vie, à la fois tragique et comique, trépidant et lénifiant, une grande leçon de choses. D’autres variantes ont décliné que le mythe était mort, la légende était morte. Ce n’est pas tout à fait la même chose. Et puis, il va de soi qu’on ne saurait négliger la place de l’Histoire dans cette trajectoire, que ce soit le fond de la dictature militaire, la guerre des Malouines, les protestations d’amour et d’amitié à l’adresse de Cuba et de Castro, l’effondrement et la renaissance sans fin de l’Argentine.
À son habitude, Platini a parlé avec intelligence. Il a d’abord déclaré : « c’est notre passé qui s’en va ». Et rien, sans doute, n’est plus juste. Il a ajouté que « c’était un enfant-roi », et oui, quelque chose du bonheur enfantin demeure dans ses jongles, ses dribbles, ses courses, ses ruses, ses émotions. Plus que tout autre, il aimait le ballon, il avait du ballon comme on disait autrefois au bord de la pelouse, il était le ballon.
À quoi résumer son œuvre de footballeur ? Sachant que son œuvre ne se résume pas, qu’elle repose dans tous les gestes, tous les buts qu’il a marqués et manqués. J’aperçois néanmoins trois grands moments, que l’amateur reconnaîtra d’emblée et que le profane découvrira.
Le premier l’installe en légende. C’est la Coupe du monde 1986, sans doute la plus belle Coupe du monde, et celle qui marque pour moi la fin du caractère simplement émerveillé de ma passion pour le football ; non seulement, il est le capitaine de l’équipe qui gagne le trophée, mais le quart de finale contre l’Angleterre au stade Aztèque est le théâtre de ce que, depuis hier, plus grand monde n’ignore, « la main de Dieu ». Je n’en formule pas moins une hypothèse : que cette main de Dieu n’aurait pas fait autant parler, ou – plutôt – qu’elle ne lui aurait pas été du tout pardonnée, si trois minutes plus tard il n’avait marqué un des plus beaux buts qui soient, parti de son propre terrain, la balle collée au pied, dribblant je ne sais plus combien de joueurs anglais, quatre ou cinq, plus le gardien, avant d’expédier le ballon au fond des filets.
Le deuxième moment, ce sont les années où il joue à Naples, où il conduit son club au scudetto, le titre de champion d’Italie, pour la première fois de l’histoire, réservé en général aux clubs du nord, Milan, Turin, dans un pays toujours traversé par cette ligne de fracture du Mezzogiorno et d’une certaine forme de mépris pour les « gens du Sud ». La passion d’une ville et d’une région a été portée à son comble, une passion à la fois politique, sociale, culturelle, religieuse, dont témoignent la ferveur des autels et des processions, transformant Diego en nouveau saint de Naples (d’ailleurs la municipalité va rebaptiser le stade San Paolo en stade Maradona par dérogation exceptionnelle). Le peuple napolitain s’est reconnu dans ce petit bonhomme qui était un des leurs et qui leur offrait des victoires de prestige notamment contre le club présidé par Silvio Belusconi qui n’était encore qu’un homme d’affaires, il cavaliere, et serait bientôt le funeste président du conseil.
Le troisième moment, c’est le retour en Argentine, dans son club de coeur, Boca Juniors, dans son stade, la Bonbonera, la bonbonnière, le maillot aux couleurs bleu et jaune, le club dans lequel se reconnaissent les sans-grades portègnes, le stade dans un quartier pauvre de la ville, où j’avais croisé son fantôme l’été 2002. C’est sur cette pelouse qu’il avait prononcé ses mots d’adieu, aussi sobres qu’émus.
Lors de la remise de l’Oscar pour La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino remercie d’un même mouvement Fellini, Scorsese et Maradona.
Ce sont précisément les premières images du beau documentaire de Jean-Christophe Rosé et Benoît Heimermann, produit par Arte, 13 Productions et quelques antennes suisses et belges, qui m’ont beaucoup touché mercredi soir. Je l’ai regardé sur la chaîne L’Équipe, malheureusement entrelardé de coupures publicitaires. D’autres temps forts sont assez remarquables, comme la scène drolatique où il s’entraîne dans le noir pour illustrer « le côté obscur » dont on lui fait grief, après qu’il a été disqualifié, non sans hypocrisie, pour usage de cocaïne ; ou encore la remise du prix de footballeur du siècle par la FIFA, quand il remercie entre autres son peuple, Guevara et surtout « tous les joueurs du monde », avant qu’un double vote de la FIFA ne décerne en même temps un autre prix de numéro 1 à Pelé qui déclare, lui, que « la victoire est pour Dieu ».
Le cinéma s’est déjà intéressé à Maradona. Il serait temps que je regarde le film de Kusturica, d’autant que j’aime les documentaires et pourrais me faire une idée sur les appréciations très contrastées qu’il a suscitées ; mais je ne pourrais jamais reprocher à Kusturica d’avoir fait un film pour le plaisir d’échanger quelques ballons avec lui sur la pelouse de l’Etoile Rouge. En revanche, j’ai vu et aimé, naguère, le film de Carlos Sorin, El camino de San Diego, l’histoire d’un fan, hinchador en argentin, c’est plus joli, qui travaille comme bûcheron dans la forêt amazonienne, qui porte deux tatouages de son idole et – par dessus – un maillot avec un grand 10 dans le dos, qui connaît tout de lui et collectionne des reliques ; le jour où il se retrouve au chômage, il décide de se rendre à Buenos Aires avec l’espoir d’apercevoir Maradona.
La palme revient à Paolo Sorrentino ; lors de la remise de l’Oscar pour La Grande Bellezza, il remercie d’un même mouvement Fellini, Scorsese et Maradona. Il ne s’en tient pas là. Dans son film suivant, Youth, on le voit apparaître en personne, du moins son sosie ; sortant de la piscine, le dos tatoué d’un poster géant de Marx, obèse, marchant difficilement jusqu’à un transatlantique où il s’allonge, un masque à oxygène sur le nez ; puis, de but en blanc, en tout cas dans mon souvenir, on le retrouve sur un court de tennis (le plus beau court de tennis du cinéma depuis le Blow up d’Antonioni) pour une des plus belles scènes de terrain de sport et de cinéma tout court, exaltante, propice à la lévitation, comme fera dans une autre scène un moine bouddhiste en maillot rouge, ce n’est pas Maradona qui lévite, mais la balle avec laquelle il jongle, qu’il envoie jusqu’au ciel, à moitié bleu, à moitié blanc, la balle de tennis qui monte très très haut à plusieurs reprises, qu’il amortit une fois de la poitrine, comme un signe précurseur, mais qu’il relance, puisqu’on est au cinéma.
Dans l’hommage qui lui est rendu, on a entendu entonner un « malgré tout » qui ne m’a pas étonné. Maradona est grand malgré la cocaïne, les liens avec la mafia, les affinités avec Castro, etc. J’aurais aimé qu’on réfléchisse à ce que peut signifier le fait qu’il soit « grand » ou « immense » ou « légendaire » non pas malgré mais avec cette part d’ombre que lui-même reconnaissait et dans laquelle il se dépêtrait.
À ce point, un souvenir me revient. C’était en septembre 2014, je ne sais quel mauvais démon m’avait convaincu d’accepter l’invitation de me rendre à l’émission de Nagui sur France Inter en novembre 2016 pour évoquer des champions mythiques. « La bande originale » accueillait Teddy Riner, le judoka charmant, un bon garçon, bien élevé, drôle, l’esprit vif, mais l’émission plombée par une vulgarité invraisemblable. Au passage, Nagui voulut me faire dire que Riner était le plus grand champion du XXe et du XXIe siècles confondus, moi tentant de tempérer le propos, de faire valoir ce que pouvait représenter dans une vie la traversée des épreuves, Coppi et Maradona par exemple. Au nom de Maradona, je vis Nagui s’offusquer, ah non, pas lui, un tricheur, un drogué, etc., vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites à nos auditeurs. Le problème, c’est justement que je m’en rendais compte.
Au début du mois de novembre, au lendemain de la Fête des morts, Maradona avait été opéré d’un hématome dans le cerveau. Rentré chez lui au bout de dix jours, il semblait s’en être sorti. Je ne sais plus lequel de ses proches, ou un médecin, a déclaré : « il a vécu le pire moment de sa vie, il veut se retaper, Maradona est là encore pour un moment ». Il ne s’agissait que d’un momentino. Il est vrai qu’il avait multiplié les malaises cardiaques et échoué comme une baleine dans la clinique du Sacré-Cœur à Buenos Aires. Il me restera aussi de lui l’image d’un papillon qui aura pesé, un jour, 124 kilos. Ce serait trop facile de parler de déchéance. Même dans les pires moments de son existence, il me semble qu’il aura vécu avec la gloire collée à ses basques et compris qu’elle ne servait, somme toute, qu’à préparer le jour des morts.