Il faut révolutionner les savoirs scolaires ! (1/2)
On a déjà défendu dans ces mêmes colonnes[1] l’idée que l’École française, ne parvenant pas à émerger de son élitisme forcené, de son injustice de fond et de son immobilisme, exigeait la recherche d’un autre type de traitement politique que ceux qui ont consisté depuis 50 ans à mettre en œuvre la massification tout en échouant à se démocratiser[2].
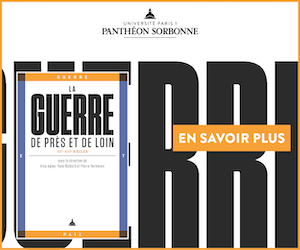
Aux deux sens d’être plus juste et de fortifier les conditions de la démocratie. Se profilent, si n’intervient pas de véritable révolution de ce secteur de l’action publique, une sinistre fracture entre les jeunesses et un risque majeur d’explosion sociale face à de révoltantes injustices.
Or, contrairement à ce que prétendent la plupart des responsables politiques qui se sont succédé, nous ne pensons pas qu’on ait « tout essayé ». Toutes les politiques se sont en effet essentiellement occupées de questions de flux, de taux d’accès, de structures, mais la question n’a pas été posée de savoir si cette propension de l’École à produire de l’injustice, malgré toutes les tentatives de réformes, ne viendrait pas de l’intérieur même des savoirs que l’École enseigne.
Pourtant le tableau qu’on peut dresser non seulement des savoirs scolaires, mais aussi du rapport à ces savoirs[3] tel que l’École le construit pour les élèves, montre plusieurs caractéristiques critiques. Les hiérarchies installées entre les savoirs jouent un rôle important dans les hiérarchies sociales que l’École encourage. Les modes d’évaluation des élèves au service de la sélection plus que des apprentissages jouent également un rôle dans le découragement de ceux qui sont les plus éloignés socialement des rites de l’École. La fermeture culturelle des enseignements dispensés ne joue pas non plus en faveur de ces élèves-là. Une conception très popularisée par plusieurs gouvernements (comme ceux des présidences Macron, où l’éducation a été successivement confiée à Blanquer et Ndiaye) d’une École dont la mission serait avant tout d’enseigner des « fondamentaux » (lire, écrire, compter) en fixant très bas l’objectif des études, limite toujours pour ces mêmes élèves l’horizon des apprentissages et de l’ambition.
On peut se demander pourquoi ceux qui ont voulu ou veulent réformer l’École se sont toujours privés d’aborder la question des savoirs scolaires. On a évoqué le conservatisme traditionnel de l’École, mais il semblerait qu’au sein de tout ce qui constitue ce conservatisme, ce sont les contenus scolaires qui seraient les plus intouchables : du domaine presque du sacré, de ce qu’on ne remet pas en cause, de ce qu’on n’interroge même pas. Une raison évidente en est la difficulté à prendre le recul nécessaire : la majorité des gens n’a jamais eu à connaître le monde qu’au travers des savoirs que l’École enseigne (et une seule École, l’École nationale), en ignorance même du fait qu’il y en aurait eu d’autres possibles, d’où un attachement confiant en sa justesse intrinsèque. La remise en cause n’est pas aisée !
Les questions seraient pourtant simples, au moins à poser : comment s’effectue, entre tous les savoirs, le choix de ceux qu’on enseigne ? Qui est chargé de cette sélection ? À partir de quoi cette sélection s’effectue-t-elle ? Qui décide de ce qui doit être enseigné « en commun » ? Comment la pertinence des savoirs enseignés est-elle évaluée ? Par qui ? Ce qu’on enseigne est-il censé seulement diffuser des savoirs ou aussi participer de l’éducation, au sens d’une dimension renvoyant à des comportements et à des valeurs ?
L’École injuste est d’abord une École dont les savoirs ne conviennent pas, ne sont pas en phase avec son ambition démocratique, avec les questions qui se posent aujourd’hui aux élèves réels comme à l’humanité tout entière. Quels seraient les points de rupture à proposer par une politique d’un nouveau type ?
Pourrait-on considérer qu’on tiendrait là des prémisses d’une politique éducative d’un tout nouveau style[4] ?
La question des savoirs, point aveugle de la réflexion sur l’École
Constatons, avant de nous le demander, que cette indifférence des politiques à la question des savoirs, rejoint un peu celle du système lui-même : il semblerait en effet que, des deux missions que remplissent la plupart des systèmes d’éducation, celle de formation et celle de sélection, c’est la dernière qui, dans le cas français, s’est trouvée progressivement privilégiée. L’École française sait en effet parfaitement dégager l’élite dont elle estime que le pays a besoin, en garantissant la qualité et le financement des filières qui la constituent.
Voyons aussi que, dans la scolarité même des enfants, les diverses opérations d’évaluation (« contrôles », « tests », « notes », « examens », « décisions de conseils de classe », etc.) non seulement ne sont pas contestées, mais encore ont pris l’avantage symbolique sur les apprentissages eux-mêmes. Entendons les soucis exprimés par les collégiens quant à la « moyenne » à obtenir, pour laquelle ils travaillent souvent plus que pour un autre motif d’apprentissage ! Et on ne sait pas toujours assez que c’est une spécialité française que de tout décider à partir de calculs de moyennes, qu’il s’agisse de passer dans la classe supérieure ou de résultats aux examens, moyennes calculées à l’intérieur de chaque discipline comme entre les disciplines en dépit de leur hétérogénéité. Il est banal en France d’accepter que des carences même importantes en mathématiques ou en langue étrangère soient « compensées » par des qualités en français ou en EPS ? Qui sait que la plupart des examens étrangers ne « moyennent » pas ! Un jeune Anglais est incapable de vous dire s’il a obtenu l’examen qui survient par exemple à la fin du lycée (sous le nom de GCSE-A level[5]) : il pourra en revanche vous dire dans quelles disciplines il a passé l’examen et le grade obtenu pour chacune d’elles. Cela fait évidemment plus de sens qu’un baccalauréat obtenu en moyennant plus de dix notes hétéroclites !
On voit apparaître là ce que nous avons appelé une véritable « indifférence aux savoirs », qui surprend d’autant plus qu’elle va de pair avec la focalisation sur la recherche élitiste des « meilleurs ».
D’ailleurs, la lente dévalorisation des deux examens qui ponctuent actuellement le cursus de l’enseignement scolaire (le brevet des collèges et le baccalauréat[6]) a été acceptée sans sursaut. Cette acceptation a comme conséquence que cet étonnant système tourné vers la sélection a laissé se dévaloriser ses propres modes traditionnels de sélection : d’autres modes, encore moins préoccupés des savoirs, procédant par dossiers scolaires, par CV, par entretien ou par repérage extra-scolaire de compétences diverses, tendent à les remplacer, au moins pour les compétitions les plus prisées.
Mais l’indifférence systémique la plus marquée en France vis-à-vis des savoirs scolaires, au profit d’un immense « Passe ton bac d’abord ! » ( c’est-à-dire « on réfléchira après ! ») n’apparaît nulle part mieux que dans ce constat de l’incapacité persistante du système à produire un mode cohérent d’élaboration des programmes scolaires : l’institution s’en fiche, a son attention fixée ailleurs. Dans de nombreux pays, on élabore ces programmes de façon méthodique à partir d’une interrogation de la société sur quel type de citoyen elle veut former. Cette visée générale est « enchâssée » dans un document de politique éducative doté de la plus grande force, et qu’on appelle le « curriculum ». Il fait loi. C’est-à-dire qu’un ministre de passage n’a pas la possibilité de le changer. En France, le mot de curriculum lui-même[7] n’a pas droit de cité car aucun ministre, sans parler des plus hautes autorités de l’État, n’a à ce stade souhaité voir exister de texte de cette nature et de cette force. Pour des motifs souvent électoralistes, lobbyistes ou petitement gestionnaires, les ministres, par définition de passage, aiment au contraire bien « jouer » avec les programmes qui, eux, sont pour l’essentiel du domaine du pérenne, de ce qui marque des générations. De tels agissements désordonnés devraient être proscrits !
Il a certes existé ou il existe divers types de commissions ou conseils chargés d’élaborer des programmes d’enseignement, mais seulement dans le cadre des disciplines traditionnelles, morceau par morceau et à partir de la juxtaposition de leurs programmes spécifiques. En France, le « tout » des programmes et de l’expérience d’apprentissage d’un élève au fil de sa scolarité n’est jamais autre chose que la juxtaposition des « parties », discipline par discipline. On parle ad libitum de programmes abusivement lourds, mais sans jamais avoir pris la mesure de l’origine de cette accumulation.
La question de la cohérence d’ensemble des savoirs enseignés à partir de finalités claires n’a pas droit de cité. Malgré les deux tentatives (2006 et 2013) de constitution, certes pour la seule scolarité obligatoire (primaire + collège), d’un texte de ce type sous le nom de « socle commun ». Ces tentatives échouèrent parce que ce type de référence ne faisait pas partie des habitudes d’une institution qui rejette toute perspective d’évolution en ce sens. Des « cohérences » pourtant existèrent dans le passé, chaque fois que l’École vit son rôle affirmé, comme avec les Jésuites au XVIIe siècle ou les Républicains au XIXe.
Ainsi la soi-disant démocratisation scolaire en route depuis le début des années 1970 a consisté en fait en un déclassement progressif de l’attention portée aux savoirs « pour eux-mêmes » au profit de celle portée aux flux et à la sélection face à ces flux. À aucun moment n’est apparue d’interpellation des savoirs enseignés dans le contexte de la démocratisation attendue. Parfois avec les meilleures intentions de proposer un « menu » à chacun, les savoirs communs ont plutôt perdu de l’importance symbolique dans une structuration des études qui est allée vers la multiplication d’options, de filières, de « dispositifs ». Ces évolutions ont eu comme conséquence de produire une « École de la fracture[8] » dans laquelle, au bout du compte, certains élèves bénéficient d’une exposition à des savoirs de plus grand empan, quand d’autres sont assignés à des « utilitaires », encore appelés « fondamentaux ».
Des savoirs hérités de cohérences anciennes, mais révolues
Cette indifférence aux savoirs qui semble caractériser le système éducatif français contemporain est celle qu’on retrouve dans l’analyse politique et les projets de réforme : pourquoi attendre quelque évolution de fond à partir de cette dimension de l’éducation dont on se désintéresse au quotidien ? Ne rien toucher aux contenus scolaires permet d’ailleurs de vivre tranquille, à l’abri des innovations risquées et sous le parapluie de divers classicismes qui ont fait leurs preuves.
« Transmettre aux jeunes générations » : on s’accorderait en effet volontiers sur cette fonction de l’École. Se pose toutefois immédiatement la question de ce qu’il convient de transmettre, et surtout de déterminer si on va indéfiniment transmettre les mêmes choses, alors que les savoirs disponibles évoluent sans cesse, de même que les sociétés qui peuvent bénéficier de la diffusion de ces savoirs, sociétés dont les membres ont besoin que des savoirs les aident à vivre. Ce double questionnement de la mise à jour permanente des savoirs en fonction des évolutions des connaissances aussi bien que des besoins des sociétés devrait être une des préoccupations majeures de l’École, alors qu’il est en général tenu aux marges.
Or, beaucoup de ceux qui s’occupent d’éducation et de politiques d’éducation n’ont pas compris à quel point l’histoire pèse sur ce qu’enseigne l’École : des choix faits tout au long de l’histoire de la scolarisation – des évolutions s’étant manifestées il y a des siècles dans des contextes révolus, ont encore des conséquences vivaces, devenues inconscientes et donc potentiellement dangereuses, sur ce que pratique l’École aujourd’hui.
On pourrait au fond, en allant trop vite sans doute, prendre plus ou moins arbitrairement trois étapes majeures de l’histoire de l’École en France, en nous inspirant partiellement des travaux d’Émile Durkheim[9], pour voir ce qui en résulte dans l’École contemporaine.
De l’École cathédrale, à visée catéchétique, qui fut après l’Antiquité le premier modèle d’École, l’École de France a gardé une préoccupation pour la conversion de l’âme, aux vérités révélées, à l’époque, comme à celles de la science, plus tard, avec deux traits caractéristiques : des certitudes, d’une part, et un manque d’intérêt marqué pour l’apprentissage de la vie, à laquelle, bien plus que dans les pays protestants, elle tourne le dos.
Du collège jésuite, qui produisit son brillant plan d’études à la fin du XVIe siècle, sous le nom de ratio studiorum, destiné aux classes supérieures qu’il fallait attirer pour les détourner de toute tentation protestante, l’École d’aujourd’hui a conservé son tropisme compétitif (les Jésuites ont ramené de Chine les concours à la française), son caractère élitiste, tourné là encore vers des savoirs qui servent à distinguer plutôt qu’à vivre, et aussi la prééminence accordée à un corpus de textes « classiques », censés contenir toute culture nécessaire au succès dans le monde.
De l’École qui s’est patiemment construite à partir des Lumières, autour des sciences d’une part, de la diffusion de certaines connaissances élémentaires dans le peuple d’autre part : ce fut l’École qui accompagna la révolution industrielle, en particulier avec la faveur pour les industries extractives, puis le développement en conséquence des nationalismes, et enfin toute l’expansion coloniale qui décida du partage du monde. Cette École, qui se bâtit sur la conception cartésienne de « l’Homme maître et possesseur de la nature », a été décrite de façon intéressante par des philosophes sous le nom d’École prométhéenne[10].
Voici donc les savoirs de l’École de France, qui tirent de cette archéologie composite et facilement contradictoire un certain nombre de constantes qui la hantent en la surdéterminant au travers des siècles : leur caractère centralisé, impératif, national, facilement nationaliste, européo-centré, abstrait, fait de certitudes, obéissant à une hiérarchie de disciplines elles aussi impératives, peu intéressée par la question des valeurs et de l’éducation à la vie, et délibérément « humaniste », avec ce que cela suppose de relative surdité au reste du vivant.
Des lignes de rupture à investiguer
Il ne faut dès lors pas beaucoup argumenter, une fois que ces traits ont été identifiés, pour admettre que le menu de l’École actuelle ne convient pas, que pour des motifs très divers, il n’est pas adapté aux besoins en matière de savoirs qui ont émergé dans les sociétés contemporaines.
Nous n’allons pas bien sûr ici « lister » des savoirs qui manquent ou sont inadaptés, mais seulement évoquer sous forme questionneuse ce qui nous semblerait devoir constituer des lignes de rupture à investiguer.
Rupture avec les hiérarchies indues des savoirs. La première ligne de rupture concernant les savoirs scolaires devrait consister à donner une égale importance à des savoirs qui correspondent à la diversité des expériences de la culture humaine, certes les savoirs des sciences et des œuvres écrites, mais aussi les arts, les savoirs du corps et manuels, et aussi les savoirs professionnels ou préprofessionnels. Les savoirs de l’école de base (avant seize ans) seraient à repenser dans cette optique. Outre que ce serait plus conforme à la richesse de la culture humaine, cela éviterait que la hiérarchie sociale pénètre trop avant dans les savoirs scolaires en privilégiant ceux sur lesquels se fonde à notre époque la sélection, comme une certaine forme des mathématiques, privilégiant à l’excès l’abstraction, comme ce fut le cas du latin à d’autres périodes. Il y aurait là bien évidemment un élément majeur de rééquilibrage des études qui favoriserait la fin de la stigmatisation de certains publics (en permettant l’épanouissement d’autres) et de certaines voies d’étude.
Rupture avec la présentation non critique de savoirs assimilés à des certitudes. La deuxième ligne de rupture à apporter aux savoirs scolaires procède de la condition même des savoirs à notre époque. En effet, le temps n’est plus où un élève n’était guère confronté qu’aux savoirs, stables et assurés, de l’École, acquis en son jeune temps, et en quelques cas, de sa famille. Les élèves baignent dans des informations multiformes, mais aussi de véritables théories, et on sait à quel point, dans la sphère d’expression publique et les médias, c’est tout le statut de la vérité qui est désormais contesté. La diffusion de fake news et de théories du complot étant le cadre des savoirs dans lequel évoluent les élèves, l’École ne peut plus diffuser ses savoirs sans tenir compte de ce récent contexte. La question de la vérité et de ses critères n’est plus une question marginale, mais doit être présente comme une préoccupation constante de l’École : les conditions d’élaboration des différents régimes de vérité selon les différents domaines de savoirs, la connaissance et la réflexion sur les critères de validité, la familiarisation avec les biais qui corrompent facilement nos raisonnements, tout cela devient au moins aussi important que les connaissances elles-mêmes. Au-delà, on voit que l’horizon qui caractérisera les savoirs de l’École par rapport aux savoirs qui circulent en tous sens au sein des sociétés sera de mettre en perspective les savoirs transmis en les doublant d’un point de vue critique et éthique sur les savoirs en tant que tels.
Rupture avec des savoirs tournant le dos à la vie. Troisième ligne de rupture : tirer les savoirs scolaires de la tour d’ivoire abstraite où ils se sont souvent enfermés pour les conduire à s’ouvrir à la vie. Il s’agirait de partir d’une analyse des besoins de repères qu’ont les jeunes pour vivre dans le monde contemporain, avec les apports de savoirs issus de la sociologie, par exemple, de l’économie domestique et de ceux de la vie en matière de santé, mais aussi de logement, de vie quotidienne et de rapport d’usage au monde technique. Là encore la valorisation des savoirs de la vie et des compétences pour vivre profiterait à tous les enfants et jeunes gens, mais servirait aussi à rééquilibrer les hiérarchies et classements entre élèves. Naturellement, en ce domaine comme dans d’autres, le point de vue critique serait essentiel, comme il vient d’être proposé.
Rupture avec des savoirs fermés à l’action. Quatrième ligne de rupture : il s’agirait de s’opposer à cette idée que les savoirs scolaires constitueraient un ensemble fermé, intitulé « instruction », et que ces savoirs n’auraient au fond aucune vocation à interférer avec l’action. Dans l’héritage traditionnaliste, la connaissance est réputée « connaissance pure », et l’éducation, de même que tout ce qui concernerait l’action (qu’elle soit personnelle ou collective, voire politique) serait d’un autre ordre, qui n’aurait rien à faire à l’École. Or, cette séparation entre connaissance et action, entre instruction et éducation ne répond pas à l’objectif de former des citoyens pour une société démocratique : il s’agira au contraire d’enseigner l’action, l’engagement, la gestion des associations, la prise de décision, et de faire en sorte que l’École devienne le premier terrain d’expérience de l’engagement et de la vie démocratique.
Rupture avec des savoirs prométhéens. Cinquième domaine où les savoirs scolaires doivent faire leur révolution : ce qui concerne le rapport avec le vivant et la conscience que l’École en donne aux élèves. L’École est en effet la résultante de siècles de prométhéisme (ce Titan qui déroba contre la volonté de Zeus le feu de l’Olympe pour l’offrir aux hommes, ce qui leur permit de développer les savoirs scientifiques et techniques et de dominer la nature) et ce n’est qu’un examen sérieux de l’impact de cette idéologie scientiste et techniciste qui permettra de modifier la donne et d’instituer l’objectif d’harmonie entre l’homme et le reste du monde vivant en se substituant à la perspective antérieure.
Rupture avec des savoirs limités à l’entre-soi. Une sixième révolution dans les savoirs scolaires consistera à considérer que l’École, en même temps qu’elle aide les élèves à construire des identités par définition diverses, doit les aider, au plan individuel comme à celui des sociétés, à gérer les rapports avec autrui. Individuels et collectifs. Pour cela, après un repérage des formes d’altérité dans la géographie, la société et l’histoire, il s’agira d’étudier les diverses formes de rapport à l’autre, pour les États comme pour les individus. Dans les disciplines où la question se pose, il ne s’agit pas d’omettre les références à la culture censée être indigène, c’est-à-dire française, ni en matière de littérature, ni en aucun champ culturel, mais de prendre conscience de la diversité des cultures autres, aussi bien en matière de littérature que dans tous les champs.
En bref, des savoirs à mettre en pratique aussi bien qu’à mettre en cause ! On mesure les changements dans la nature et la pertinence de tels savoirs, mais demandons-nous aussi si ces évolutions auraient des conséquences en matière de justice, puisque l’injustice dans l’accès aux savoirs est bien un des problèmes de l’École actuelle.
Or, comment ne pas imaginer qu’en jouant sur les hiérarchies des savoirs (1), sur des savoirs qui s’intéresseraient aux questions des élèves sur les divers statuts de vérité (2), sur le lien entre les savoirs de l’École et ceux de la vie (3), sur des savoirs introduisant à la vie démocratique et à l’action (4), sur des savoirs qui enseigneraient aux élèves des choses aussi nouvelles que l’harmonie avec le vivant (5), sur des savoirs qui seraient ouverts aux diversités linguistiques et culturelles (6), on changerait fortement la donne et le rapport entre les savoirs scolaires et le public scolaire ?
