Sans cela, la recherche et l’enseignement supérieur s’arrêteront…
Demain aura lieu la journée « L’université et la recherche s’arrêtent ». Au cœur de la colère qui s’élève des amphis et des labos, la question de l’emploi scientifique occupe une place centrale. Cette question n’est bien sûr pas nouvelle. Elle fut l’un des principaux déclencheurs du grand mouvement qui, au début des années 2000, a conduit à une démission collective des directeurs de laboratoires et donné naissance à « Sauvons la recherche ».
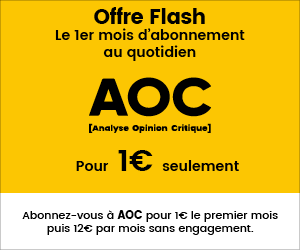
Ce fut aussi l’une des quatre principales revendications du mouvement qui, en 2009, a opposé pendant des mois les universitaires et les chercheurs à Valérie Pécresse et qui a vu la question de la « précarité de l’emploi scientifique » prendre de l’ampleur. En 2014, elle a également suscité le mouvement « Sciences en marche », réclamant une fois encore des financements, un plan pluriannuel de l’emploi scientifique et la résorption de la précarité.
Si aujourd’hui les jeunes chercheurs et universitaires sont particulièrement mobilisés, réclamant une nouvelle fois plus de postes et moins de précarité, leurs revendications doivent être les nôtres. Et, ce, que nous soyons chercheurs, universitaires ou simples citoyens. En effet, cette question de l’emploi scientifique est déterminante pour notre avenir collectif.
Allons vite, inutile de refaire la longue liste des divers arguments qui démontrent le caractère clef du secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur, arguments repris en chœur par tous les gouvernements successifs pour affirmer qu’ils en font « une grande priorité », sans que jamais les « preuves d’amour » ne suivent les grandes déclarations.[1] Or, il ne peut y avoir de recherche et d’enseignement supérieur forts, sans résoudre d’abord cette question de l’emploi scientifique.
Les chercheurs et universitaires savent bien tout ce que peuvent apporter dans une équipe le regard neuf et les questions d’un jeune chercheur.
En effet, la recherche et l’enseignement supérieur ce sont avant tout les hommes et les femmes qu
