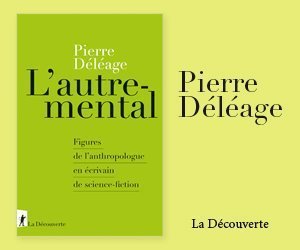Marseille, l’élection introuvable
L’élection municipale devait changer le visage de Marseille, tourner la page de vingt-cinq ans de gaudinisme, rompre avec plusieurs décennies d’abandon des services publics locaux, sanctionner les pratiques clientélistes et l’affairisme, pointer du doigt l’incurie, l’inconséquence et l’incompétence d’élu·e·s responsables, sinon coupables, des effondrements de la rue d’Aubagne et de la désastreuse gestion de la crise des délogé·e·s….[1]
Cette élection n’a pas (encore) eu lieu. En cause, bien sûr, la crise sanitaire qui après avoir bouleversé les conditions d’organisation du premier tour a contraint au report du second, qui aura finalement lieu le 28 juin prochain, après de nombreuses tergiversations. Pour autant, des leçons peuvent être tirées de cette élection à nulle autre pareille et surtout de cette campagne qui elle non plus n’a pas eu lieu… mais pourrait s’avérer riche d’enseignements sur le pouvoir municipal et son agonie.
Une campagne qui n’a pas eu lieu ? En voilà une affirmation étrange, car comment la démontrer ? Et d’abord qu’est-ce qui fait une campagne, qu’est-ce qui la constitue[2] ? Si l’on s’en tient à la définition classique d’une campagne comme « mise en œuvre concurrentielle d’ensembles de pratiques, de techniques et de savoirs visant à solliciter le suffrage des électeurs, dans une séquence temporelle précédant le vote », celle-ci s’est bien tenue à Marseille comme dans les autres communes en amont du scrutin du 15 mars.
Pour autant, et sans doute en raison des attentes suscitées par la perspective d’une succession inédite, l’émergence de nouvelles plateformes politiques transcendant les organisations partisanes et favorisant un profond renouvellement du personnel politique, ainsi que le dimension dramatique du contexte (délabrement des écoles, rapport accablant de la Chambre régionale des comptes, enjeu de l’habitat indigne, etc.), le décalage entre l’apparente ouverture de la configuration politique et l’étroitesse des propositions et visions tenues durant la campagne a été trop béant pour ne pas susciter d’interrogations.
L’abstention
Un premier tour s’est pourtant tenu, il y a une éternité : avant le confinement, le 15 mars dernier. Et comme partout, mais encore davantage qu’ailleurs, l’abstention a atteint des scores vertigineux : 67,2% à l’échelle de la ville. Seulement un peu plus de 160 000 personnes se sont déplacées pour voter sur 500 000 inscrit·e·s. Depuis 1995, le premier tour de l’élection municipale mobilise environ 54% des inscrit·es : l’abstention était de 45,1% en 1995, 47,8% en 2001 et de 42,3% en 2008.
Le chiffre est donc historique à l’échelle de la ville ; il est aussi plus haut que dans les autres métropoles du pays, même si l’épure reste la même : 61% à Lyon et à Nantes (-6 points), 63% à Bordeaux et à Toulouse (-4), 65% à Strasbourg (-2). Seules Nice et Lille font « mieux » avec respectivement 71,5% et 67,4% d’abstention. De quoi soulever la question de la légitimité des équipes qui sortiraient vainqueurs de ce jeu de massacre de la participation.
Dès le lendemain du vote, des voix s’étaient élevées contre la décision de maintenir le vote dans des conditions sanitaires douteuses et, on l’apprendra la période d’incubation passée, dangereuses pour les présidents des bureaux, leurs assesseurs et les électeur·ice·s. Des politistes dénoncent dans Libération la « forfaiture démocratique » de l’organisation de l’élection, puis de la reconnaissance des résultats.
À Marseille, cette abstention, qui brouille considérablement la lecture des résultats, n’a pas été distribuée de manière égale. En effet, en vertu de la loi PLM, les conseiller·es municipaux·les de Marseille sont élu·e·s suivant un mode de scrutin particulier : la ville est divisée en arrondissements – deux arrondissements constituant un secteur – et dans chacun de ces secteurs, a lieu une élection qui désigne les conseiller·es de secteur, municipaux et métropolitains. Or, les disparités ont été fortes entre les secteurs.
Pour le dire trop rapidement, l’abstention est plus forte dans les quartiers populaires (2e, 7e et 8e secteurs) où elle dépasse 70% ; elle est également importante dans les quartiers résidentiels du sud (62,9% dans le 4e secteur) et de l’est (autour de 69% dans les 5 et 6e secteurs) et relativement moins importante dans les quartiers centraux (environ 59% dans les 1er et 3e secteurs). Or, les rapports de force sont plutôt favorables à l’extrême-droite dans les premiers, à la droite dans le second et à la gauche recomposée dans les derniers.
Est-ce à dire que l’électorat du RN et de LR, plutôt plus âgé que celui des listes de la gauche et des écologistes, s’est moins déplacé, craignant davantage la dangerosité sanitaire des bureaux de vote ? C’est ce qu’observe le journal en ligne Marsactu qui à partir de l’analyse des cartes des résultats par bureau montre que « les quartiers les plus marqués par le recul sont aussi ceux où Marine Le Pen était la plus forte en 2017, près de 30 % en moyenne, bien au-dessus de son score sur la ville » et conclut que « c’est Stéphane Ravier qui a payé le plus lourd tribut de la démobilisation ». Un RN qui faisait figure de quasi-favori du scrutin et qui, à l’échelle de la ville, n’arrive qu’en troisième position derrière les listes du Printemps Marseillais (23,4%) et LR (22,3%) en ne réalisant que 19,5% des voix, en recul de 6,7 points par rapport à la municipale de 2014 (perdant 27 674 voix !). Lors de la publication des résultats, son chef de file a ainsi estimé que c’est « le coronavirus qui [était] sorti vainqueur » du premier tour.
La campagne
Si le premier tour n’a pas vraiment eu lieu, y a-t-il eu une campagne qui lui a précédé ? Rien n’est moins sûr, et cela interpelle les spécialistes du pouvoir local : comment et pourquoi le débat politique a-t-il été aussi atone alors que :
1. Les effondrements de la rue d’Aubagne de novembre 2018 ont été l’occasion d’une contestation et d’une remise à plat de l’ensemble de la politique municipale, comme l’expliquait Loïc le Pape sur AOC ;
2. La succession du maire était inéluctable pour la première fois depuis Robert-Paul Vigouroux, donc depuis 3 décennies, Jean-Claude Gaudin ne se représentant pas.
Pour le comprendre, il faut sans doute revenir aux sens et aux fonctions d’une campagne électorale. Moisey Ostrogorski, l’un des fondateurs de la sociologie politique, par ailleurs élu de la Douma en Russie, disait à la fin du XIXe siècle, que les dirigeants ne sont pas « élus », mais « se font élire »[3]. Le vote ne serait donc pas le résultat de l’intérêt spontané des individus pour la politique, mais le produit d’un travail d’enrôlement des citoyen·ne·s par des professionnel·lle·s de la politique. Et si les votes sont produits, les campagnes électorales sont des moments privilégiés de production de ces votes, même si les analyses qui s’intéressent aux déterminants du vote (pourquoi on vote, pour qui) montrent que les campagnes ne font que renforcer des préférences préalablement constituées.
Dans un idéal démocratique, pourtant, la campagne organise la confrontation raisonnée de visions du monde, de conceptions de l’intérêt général (« projet contre projet ») qui sous-entend que les opinions des électeur·ice·s peuvent évoluer et qu’il est possible de convaincre. Mais une campagne se réduit-elle à sa fonction démocratique idéale ? Quels que soient les effets des campagnes sur les électeurs, on peut considérer celles-ci comme un analyseur des systèmes politiques, puisque c’est dans les campagnes que sont réactivés et renégociés des loyautés politiques, des soutiens et des légitimités ; et, on peut toujours l’espérer, que des enjeux sont soumis à la discussion. Les campagnes constituent ainsi un travail de mobilisation électorale visant à diffuser une « offre politique » et à persuader les électeur·ice·s de s’y rallier en votant pour ces candidats.
Or, la campagne municipale marseillaise de 2020 a été ridiculement pauvre en « offre » alors que les « demandes » n’ont jamais été aussi fortes et bruyantes. Bien sûr, cela ne signifie pas que les propositions des un·e·s et des autres ont été absentes, mais aucune n’a véritablement « imprimé » comme disent les communicants. Non seulement aucune n’a été retenue dans l’opinion ou le champ médiatique, mais bien malin qui parviendrait à résumer à grands traits la vision, le discours ou le récit du territoire proposé par les candidat·e·s. Dépourvu de la capacité à produire récit ou vision, que resterait-il donc au pouvoir municipal, fragilisé par la montée en puissance de l’intercommunalité et l’omniprésence des acteurs privés dans la gouvernance urbaine ?
Sans doute est-il utile ici de faire une (brève) chronique de cette introuvable campagne. À droite, la succession était ouverte depuis longtemps. Âgé de 80 ans, le maire ne se représenterait pas et ne figurerait sur aucune liste. Une première depuis 1965. Plus d’un siècle de mandats cumulés qui allait s’achever. La page allait être longue à se tourner.
D’autant plus longue qu’il avait consciencieusement éliminé tous ceux dans son camp qui prétendaient lui succéder : de Renaud Muselier à Guy Teissier, en passant par Yves Moraine. La ligne de départ était désertée. Si les impétrants n’existaient (quasiment) pas, restaient les institutions. C’est cette carte qui permettra à la présidente du département et de la métropole, Martine Vassal, d’incarner le changement dans la continuité. Tandis que le premier est quasiment dépourvu de compétences en matière de politiques publiques, hormis le coûteux financement des allocations individuelles de solidarité, la Métropole est devenue l’institution gagnante des réformes territoriales qui se multiplient depuis 2010.
Pourtant, c’est en succédant au multi-mis en cause Jean-Noël Guérini en 2015 à la tête du conseil départemental que le grand public commence à la connaître. À la tête d’un budget de plus de 2,5 milliards d’euros, elle poursuit et renforce la politique « d’aides aux communes » qui consiste à distribuer massivement l’argent aux collectivités du département, qui pour financer la rénovation d’un gymnase, qui pour construire une école, qui, surtout, pour bénéficier de l’appui de ces élu·e·s pour les échéances à venir. Un an seulement après son arrivée à la tête du bateau bleu (nom donné au siège du conseil départemental pour son allure architecturale), Marsactu sort la calculette : 100 millions d’euros ont été distribués en un an aux communes du département, et 100 millions supplémentaires pour la seule ville de Marseille.
Cette ressource de légitimation par le haut et par les finances est renforcée par l’accès de la même Martine Vassal à la tête de la toute nouvelle Métropole Aix-Marseille Provence créée, après bien des tourments et contre les élu·e·s locaux·les, en 2016. Son principal atout pour succéder à Jean-Claude Gaudin à cette fonction en septembre 2018 ? Le fait de diriger le département. Le cumul justifiant le cumul, elle déclare alors que « très souvent le département finance des projets et c’est la métropole qui les exécute : l’avantage c’est que je vais avoir les deux pieds, d’un côté et de l’autre pour plus d’efficacité, plus de résultats. »
L’avantage aussi, réside dans les 4,4 milliards euros de budget de la Métropole. Avec un total de 7,2 milliards d’euros, elle accède à la tête du deuxième budget local du pays, loin devant la Région Île-de-France (4,8 milliards d’euros) et ne se faisant devancer que par la ville de Paris (9,6 milliards). C’est assise sur ce mont d’or qu’elle diffuse son image, usant et abusant des outils de communication, entretenant la confusion entre les politiques d’institution et la promotion personnelle, et lui permettant de se faire un nom auprès de la population. Ainsi, elle finit par s’imposer dans son camp pour se présenter à cette première municipale de l’après-Gaudin.
Seul le sénateur Bruno Gilles lui résiste. À la tête de la fédération LR des Bouches-du-Rhône, ce fidèle du Président de la Région, Renaud Muselier, et ex-maire des 4e et 5e arrondissements, peut se prévaloir d’une connaissance fine du tissu électoral. Ses premières déclarations de candidat laissent de côté les questions classiques des enjeux métropolitains – attractivité, développement économique, grands projets d’aménagement – pour mettre l’accent sur la proximité et la sécurité. Mais les sondages commandés par son parti ne lui sont pas favorables, et les instances nationales finissent par investir sa rivale en novembre 2019. Sa proposition de deal « à toi la Métropole, à moi la ville » ne satisfait pas celle qui a fait du cumul du pouvoir local son leitmotiv. Bruno Gilles finira par quitter LR en maintenant sa candidature, pour conserver sans doute sa mairie de secteur ?
Le champ presque libre, Martine Vassal occupe pourtant la campagne par le vide. De leurs propres aveux, les observateurs de sa campagne en sont sortis épuisés : plusieurs événements par jour, avec son lot d’annonces et son programme-catalogue de 250 pages. Et pourtant, à son issue, personne ne retiendra aucune de ses propositions – mis à part peut-être un improbable projet de piscine sur la mer dans le prolongement du parc Borely au sud de la ville –, appuyées sur quatre piliers répétés comme un mantra : « Travailler, partager, respirer et protéger ».
Son comité des 300 experts, mandatés au printemps 2019 pour lui soumettre des propositions, semble bien loin. En revanche, la dépolitisation des affaires locales marche à plein et confirme que celles-ci reposent sur une rhétorique du pragmatisme ou de la technicisation. L’impression d’une aggravation de la crise démocratique des politiques locales est encore renforcée ici par son refus de débattre avec ses concurrents. Rien ne se serait donc « passé » dans la campagne de Martine Vassal ? Mais l’important, comme l’enseigne Howard Becker, n’est-il pas « ce qui se passe quand il ne se passe rien » ?
À la fin de la campagne, l’équipe autour de Martine Vassal a mis sur l’agenda deux enjeux tactiquement troublants, mais qui ont paradoxalement contribué à donner un semblant de politisation à cette élection. En premier lieu, elle a martelé être la seule candidate face aux extrêmes, droite et gauche, en tentant de faire passer le Printemps Marseillais pour un repère de gauchistes, tantôt en recouvrant une partie du centre-ville d’affiches supposées représenter ces dangereux black-blocs, tantôt en brandissant le spectre d’un « hiver sibérien ». En second lieu, le pourtant classique thème de la « bétonisation » est devenu, dans la dernière ligne droite de la campagne, son invité surprise, Martine Vassal déclarant vouloir « mettre fin à la bétonisation » afin de « réintroduire la nature au cœur de la ville ».
Dix jours avant le scrutin, elle annonce l’abandon du projet d’aménagement urbain du site de Legré-Manté sur une ancienne usine d’acide tartrique ; projet pourtant toujours soutenu par la majorité à laquelle elle appartient. Emportée par cet élan écolo, elle annonce son opposition à tout projet immobilier, notamment au sud (Saint-Giniez, Pastré, Boulevard Urbain Sud…). Signe d’une soudaine inspiration verte ou vent de panique dans son camp ? Ces propositions auront au moins permis, outre de la mettre face à ses propres contradictions, de politiser l’affrontement électoral sur des enjeux de politiques publiques.
À gauche, l’enjeu de cette campagne était doublement crucial. Il ne s’agissait pas seulement de s’emparer du pouvoir municipal et de réaliser l’alternance, mais aussi de refonder une gauche en rompant avec des organisations partisanes réduites en cendre. Là aussi, on peut se demander si cette refondation a eu lieu. Le discrédit s’explique certes par le contexte national : est-il besoin de revenir sur la rapide agonie du PS depuis 2012 ? À Marseille, il s’ancre dans un contexte et porte un nom : Jean-Noël Guérini – patron incontesté de la fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, leader de la gauche marseillaise, sénateur-baron, éternel « maire du Panier » et président du puissant Conseil général entre 1998 et 2015.
En février 2009, une lettre anonyme détaillant l’existence d’un « système » de détournement de fonds et de trafic d’influence, débouche sur l’ouverture d’une enquête dont les ramifications sont tentaculaires. Elles conduiront à la mise au ban du dernier boss marseillais, à la tête d’une « machine politique » définie par François Bonnet comme une « organisation conçue pour gagner les élections en mobilisant des clientèles dans le cadre de relations personnelles et de solidarités ethniques ». La chute de la maison Guérini, toujours en attente de procès, entraîne avec elle la destruction des réseaux militants du PS marseillais.
À l’approche de l’échéance municipale de 2020, ceux-ci tenteront de se reconvertir – certains diront perfidement se « recycler » – dans une initiative conçue comme un débordement des logiques partisanes. En juillet 2019, une cinquantaine de personnalités issues de formations politiques de gauche, mais aussi de la « société civile » publie une tribune dans Libération qui annonce « la naissance d’un mouvement sans précédent » baptisé le « Rassemblement inédit ». Presque concomitamment, d’autres forces progressistes, issues des quartiers populaires et actives dans le sillage des mobilisations ayant suivi les effondrements des immeubles de la rue d’Aubagne, scellent un « Pacte démocratique » destiné à peser sur la future élection. En filigrane plane l’ombre d’une France Insoumise, dont les militant·e·s sont présent·e·s dans les deux initiatives, sans que Jean-Luc Mélenchon, pourtant élu député dans la ville, ne s’implique réellement.
Suivent de longs mois de négociations et de déceptions, d’incompréhensions sur les orientations tactiques ou les choix programmatiques de fond. Le « Rassemblement inédit » qui se transforme en « Printemps Marseillais » durant l’automne 2019 est accusé de laisser une place grandissante aux anciens caciques des organisations partisanes honnies : PCF, EELV, et surtout PS. Une controverse qui place au premier plan le défi du renouvellement que la gauche marseillaise n’a jamais su relever. La pomme de discorde est représentée par le soupçon de voir nommé à la tête des listes du Printemps Marseillais Benoît Payan, le chef de file des socialistes au conseil municipal, toujours membre du parti de la vieille maison.
Cette question qui a saturé le discours médiatique sur l’initiative, jusqu’à invisibiliser toute réflexion de contenu, polluera la dynamique de la campagne. Une réflexion qui a pourtant eu lieu, on peut l’imaginer, si l’on en croit les dizaines de groupes de travail ou les centaines d’heures de réunions. Une fois encore, si quelque chose s’est sans doute passé, personne ne sera capable, publiquement, au cours de la campagne, d’expliciter ses contours ou son contenu.
Au tout début de l’année, Payan renonce bien à la tête de liste, mais le mal est fait et il est sans doute profond : dès le mois d’octobre, EELV organise un vote interne qui acte la rupture. Et même si seulement 74 militant·e·s participent à la consultation, l’écho est considérable : son chef de file, Sébastien Barles, part seul et conduit les listes « Debout Marseille ». En réponse, le Printemps Marseillais se dote d’une cheffe de file… écologiste : Michèle Rubirola, peu connue nationalement – mais qui l’est ? – médecin, membre des Verts depuis 2003 et conseillère départementale depuis 2015.
Ajoutez à la confusion l’initiative de Samia Ghali, la seule dotée d’une notoriété nationale – même si elle est nationalement connue comme étant une figure locale – depuis 2012, et sa proposition d’installer l’armée pour « sécuriser » les cités marseillaises. Propulsée par Jean-Noël Guérini depuis 2008, sénatrice socialiste et maire du 8e secteur qui recouvre les 15 et 16e arrondissements du nord de la ville jusqu’en 2017, date à laquelle elle est frappée par la règle du cumul des mandats, elle mène sa carrière politique en franc-tireur et se présente en rupture des appareils partisans. Lorsqu’elle annonce sa candidature dans les colonnes d’un hebdomadaire national, en décembre, elle n’y va pas par quatre chemins : « La ville a besoin que l’on soit la vraie Madone de Marseille » déclare-t-elle, accentuant l’image de pasonaria brossée par les médias parisiens. Mais si observateur·ice·s et candidat·e·s ne peuvent que lui reconnaître son aura médiatique, tous s’interrogent sur sa capacité à rassembler au-delà de son bastion des quartiers nord.
Au total, alors que la majorité sortante est critiquée de toute part, non seulement pour sa gestion de la catastrophe de Noailles, mais aussi parce que plusieurs adjoints s’avèrent être des propriétaires de logements insalubres, et parce qu’elle est divisée à l’approche du scrutin ; la gauche marseillaise se présente à l’élection municipale en ordre dispersé, sans incarnation, ni programme, mettant ainsi toutes les chances de son côté pour perdre une élection imperdable.
L’extrême droite compte les points en tapant dur. Son responsable local, Stéphane Ravier, RN-tendance Jean-Marie Le Pen, est le maire du 7e secteur depuis 2014, qui couvre les 13 et 14e arrondissements du nord de la ville et ses 150 000 habitants, ce qui en fait, à l’échelle du pays, l’élu local RN qui administre le plus d’habitants. Sans aucun rival dans son parti tout en ayant permis une relative montée en professionnalité de certain·e·s candidat·e·s, il martèle les thèmes de prédilection du vieux FN sans craindre la diabolisation : insécurité, immigration, islamisation.
Son meeting de lancement est centré sur le thème du « grand remplacement » sans susciter de réaction de la part de ses opposants. Bien que peu ancrée dans les secteurs bourgeois de la ville, l’extrême-droite compte sur le rejet du bilan de la droite, la division de la gauche et l’impréparation du parti présidentiel pour l’emporter, ou du moins rendre le conseil municipal ingouvernable et tenter un coup lors du troisième tour, celui de l’élection du maire en séance, où certains conseiller·e·s municipaux·les LR pourraient être tentés par la solution Ravier ?
Quid d’En Marche, enfin ? Le cas marseillais illustre jusqu’à la caricature l’échec du pari de la majorité présidentielle dans le dilemme suivant : comment ne pas devenir un parti d’élu·e·s sans perdre la face – et pourquoi les deux objectifs ne sont pas exactement atteints. Ici, le fiasco prévisible, d’autant plus dans le contexte national, s’est révélé dans l’atermoiement précédant le choix du candidat. Le feuilleton interminable de l’annonce de la tête de liste, qui débouchera sur le choix de l’ancien président d’Aix-Marseille Université, Yvon Berland, masque très mal l’absence de toutes propositions ou visions de la ville et de la métropole.
Pire, en offrant la place de numéro 2 sur l’une de ses listes (4e secteur) à une adjointe de la majorité Gaudin sortante (Caroline Pozmentier, l’ancienne chargée de la sécurité et responsable de la mise sous vidéo-surveillance de l’hyper-centre), ou en voyant un Marcheur prétendant à l’investiture LREM, finalement éconduit, occuper une fonction de tête de liste dans le camp de Martine Vassal (Jean-Philippe Agresti), le parti de la majorité présidentielle est parvenu à se priver de son seul argument, celui du renouvellement et de la rupture avec le gaudinisme. Ici encore, une campagne qui n’a pas eu lieu ; les rares électeurs qui se rendront aux urnes le 15 mars ne s’y tromperont pas, en sanctionnant durement ce vide.
Les résultats et les tractations d’entre-deux tours
Si les résultats du 1er tour ont bien été prononcés, et qu’ils ont donc bien eu lieu, ils sont pour le moins en trompe-l’œil, comme le reste de cette élection.
Le regard médiatique se porte en premier lieu sur les chiffres à l’échelle de la ville. Les listes du Printemps Marseillais menées par Michèle Rubirola arrivent en tête avec 23,4% et devancent celles de Martine Vassal (22,3%) de 1812 voix. Chacun relève cependant que la candidate de gauche réalise 15 000 voix de moins que son chef de file en 2014, Patrick Mennucci, pourtant alors largement battu. La surprise est de voir le RN (19,5%) et EELV (8,1%) distancés[4]. De leur côté, les listes soutenues par la majorité présidentielle réalisent un piètre 7,9%, tout juste au-dessus de la barre leur permettant de se faire rembourser les frais de campagne. Enfin, les paris des dissidents sont à moitié réussis : Bruno Gilles (10,7%) est en position de force pour les négociations de l’entre-deux-tours, mais Samia Ghali (6,4%) est en difficulté dans son fief du 8e secteur où elle arrive certes en tête (25,8%), mais talonnée par le RN (22,2%) et face à la perspective d’une quadrangulaire au second tour, en cas de maintien des listes de gauche qualifiées.
Mais c’est sur ces deux points que se jouent l’élection et se jaugent les résultats : le découpage par secteur qui rend complexe la lecture d’ensemble, d’une part, et les tractations en vue du second tour qui ont rendu leurs interprétations parfois illisibles, d’autre part. Pour ne prendre qu’un exemple, à la fois le plus symbolique et le plus décisif pour le résultat final à l’échelle de la ville : le 7e secteur (13e et 14e arrondissements) détenu par le chef de file du RN, Stéphane Ravier.
Celui-ci était arrivé en tête (33,5%), laissant loin derrière ses challengers de LR (18,2%), du Printemps (15,6%) et le représentant de Samia Ghali (11,3%). Pour éviter de reproduire le précédent de 2014 qui avaient vu une triangulaire permettre l’élection du candidat RN, les deux listes de gauche annoncent au lendemain du premier tour leur désistement, laissant ainsi en face à face, LR et RN. Or, à Marseille, le RN n’a jamais gagné en duel dans un second tour. Mais si le candidat de Martine Vassal venait à gagner dans ce secteur le plus peuplé de la ville et le plus pourvoyeur en conseillers municipaux, et c’est le rapport des forces à l’échelle de la ville qui s’en trouverait bouleversé au profit de la droite.
Le confinement a étiré les négociations et tractations en vue du second tour, mais, comme souvent, tout s’est joué dans les dernières heures avant le dépôt des listes le 2 juin. Finalement, le paysage des affiches secteur par secteur témoigne d’un profond morcellement des forces et des divisions internes à la gauche et à la droite, renforçant l’idée que cette campagne, loin d’avoir clarifié les positions et les enjeux, les a brouillés.
Pas moins de quatre triangulaires et trois quadrangulaires figurent au copieux menu du second tour le 28 juin prochain. Le RN est la seule formation qui présentera des listes dans chacun des secteurs avec des chances variables de l’emporter, mais compte sur la forte abstention du premier tour pour envisager des réserves de voix. A droite, les listes de Martine Vassal et du dissident Bruno Gilles ne sont pas parvenues à conclure le « pacte de raison » que le président de Région, Renaud Muselier, avait appelé de ses vœux pour écarter le « péril rouge » que représenterait l’accès au pouvoir municipal du Printemps Marseillais et des « amis de M. Mélenchon » pour reprendre les termes employés dans le camp de la candidate LR.
Malgré ses bons résultats du premier tour et le ralliement des listes de Debout Marseille menées par l’écologiste Sébastien Barles, le Printemps marseillais n’est pas du tout assuré de remporter le fauteuil du maire. Et si tout devait se jouer lors d’un « troisième tour » organisé à l’occasion de la première séance du conseil municipal pour l’élection du maire ? A moyen terme, c’est la question de l’ingouvernabilité de la ville qui se pose à l’issue d’une campagne qui, si elle n’a pas vraiment eu lieu, ne sera pas oubliée.