La déontologie parlementaire et ses limites
Ce 28 juin débutera la XVIe mandature qui s’accompagnera de l’arrivée d’élus en partie renouvelés. Le rapport de force entre groupes politiques sera également profondément modifié. Le contexte se prêtera à une mise à jour des règles organisant les activités de cette institution, en particulier celles concernant la question, toujours extrêmement sensible, de l’utilisation du budget de l’Assemblée nationale. Le contexte sera particulièrement favorable, si Madame Yaël Braun-Pivet (élue LRM), ancienne présidente de la commission des lois est élue présidente de l’Assemblée comme il en est question[1]. Ce sera aussi l’occasion de voir la nouvelle NUPES à l’œuvre.
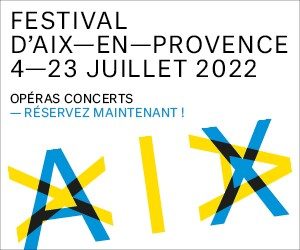
Rappelons qu’à la suite de l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, deux lois avaient marqué une étape décisive dans l’évolution du contrôle de l’usage de l’argent public par les parlementaires : celles du 15 septembre 2017 sur « la confiance dans la vie politique »[2]. Le nouveau président de la République avait tenu à ce que son mandat débute par ces décisions symboliques censées indiquer une façon de gouverner intègre en rupture avec des pratiques politiques antérieures décriées comme en témoigne, entre autres, « l’affaire Fillon ». Le début de la nouvelle mandature sera-t-elle l’occasion de compléter et renforcer les dispositions adoptées en 2017 qui sont restées lacunaires ?
L’interdiction des emplois familiaux, la limitation des activités cumulables avec le statut de député et la réforme de l’allocation de frais de mandat ont été des apports significatifs à une gestion probe. Cependant, un ensemble de lacunes ont été observées durant ces cinq dernières années : la facilitation des conflits d’intérêts par le cumul autorisé des activités de conseil avec le mandat politique, l’emploi à temps partiel d’assistants parlementaires par des groupes d’intérêts, la faiblesse du contrôle de l’usage des frais de mandat ainsi que celle des sanctions en cas d’abus, enfin, le manque d’autonomie du déontologue de l’Assemblée pour ne citer que quelques exemples saillants.
La régulation de l’usage des fonds publics par le parlement pose une délicate question de fond : « l’indemnité et les ressources liées à la fonction sont utiles pour assurer l’indépendance vis-à-vis de l’exécutif ; la possibilité d’enquêter, la capacité à représenter, celle de représenter et l’indépendance vis-à-vis des acteurs privés[3] ». Cette séparation des pouvoirs a pour conséquence que seul le Parlement peut édicter les normes relatives à son fonctionnement. C’est donc sur l’éthique des élus que repose l’auto-régulation de cette institution. Comme l’a formulé un juriste : « On n’a jamais vu de renards garder un poulailler[4]. » La question se pose alors du type de contrôle exercé sur l’usage des ressources mises à la disposition des parlementaires ? Comme pour les comptes de l’Élysée, il a fallu plus de deux siècles[5] pour que la régulation des budgets alloués aux parlementaires devienne une préoccupation politique et soit inscrite à l’agenda des assemblées. L’archaïsme de ce privilège n’est devenu visible qu’au début du XXIe siècle. Jusqu’en 2017, les assemblées avaient préservé leur autonomie de décision financière et s’étaient refusé à tout contrôle extérieur.
La situation déficitaire des finances publiques, la crise financière de 2008 et la demande citoyenne de transparence dans les décisions publiques ont exercé une pression croissante sur le Parlement et contribué à remettre en cause son système d’autorégulation dérogatoire. Depuis, ce dernier a évolué à petits pas, mais il présente encore de nombreuses limites. L’opacité entretenue et les arrangements entre pairs n’ont pas totalement pris fin. L’un des indicateurs de cette connivence clanique est l’absence de politisation du sujet. Les clivages habituels (droite/gauche, majorité/opposition) se sont très peu manifestés lors des débats et dans le choix des mesures retenues, signe d’une robuste solidarité de fonction qui transcende les positions idéologiques. À droite comme à gauche, à chacune des étapes réformatrices, des élus ont critiqué des objectifs populistes, des mesures démagogiques, des encouragements à la défiance, ont manifesté des réticences à l’égard des obligations de déclaration d’intérêts ou de contrôle des indemnités parlementaires, etc. Cependant, à tour de rôle, les majorités de droite puis de gauche ont peu à peu limité l’opacité de la gestion parlementaire.
2008 : l’entrée en scène de la Cour des comptes
Un premier signal est venu de la Cour des comptes qui, depuis les années 1970, rappelle que son mandat de contrôle des dépenses publiques inclut celui de toutes les institutions étatiques. Fin 2007, la Cour obtient du Bureau de l’Assemblée nationale[6] la possibilité d’effectuer une mission de contrôle pour l’exercice 2006-2007[7]. Le rapport est rendu public en novembre 2008. La Cour se montre sévère, elle relève des coûts de fonctionnement élevés et croissants et demande des modifications d’organisation et de procédures. En dix ans, les dépenses ont progressé de 47 %[8], et les importants investissements destinés aux travaux n’expliquent pas tout. En 2007, le budget de fonctionnement (506 millions d’euros) continue de croître.
Les magistrats regrettent une « prévision budgétaire annuelle médiocre », considèrent qu’il n’y a pas de politique d’achat et constatent de curieuses pratiques financières (une dizaine de comptes bancaires non coordonnés, une cagnotte évaluée à 302 millions d’euros). Ils pointent également l’importance des frais de personnels (156 millions d’euros)[9] et l’évolution croissante des charges parlementaires (quelque 280 millions d’euros), c’est-à-dire les indemnités des élus, leurs frais de représentation et les crédits dévolus aux salaires de leurs collaborateurs.
Dans un contexte économique et politique où l’orthodoxie budgétaire est devenue un objectif gouvernemental, le contrôle du budget du Parlement est demandé par le président de la République (François Hollande[10]) et le Premier ministre (Jean-Marc Ayrault). Ce n’est qu’à partir de 2012 que les deux assemblées acceptent « une mission annuelle en vue de la certification de leurs comptes » par la Cour des comptes. Une convention est signée en juillet entre cette dernière et la présidence des deux assemblées, et sera effective à partir de l’exercice 2013[11].
2011 : l’entrée en scène des déontologues
C’est indirectement à l’occasion de la régulation des conflits d’intérêts des élus qu’est posée la question des rétributions des parlementaires. Depuis la Révolution française, le souci de préserver la définition de l’intérêt général par les représentants du peuple de l’influence des intérêts particuliers a été permanent. Quelques incompatibilités ont été prévues par la Constitution[12] et le droit pénal sanctionne l’ingérence dans les décisions publiques[13]. Mais ces règles sont insuffisantes pour entraver l’emprise régulière des intérêts privés sur la production des lois. Le moyen le plus utilisé pour conduire un élu ou un fonctionnaire à agir en faveur d’un intérêt particulier est de le rémunérer directement ou indirectement (en lui fournissant différents avantages pour lui ou pour des tiers), soit en cours de mandat, soit ultérieurement.
C’est pour limiter ce type d’interférence qu’une commission est mise en place en septembre 2010. Elle introduit en France la notion de « conflit d’intérêts » et des moyens pour les prévenir et les sanctionner. Des modèles existent déjà dans les pays anglo-saxons et certains sont recommandés par le Conseil de l’Europe (2000) et l’OCDE (2005)[14]. Le rapport Pour une nouvelle déontologie de la vie publique[15] de janvier 2011 ne concerne que l’exécutif (gouvernement et administrations) et les entreprises publiques. Mais le Premier ministre, François Fillon, suggère alors aux responsables des deux assemblées de mener une réflexion similaire pour l’activité parlementaire.
Elles optent pour des solutions différentes. Le Sénat met en place un comité de déontologie, composé d’élus représentant chaque groupe politique. De son côté, l’Assemblée nationale se dote en avril 2011, d’un code de déontologie[16] qui rend obligatoire les déclarations d’intérêts et institue un poste de déontologue chargé, entre autres, de recueillir et de vérifier ces déclarations[17]. Cinq déontologues se sont succédés jusqu’en 2020[18]. Leurs rapports annuels permettent d’identifier les principaux enjeux traités et les réponses de l’Assemblée. Nous en analyserons deux qui permettent de cerner la délicate question des compléments de rémunération : les conflits d’intérêts et l’indemnité d’exercice du mandat.
Le premier rapport pour l’année 2012 est surtout théorique : il est muet sur la qualité des déclarations qui lui ont été soumises, indique que seule une dizaine de députés se sont adressés au déontologue pour des conseils et dégage les principales situations dans lesquelles peuvent se manifester les conflits d’intérêts[19]. Le rapport pour 2013 fait le point sur la déclaration d’intérêts instituée en 2011 et rappelée dans la loi d’octobre 2013 sur « la transparence de la vie publique »[20]. Dans leur ensemble, les députés s’y sont soumis : 27 % déclarent une activité professionnelle en cours (surtout des avocats et des médecins), 5 % sont des consultants. Le rapport pour 2014 prend en compte les effets de la création en 2013 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Si c’est elle qui devient destinataire des déclarations d’intérêts des élus, le bureau de chaque assemblée conserve le soin de déterminer des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Le déontologue, qui a reçu soixante demandes de conseil, portant le plus souvent sur la dimension financière de l’activité d’élu, souligne la difficile démarcation entre les activités d’avocat et celles de conseil donné à des organismes économiques et financiers. Il est ainsi saisi, en février 2014, par douze députés de gauche pour vérifier si les activités de conseil exercées par François Fillon, alors député, ne sont pas susceptibles de constituer un conflit d’intérêts. Sa réponse est négative[21]. L’année suivante, en 2015, le déontologue est moins sollicité, il n’a donné que cinquante consultations. Sur la base de ses observations, il souhaite rendre public la liste des cadeaux et avantages déclarés par les élus ainsi que les détails sur les voyages effectués.
En octobre 2012, le bureau de l’Assemblée avait confié au déontologue une mission sur « l’indemnité représentative de frais de mandat » (IRFM), qui complète l’indemnité parlementaire (salaire) pour les frais de représentation. Cette somme étant à la discrétion du parlementaire, certains élus l’utilisaient pour des activités sans lien avec leur mandat. « Du fait du principe de la libre organisation de l’exercice du mandat, les catégories de dépenses imputables à l’IRFM n’ont jamais été précisées », écrit le déontologue (rapport 2013, p. 64)[22]. Dans son rapport de 2012, la Commission pour la transparence de la vie publique relève le problème posé en fin de mandat par les reliquats d’IRFM non remboursés par les députés, qui contribuent « à un enrichissement oscillant entre 1 400 euros et 200 000 euros[23] ». Une décision du 1er mars 2013 du Conseil constitutionnel précise un autre point délicat : l’IRFM ne peut être utilisée pour des frais de campagne. L’interdiction est réaffirmée quelques mois plus tard dans l’article 13 de la loi sur la transparence de la vie publique.
Face à ces abus d’usage fait des propositions minimales. Il écarte le système le plus évident du remboursement sur note de frais pratiqué dans l’administration et les entreprises[24]. Il n’envisage pas non plus la création d’une autorité extérieure indépendante sur le modèle britannique[25]. L’établissement d’une liste des dépenses légitimes lui semble aussi trop complexe à établir. Dans son rapport pour 2003, il se contente de proposer l’adoption d’un guide fixant des règles de bon usage. Mais en 2014, le Bureau de l’Assemblée contredit son déontologue en fixant une série de règles précises. Il adopte en février 2015 un texte précisant cinq catégories de dépenses autorisées et exige le versement de l’indemnité sur un compte bancaire dédié[26]. Il instaure aussi une attestation sur l’honneur du bon usage de l’IRFM et prévoit en fin de mandat le reversement des sommes non utilisées[27].
Enfin, il précise que le solde du crédit pour le paiement des collaborateurs ne peut être transféré sur le compte de l’IRFM. Le rapport du déontologue de 2015 revient sur l’utilisation de cette indemnité qui dans certains cas fait toujours débat : achat d’un local pour la permanence parlementaire, subvention à des associations ou paiement des cotisations à un parti. Le rapport suivant (2016) indique sans plus de précision que, pour sa première année, la déclaration sur l’honneur de l’usage régulier de l’IRFM a donné satisfaction. Tous les problèmes ne sont pas réglés pour autant. En 2016, la HATVP pointe certains impacts favorables de l’IRFM sur la situation patrimoniale des députés, en particulier des placements financiers (SICAV) et certains usages personnels.
Rappelons que l’IRFM, à laquelle il faut associer une dotation matérielle des députés (DMD), ne concerne que les frais matériels d’exercice du mandat de député. La rémunération proprement dite est nommée « indemnité » et est composée de trois éléments[28] : l’indemnité de base (5 623,23 euros au 1er janvier 2019), l’indemnité de résidence (168,70 euros) et l’indemnité de fonction (1 447,98 euros), soit un montant brut mensuel de 7 239,91 euros[29]. Une estimation réalisée par le journal L’Express en décembre 2018 indique qu’une quinzaine de parlementaires ou ex-parlementaires seraient visés par des enquêtes préliminaires pour de possibles usages illicites de leur enveloppe de frais de mandat entre 2012 et 2017.
Ainsi, en six ans (2011-2017), les problèmes touchant à l’usage des fonds publics par l’Assemblée ont été peu à peu rendus visibles et en partie traités. Les déontologues ont joué un rôle important dans cette évolution. Pour autant, ils ne disposent d’aucun pouvoir normatif et ne sont que les conseils du Bureau. Ils sont tenus à la confidentialité et leurs rapports se limitent à des observations générales. Leur pouvoir de sanction est quant à lui dérisoire : comme l’indique l’article 5 du code de déontologie de l’Assemblée, ils ne peuvent que saisir le Bureau de l’Assemblée, demander une régularisation et informer le public…[30]
2017 : L’entrée en scène du politique
Le début de mandat de la nouvelle Assemblée est marqué par deux lois concomitantes que nous avons évoqué en introduction. Les textes, adoptés en Conseil des ministres le 14 juin 2017, soit un mois après l’élection présidentielle, le sont dans l’urgence, sans véritable préparation ni concertation, et restent lacunaires[31]. S’ils complètent la loi d’octobre 2013 « relative à la transparence de la vie publique », ils ne sont pas le fruit d’un travail pour identifier les manques que son application a pu révéler. Le candidat Emmanuel Macron n’avait pas été très explicite sur le sujet, excepté sur la question des emplois familiaux. François Bayrou avait fait de l’adoption d’une loi sur la moralisation l’une des conditions de son ralliement. Mais le contenu de ces notions n’avait jamais été explicité[32].
En ce qui concerne l’usage des fonds publics par le Parlement, les deux lois introduisent de nouvelles obligations mais, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, confient aux assemblées la fixation des modalités. Cinq jours après l’adoption des deux lois du 15 septembre, le Bureau de l’Assemblée crée sept groupes de travail pour répondre aux nouvelles exigences. Examinons les principales mesures que l’Assemblée nationale a finalement adoptées.
S’agissant de la régulation des conflits d’intérêts, le premier texte de la loi de 2017 introduit au nom des « incompatibilités » une série de règles précises concernant les activités cumulables avec la fonction de député. C’est un point très sensible car près de 25 % des parlementaires déclaraient en 2013 une activité parallèle d’avocat ou de conseil. L’article 8 précise que pour mener une activité de conseil, celle-ci doit avoir été amorcée douze mois avant le début de mandat. Il est en outre interdit de conseiller un certain nombre d’entreprises[33] ainsi que des organismes étrangers (articles 6 et 7), mais également d’avoir une activité de conseil à titre individuel (article 10). Mais selon l’article 3 du second texte de la loi, il revient à chaque assemblée de fixer, après consultation du déontologue, les règles de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. Entre autres, un registre public dit « de déport » doit enregistrer les cas où un élu « a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intérêts ».
En février 2018, le déontologue de l’Assemblée fait des propositions pour actualiser les mesures adoptées en 2011, mais son rapport est minimal : mise à jour du code de déontologie ; élargissement de la notion de conflit d’intérêts aux situations où l’influence serait apparente : mise en place du registre de déport[34]. Par ailleurs, d’importantes lacunes persistent dans le dispositif de contrôle des intérêts. Tout d’abord, le point crucial du temps consacré à une activité annexe, pas plus que le niveau de rémunération cumulable avec l’indemnité parlementaire, n’est abordé. Aucune limitation de temps ou de revenu n’est indiquée. Ce serait pourtant le meilleur moyen de s’assurer que l’activité parlementaire demeure bien la fonction principale[35]. Une nouvelle fois, les députés s’octroient un traitement dérogatoire. Pourquoi ne s’appliquent-ils pas le régime ordinaire de la fonction publique qui limite les montants et exige une autorisation préalable permettant de vérifier que cet emploi est compatible avec l’emploi principal ?
Plusieurs sites d’information ont analysé les déclarations d’intérêts des députés et sénateurs, et montré qu’au moins une quinzaine d’élus bénéficiaient de rémunérations complémentaires supérieures à celle de leur fonction principale, pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros annuels. Le problème principal est l’impact de ces emplois « secondaires » sur l’exercice du mandat d’élu. Les mêmes sources montrent que les élus les moins actifs dans les commissions et les assemblées sont souvent ceux qui mènent en parallèle une activité extérieure importante. Ainsi François Fillon, ancien Premier ministre, déjà fortement engagé dans des activités de conseil depuis 2012[36], n’a totalisé que 21 semaines par an en moyenne d’activité parlementaire. Deuxième lacune, le recrutement d’un assistant parlementaire par un groupe d’intérêts reste autorisé. Il doit simplement faire l’objet d’une déclaration au bureau de son assemblée par l’élu qui l’emploie. Là également, aucune limite n’est donnée ni sur le type d’activité complémentaire, ni sur le temps qui peut lui être consacré.
Un autre point marquant de la réforme de 2017 est la suppression de « l’indemnisation représentative de frais de mandat » sous sa forme forfaitaire (article 20, texte n° 2)[37]. Elle devient « une allocation de frais de mandat » (AFM) d’un montant de 5 373 euros. Son usage doit désormais être justifié de façon détaillée. La loi se montre souple dans la mesure où les défraiements sont possibles sous trois formes : prise en charge directe, remboursements sur justificatifs, versements d’avance, ces formes sont-elles cumulables[38] ? Le texte prévoit que le déontologue « contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge […] correspondent à des frais de mandat » (article 20, texte n° 2).
Mais à peine le principe posé, l’autorégulation reprend ses droits car il revient au bureau de chaque assemblée de définir « le régime de prise en charge des frais de mandat et d’arrêter la liste des frais éligibles ». Entre octobre 2017 et février 2018, le déontologue échange à cinq reprises avec le Bureau de l’Assemblée pour fixer des règles fixant les frais éligibles et leurs justificatifs. Un texte est finalement adopté en novembre 2017. Par souci pédagogique, l’arrêté distingue les dépenses non susceptibles d’être prises en charge (4 catégories) de celles qui peuvent l’être (8 catégories).
Le déontologue fait inscrire trois principes d’évidence : 1) les frais éligibles doivent avoir un lien direct avec l’exercice du mandat de député et sont indissociable de l’activité politique ; 2) la prise en charge des frais de mandat ne peut en aucun cas avoir pour effet d’augmenter le patrimoine personnel du député, de ses proches ou de ses collaborateurs ; 3) les frais de mandat doivent avoir un caractère raisonnable. Globalement, le déontologue juge sévèrement l’ensemble du dispositif. Ses avis sont confidentiels mais, en décembre 2017, une fuite permet d’avoir une idée de ses griefs[39]. Il estime que les mesures adoptées par le Bureau sont « très en deçà » de l’objectif de transparence et de moralisation de la vie publique. Les dépenses des élus ne pourront faire l’objet que d’« une vérification comptable partielle et imparfaite », et le dispositif retenu « ne permet[tra] pas au déontologue de contrôler que les dépenses des députés correspondent à des frais de mandat comme le prescrit la loi ».
De plus, il émet des critiques à propos de deux mesures adoptées par les députés. D’une part, ils ont accepté que l’AFM puisse prendre en charge la location de permanences électorales situées en dehors de la circonscription de l’élu – pratique difficile à justifier. D’autre part, des frais engagés par des collaborateurs bénévoles (transport, hébergement, repas) peuvent être pris en charge par l’AFM. Il y a pourtant là un risque de détournement de l’interdiction des emplois familiaux. De plus, ce type de relation, s’il est régulier, peut donner lieu à une requalification de la relation de travail en raison du lien de subordination établi.
Venons-en maintenant à un autre point délicat : la mise en œuvre des contrôles[40]. Afin de les faciliter, les justificatifs doivent être présentés selon un classement par catégories. Le recours à un expert-comptable est encouragé. Les vérifications sont réalisées en deux temps, par les services de l’Assemblée, puis, après le remboursement, par le déontologue. Les députés ont introduit plusieurs limites qui préservent leur pouvoir discrétionnaire. Tout d’abord, ils se sont accordé une somme hebdomadaire de 150 euros qui n’a pas à être justifiée et qui doit permettre de régler de menues dépenses liées à l’activité politique pour lesquelles les justificatifs sont difficiles à obtenir. Rien ne vient justifier cette indemnité et l’on se demande pourquoi la rémunération de l’élu ne peut couvrir ces frais.
Autre incongruité révélatrice des résistances au contrôle, les députés sont tenus de fournir les pièces justificatives de leurs dépenses, mais ils ont ajouté une curieuse restriction pour « les informations confidentielles couvertes par un secret couvert par la loi » (médical, défense, affaires). Le déontologue a fait remarquer, en vain, qu’il ne voyait pas comment de telles informations pouvaient concerner les frais d’exercice du mandat… Enfin, il est prévu qu’un contrôle approfondi soit effectué par le déontologue une fois par mandat de cinq ans. Le choix est effectué par tirage au sort. Seuls cent vingt députés par an sur cinq cent soixante-dix-sept sont concernés. C’est insuffisant pour le déontologue, car ceux contrôlés en début de mandat peuvent s’estimer quitte des obligations prévues pour les années suivantes. Finalement, ce dispositif soulève quelques interrogations : dans quelle mesure le déontologue dispose-t-il des moyens d’accomplir sa mission de contrôle et sur quoi débouchent les constats d’irrégularités ?
Débutée en février 2018, la mise en œuvre de ce contrôle a beaucoup accaparé le travail de la déontologue en 2019 et 2020[41]. Le démarrage a été entravé par un manque de moyens qui n’a été que tardivement comblé mais aussi, bien évidemment, par les résistances de certains élus. Un référentiel de contrôle a été mis au point en relation avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. L’Assemblée ayant refusé, à la différence du Sénat, l’utilisation d’une application informatique centralisée obligatoire, chaque député établit donc sa comptabilité à sa façon. Un logiciel est à disposition des parlementaires (JENJI) mais moins de 7 % l’utilisent. La première campagne menée en 2019 sur les dépenses de 2008 de 144 députés, est qualifiée par la déontologue de « chaotique ». L’appropriation des nouvelles règles a été difficile, la remise de dossiers incomplets comme les retards à les compléter révélaient de nombreuses réticences.
Le nombre d’erreurs constatées était très élevé : 118 dossiers sur 144 (82 %) présentaient au moins une méconnaissance des règles. 36 recours ont été effectués devant la déontologue, 8 auprès du Bureau. Les problèmes les plus fréquents concernaient les frais liés aux permanences, à l’hébergement, aux repas et aux déplacements et l’utilisation des 150 euros hebdomadaires dispensés de justification. La deuxième campagne de contrôle pour l’année 2019, qualifiée de « plus sereine », a été menée sur onze mois par une équipe renforcée (dix personnes).
Pour autant, les obligations n’ont pas été mieux respectées : 121 dossiers sur 145 (83,5 %) ont conduit à un remboursement ; 31 recours ont été formulés. Dans l’ensemble, le montant des remboursements demandés ne concerne que 2 % des sommes contrôlées, mais le rapport du déontologue reste très évasif sur les situations litigieuses. IL souligne la complexité du système d’indemnisation qui combine trois procédures et diverses enveloppes de crédit s’ajoutant à l’AFM. En octobre 2020, le Bureau a refusé qu’un seul compte dédié les regroupe.
Une autre question mériterait d’être détaillée, celle des collaborateurs parlementaires[42]. La fragilité de leur statut facilite d’abord les conflits d’intérêts potentiels dans la mesure où plus du tiers d’entre eux travaille à temps partiel et que rien ne leur interdit d’être recruté par un groupe d’intérêts ou une agence de conseil. Ensuite, jusqu’en 2014 les élus pouvaient utiliser une partie de leur « crédit collaborateur » comme complément de leurs frais de mandat. Ces possibles mélanges des genres devaient être cadrés par un code de déontologie annoncé en 2013… mais toujours inabouti.
On le constate à lire les rapports des déontologues successifs, l’effort de plus grande transparence dans l’usage des fonds publics est régulièrement contrebalancé par le maintien de pratiques discrétionnaires et par des résistances aux nouvelles règles. Cependant, les principales observations concernent des erreurs d’interprétation de textes. Aucune faute grave susceptible de justifier une sanction disciplinaire n’a été relevée. Dans cette phase de rodage, le déontologue s’est sans doute voulu plus pédagogue que juge. La HATVP s’est montrée plus sévère en signalant au parquet national financier une vingtaine de cas de détournement d’IRFM[43] et de défaut de déclaration d’intérêts. Mais le PNF, à son tour, a écarté le souci d’exemplarité, il a classé sans suite en septembre 2021 9 procédures en raison du remboursement des sommes en litige. 3 autres procédures sont en cours de traitement.
Après deux siècles de laisser-faire, l’usage des fonds publics par les élus nationaux a commencé à être règlementé. Mais ces avancées perdent en partie de leur force lorsque l’on s’attache à leur champ d’application et aux conditions de leur mise en œuvre. Ce qui est en cause c’est le contrôle de l’autorégulation parlementaire, longtemps laxiste : jusqu’à quel degré a-t-il été renforcé ? Les élus se montrent-ils moins tolérants aux transgressions de leurs pairs, ou se contentent-ils comme avant d’une réprobation muette ? Les règles ont évolué, mais cette autorégulation demeure encore lacunaire[44].
Depuis 2017, l’attitude de la nouvelle majorité si soucieuse de rénovation, dont nombre de représentants viennent du secteur privé, n’a pas radicalement stoppé l’appétence des parlementaires pour l’autorégulation. Certes celle-ci s’est manifestée à la marge mais elle s’est manifestée sur chacun des grands enjeux identifiés : maintien du cumul d’emploi, justification limitée de certains frais de mandat, de la maîtrise individuelle sur les collaborateurs, du jeu avec les zones grises de la règlementation, du refus d’un contrôle des dépenses extérieur totalement indépendant, etc. Un événement symptomatique est intervenu en novembre 2020. Le déontologue, professeur de droit public, nommée en 2017, a démissionné pour des raisons professionnelles[45]. Il restait alors un an et demi de mandat à exécuter, et le Bureau de l’Assemblée prétend avoir eu du mal à trouver un successeur pour une durée aussi courte.
Il a décidé finalement de nommer un haut fonctionnaire maison. Selon les règles de l’Assemblée fixées en 2011, il est prévu que le déontologue soit une « personnalité indépendante »[46]. Or, dans le cas présent, l’impétrant est un fonctionnaire de l’Assemblée, de plus secrétaire général de la questure… Peu y ont trouvé à redire, tant il est vrai qu’on n’est jamais mieux contrôlé que par les siens. Un ancien déontologue de l’Assemblée déclare « “C’est un mauvais signal. Un contrôle efficace ne peut qu’être extérieur, souligne Ferdinand Melin-Soucramanien, professeur de droit. Lorsque l’on est du sérail, on peut être porté à avoir un regard complaisant sur les pratiques des députés”[47]. Enfin, parmi les facteurs d’évolution possibles, notons que René Dosière a assuré sa succession : ils sont aujourd’hui neuf parlementaires (députés, sénateurs, députés européens) à faire partie de son Observatoire de l’éthique publique et à poursuivre le travail en faveur de la transparence de la vie publique[48].
Le chantier est loin d’être clos. Tout d’abord, les questions que nous avons analysées au niveau national devraient l’être de la même façon au niveau des collectivités locales où les règles sont moins précises ou absentes. Ensuite, au niveau national, d’autres enjeux méritent la même attention : le financement public et privé des partis, celui des diverses campagnes électorales[49], le cumul des mandats et des fonctions, le pantouflage en fin de mandat.
Certains élus considèrent que leur engagement au nom de l’intérêt général devrait les dispenser du respect des règles communes ou leur accorder des avantages particuliers. L’introduction de règles de fonctionnement s’est faite de façon très progressive et souvent beaucoup plus sous l’influence de facteurs externes, les déontologues et la HATVP que par une mobilisation interne. Cet attachement à l’autorégulation est révélateur des limites de la conscience civique et de l’économie morale des élites politiques.
