Du redoublement et de ses effets
Après l’annonce par le ministre, Gabriel Attal, de son intention de lever le « tabou » du redoublement, de nombreux médias ont relayé divers commentaires et évaluations de ce dispositif. Il se trouve que le redoublement est notre objet de recherche. Nous avons donc suivi avec attention les réactions dans le milieu éducatif. Nous observons que les prises de paroles et tribunes à ce sujet propagent pas mal d’idées reçues. Nous proposons de faire le point à propos de quelques idées reçues qui circulent en ce moment et permettent de répondre aux principales questions que se posent les personnes qui s’interrogent à ce propos.
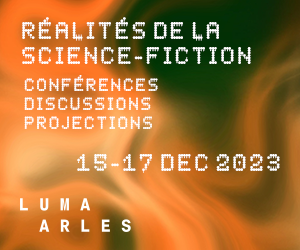
Notre intention n’est nullement de soutenir une politique pro-redoublement. Il s’agit de dépasser la doxa sur ce sujet et la vision binaire (pour ou contre le redoublement) pour montrer qu’il s’agit d’une question plus complexe et nuancée qu’on ne le croit et d’établir les conditions d’un débat politique correctement informé. Car nombreux sont ceux qui, retranchés dans leurs certitudes sur le sujet, entendent confisquer le débat en faisant dire aux recherches sur le redoublement ce qu’elles ne permettent pas d’affirmer.
Inefficacité du redoublement ? Des résultats équivoques…
D’abord, et il est important de commencer par là. L’idée que toutes les recherches en éducation sont convergentes et que la pratique du redoublement est inefficace… est en fait erronée[1]. Plus précisément, on ne peut pas démontrer scientifiquement que le redoublement est négatif[2], et surtout qu’il vaut mieux faire passer automatiquement dans le niveau supérieur plutôt que de faire redoubler !
Une lecture attentive de la littérature montre que les conclusions qui aboutissent à la dénonciation pédagogique du redoublement sont fondées sur des études méthodologiquement fragiles[3] et des méta-analyses qui tendent à occulter les débats au sein de la communauté scientifique sur les effets du redoublement[4]. Les résultats des recherches récentes qui utilisent des méthodologies plus sophistiquées montrent que les études antérieures ont sous-estimé les effets positifs du redoublement[5].
D’autres critiques précisent que, oui le redoublement a des effets positifs… mais seulement à court terme. Des travaux cherchent en effet à évaluer les effets du redoublement après 3, 5 voire plus de 10 ans[6]. En réalité, les critères qu’une grande partie de la littérature quantitative sur le sujet utilise pour juger de l’effet d’un redoublement sont tellement restrictifs qu’il semble quasiment impossible qu’il soit jugé autrement que négativement[7].
À suivre certains chercheurs, il faudrait que les élèves retenus obtiennent à long terme des scores non pas seulement identiques mais plus élevés que leurs pairs qui n’ont jamais redoublé. Par ailleurs, ces objectifs sont bien complexes à atteindre sur le terrain : comment demander aux équipes d’enseignants qu’elles visent autre chose que la réussite d’un cycle ou de l’année supérieure lorsqu’elles attribuent un redoublement ?
Le redoublement une mesure négative pour l’élève ?
Le redoublement est fréquemment accusé d’humilier les élèves. Des recherches ont montré que les élèves qui redoublent sont généralement caractérisés par une faible estime de soi scolaire, ils peuvent également souffrir de mise à l’écart étant donné que le redoublement les isole de leur groupe de pairs. Cependant, les recherches concernant les effets psychologiques du redoublement souffrent, comme celles portant sur les performances des élèves redoubleurs, de problèmes méthodologiques et ne sont pas du tout unilatérales, contrairement à ce que l’on entend parfois.
Le problème de ces recherches est qu’elles étudient typiquement les redoublants après que le redoublement ait eu lieu. Elles prennent rarement la peine d’étudier le rapport à soi et à l’école avant, pendant et après le redoublement. Il est donc impossible de savoir si c’est à cause du redoublement que les élèves concernés manquent de motivation et n’aiment pas l’école ou bien s’ils étaient déjà démotivés et n’aimaient déjà pas l’école avant de doubler[8].
Les études les plus solides, qui utilisent des designs longitudinaux, concluent à l’absence d’effets psychologiques négatifs du redoublement[9], voire mettent en évidence des effets positifs.
Les attitudes des élèves à propos d’eux-mêmes et de l’école s’améliorent après le redoublement indiquent Alexander et ses collègues[10], en particulier l’année du redoublement étant donné que les élèves constatent que leurs performances s’améliorent, à la fois relativement, c’est-à-dire lorsqu’ils se comparent à leurs camarades de classe, et dans l’absolu, lorsqu’ils considèrent leur propre statut antérieur. Vandecandelaere et ses collègues (2015) soulignent qu’il vaut mieux intervenir précocement pour éviter échec et frustration ultérieure, sachant que les élèves promus malgré des difficultés scolaires sont plus susceptibles de souffrir d’expériences répétées d’échec scolaire.
Rétrospectivement les élèves qui ont redoublé au cours de leur scolarité sont majoritaires à porter un regard plutôt positif sur cette expérience. En 2015, une étude du CNESCO[11] révélait que 80 % d’entre eux voient dans le redoublement une seconde chance. En outre, 67 % des redoublants déclarent s’être plus investis dans leur travail l’année de leur redoublement ; 71 % des lycéens et collégiens sont tout à fait ou plutôt d’accord avec l’affirmation : « J’ai eu de meilleurs résultats l’année redoublée ». Se pourrait-il que toutes ces personnes se trompent sur l’effet que le redoublement a eu sur leur trajectoire ? Certes cela reste leur opinion et, en tant que tel, du domaine de l’effet subjectif et non objectif (mais nous avons vu combien les critères de ce dernier étaient restrictif).
Les connaissances qualitatives sur le redoublement
En ce qui nous concerne, nous pensons que des méthodologies qualitatives peuvent éclairer sous un jour nouveau les résultats contradictoires observés dans la littérature quantitative que le raffinement et la sophistication des techniques ne permettent pas toujours de lever. Par ailleurs, il y a tout lieu de penser que, sans une connaissance précise des conditions amenant un redoublement à produire des effets positifs ou négatifs, les politiques éducatives visant à restreindre son usage ne pourront rester que déconnectées des réalités du terrain et perdre en légitimité[12]. C’est pourquoi nous présentons ci-dessous quelques premiers résultats qui ressortent de nos recherches en cours[13].
En premier lieu, nos travaux portant sur des conseils de classe, des entretiens avec des enseignants et des élèves montrent qu’un premier indicateur commun est celui du « déclic ». Les enseignants et les élèves parlent fréquemment du déclic qui a eu lieu pour témoigner d’un redoublement qui produit ses fruits, et à l’inverse l’expression peut être employée pour décrire un élève qui ne bénéficie pas de son redoublement, c’est le déclic qu’on attend, celui qui ne s’est pas (encore) produit. En prenant au sérieux ce discours, il est clair que les élèves témoignent d’un changement dans leur rapport à l’école. Les enseignants attendent aussi d’observer de la part des élèves de nouveaux comportements qui témoignent qu’ils ont modifié leur manière d’appréhender l’école, leur rapport à la scolarité et au travail scolaire.
Cette notion permet de comprendre que les différents partenaires éducatifs s’accordent parfois sur l’objectif et le sens du redoublement[14]. Il arrive régulièrement que pour l’élève comme pour ses parents et pour les professeurs, l’objectif soit le même. Cette compréhension partagée nous semble un levier important pour favoriser un travail en commun autour des bénéfices à retirer de cette année. Pour aller plus loin, tous les élèves rencontrés témoignent de la nécessité qu’ils acceptent et comprennent l’intérêt de la décision du conseil de classe. Les propositions qu’ils font sont nombreuses, mais elles relèvent toutes d’un moment de concertation avec les enseignants où les motivations de leur redoublement leur seraient expliquées, et où ils pourraient eux-mêmes faire valoir leur expérience, leur point de vue.
Les élèves et leurs parents ont besoin de sentir que la décision est ajustée à une situation singulière, et qu’il ne s’agit pas d’une décision globale fondée sur des effets moyens, peu pertinente au cas par cas. À ce titre, décider d’une promotion automatique généralisée, sans autre forme de remédiation ou de soutien, est aussi perçue – y compris par les premiers intéressés – comme une forme de laxisme de l’institution qui laisse à leur sort des élèves en échec scolaire. Au lieu de cela, il paraît judicieux de laisser les équipes éducatives décider, avec un certain contrôle, du redoublement de leurs élèves, et de les laisser suivre ces mêmes élèves l’année suivante. Cela permettrait de remettre la question de l’échec scolaire et des moyens d’y remédier au cœur des prérogatives et des responsabilités des équipes éducatives.
L’équipe pédagogique semble en effet la mieux placée pour prendre la décision et estimer l’utilité du redoublement pour un élève donné ou pour penser les conditions à assortir à la promotion ou au redoublement pour qu’elles aient le plus de chances de porter leur fruit. Le rôle du régulateur nous paraît alors de prendre des dispositions qui permettent de s’assurer que la décision de redoublement ne soit pas prise à la légère mais soit discutée, concertée en équipe, pensée en fonction du profil de l’élève et du bilan de ses difficultés, et que des alternatives soient envisagées et proposées à la famille ainsi qu’à l’élève au préalable.
C’est à ce titre qu’il nous semble important de pouvoir davantage susciter un travail au cas par cas des redoublements. En effet, nos observations de conseil de classe montrent que les équipes singularisent leurs décisions, et que le redoublement est très loin d’une mesure administrative venant entériner une note moyenne obtenue à la fin du mois de juin.
Au-delà de la communication et de la discussion sur le sens du redoublement entre l’élève, la famille et les professeurs lorsque la décision est prise, il nous semble important de poursuivre ce travail d’individualisation au travers du suivi des efforts produits par chaque élève à la rentrée. En entretiens, tous les jeunes rencontrés disent combien il est important pour eux de sentir que les professeurs voient les progrès obtenus et les efforts déployés. C’est tout l’intérêt d’un suivi pédagogique individualisé qui compare l’élève à lui-même.
Ceci suggère aussi que c’est la qualité des redoublements et non leur quantité (les seuls taux de redoublement) qui devraient focaliser l’attention des autorités éducatives et des pédagogues. Que le ministère souligne que « ni la promotion systématique en classe supérieure ni le redoublement massif ne représentent une solution satisfaisante »[15] nous paraît donc plutôt un bon signal.
Le redoublement, une question politique
Dans les débats, il est de coutume de considérer que le redoublement est une politique de droite. C’est vrai que nos travaux[16] montrent qu’au centre et à gauche, les critiques sont nombreuses sur le redoublement. Mais pour quels motifs ? D’abord et avant tout des inégalités sociales, de la souffrance des élèves, mais aussi d’un manque de connaissance scientifique et de compétence pédagogique des enseignants (cet argument est souvent utilisé pour soutenir des politiques visant à encadrer et contrôler les pratiques enseignantes). À droite, on évoque les lacunes, l’importance d’acquérir les bases : bref, on parle du niveau à atteindre pour préserver un enseignement de qualité, de « vrais » diplômes qui certifient des compétences réellement atteintes.
En fait, ce que nous voyons c’est que le débat sur la suspension du redoublement exprime le sens et les valeurs d’un certain type d’école, en l’occurrence une conception méritocratique de l’école[17]. Le redoublement est en effet solidaire de l’idée que l’école est un lieu où la réussite scolaire ne se donne pas mais s’acquiert par le travail. Cette valorisation du travail scolaire est d’ailleurs fortement intériorisée par les élèves eux-mêmes. De sorte que l’on peut parler d’un contrat moral tacite que l’institution noue traditionnellement avec les élèves.
Une « fonction latente » du redoublement[18] est ainsi de faire en sorte que ce contrat soit pris au sérieux par les élèves et de garantir, au moins formellement, que des conséquences en résulteront si les élèves ne le respectent pas. C’est pourquoi le passage automatique de classe est autant critiqué par les acteurs scolaires et pose énormément de difficultés sur le terrain : l’hétérogénéité des classes augmente, les élèves rechignent à s’investir dans les apprentissages, l’ordre scolaire est plus difficile à réguler.
Les fonctions latentes jouées par le redoublement, telle cette fonction morale évoquée, ne doivent pas être sous-estimées. Comment faire en sorte de mobiliser les élèves dans leurs apprentissages sans recourir au redoublement ? Telle est la difficulté à laquelle se confrontent nombre d’enseignants lorsque la possibilité de faire redoubler un élève leur est retirée. Ce n’est pas parce que le redoublement joue habituellement ce rôle qu’il est irremplaçable. Mais quel que soit le système mis en place, redoublement ou promotion automatique, il importe de tenir compte de cette fonction morale que remplit traditionnellement le redoublement afin que l’école trouve un moyen de mobiliser les élèves et de leur tenir un discours vrai sur leurs connaissances et compétences scolaires[19].
Remplacer le redoublement par le passage (ou la promotion) automatique d’une classe à la suivante revient ainsi à mettre en cause un ordre scolaire établi reposant sur le modèle de « l’égalité méritocratique des chances », modèle de justice dominant dans les sociétés démocratiques[20]. Or, on fait trop souvent comme si le redoublement était une pratique qui pouvait être supprimée sans guère de conséquences autres que positives pour les élèves concernés et pour le système éducatif puisqu’en le supprimant on réduit l’échec et les coûts économiques associés à l’allongement des parcours. En réalité, la suppression du redoublement revient à dissocier la réussite et le travail scolaire : l’école sans redoublement n’est plus une école où l’élève doit réussir pour avancer, ce qui impliquait généralement pour l’élève de faire la preuve qu’il avait fourni des efforts pour répondre aux attentes scolaires.
Privilégier le passage automatique de classe peut parfaitement se défendre, mais au nom d’une certaine conception de l’école et de son rôle dans la société, pas au nom de la prétendue inefficacité du redoublement. Autrement dit, la définition d’une ligne politique en la matière doit demeurer un choix idéologique plutôt que de se prévaloir de la science. Le débat sur les finalités doit rester politique.
La logique méritocratique n’est plus celle qui prévaut dans les référentiels et dans les discours des experts qui inspirent les politiques éducatives. Cependant, sur le terrain, une majorité d’enseignants, ainsi qu’une partie des familles et des élèves, restent attachés à cette logique et au contrat moral tacite qui associe travail et réussite scolaire. C’est sans doute cela que Gabriel Attal avait en tête lorsqu’il déclarait vouloir lever le « tabou » du redoublement.
