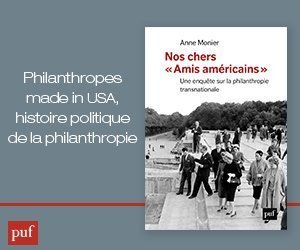La plainte et la grâce
Les images et les propos ont été relayés largement, par la presse écrite, les télévisions et les radios, mais plus encore par les réseaux sociaux. On aperçoit des responsables politiques de premier plan – le président, un ministre, une secrétaire d’État – répondre en direct et dans une forme très libre, presque familière, à des sollicitations souvent poignantes d’hommes et de femmes anonymes, qui font part de leur détresse, de leurs souffrances et de leurs peurs et qui s’adressent directement, comme en dernier recours, à la personne qui symbolise à leurs yeux le pouvoir et en tout cas le pouvoir de changer leur vie. D’elle, ces acteurs soudain et brièvement au centre de l’attention attendent en effet une intervention urgente, directe, efficace, qui court-circuiterait les règles administratives et les lenteurs bureaucratiques dans lesquelles ils se sentent englués et oubliés.
Au Salon de l’Agriculture, en février 2019, un retraité handicapé en larmes fit ainsi part de sa détresse financière au président de la République qui le prit un instant dans ses bras et le rassura : « gardez le moral, vous avez le droit à plus que ce vous touchez (…) On va faire le maximum ». Quelques semaines plus tôt, la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations avait elle aussi fait part de son émotion devant le sort d’une jeune femme, défenestrée par son ancien compagnon et restée tétraplégique, à laquelle le fond de garantie des victimes avait refusée une prise en charge complète. Dans la foulée, la secrétaire d’État s’était dite prête à « intervenir personnellement dans ce dossier ».
On pourrait multiplier les exemples – le futur président interpellé par une femme surendettée (octobre 2016), le président sollicité par la victime d’un harcèlement scolaire (février 2019) – sans que les traits distinctifs de ces événements présentent de grande différences : on y observe toujours la combinaison très puissante de l’émotion et de la médiatisation mais aussi, toujours, l’extrême personnalisation, des appels au secours et des promesses d’aide qui y sont échangés. Les victimes s’adressent personnellement à celui ou à celle dont ils attendent un secours, mettant en œuvre un registre de paroles, de gestes, de postures très précis, qui garantit à leurs yeux l’efficacité ou la recevabilité de leur appel dramatique.
Les récits de ces hommes et femmes viennent ainsi continuer la trame d’un récit d’État et contribuer au storytelling officiel.
Conformément à ce que Luc Boltanski avait décrit dans un texte fondateur sur le courrier des lecteurs du journal Le Monde au début des années 1980, et plus récemment Julien Frétel et Michel Offerlé dans une précédente livraison d’AOC à propos des lettres envoyées à la présidence de la République, la singularisation du récit, ou plus exactement de la plainte, joue un rôle essentiel. Les protagonistes de ces drames intimes offerts un instant à la vue de tous racontent leur vie et expliquent la situation inextricable et invivable dans laquelle ils se trouvent, produisant même des documents administratifs qui en attestent la véracité et l’implacabilité. Le président, le ou la ministre, le ou la secrétaire d’État savent ainsi tout ce qu’il faut savoir de l’injustice faite à cet homme-là ou à cette femme-là. Leurs récits viennent ainsi continuer la trame d’un récit d’État et contribuer au storytelling officiel.
Aussi surprenants soient-ils, ces brefs temps de dévoilement et de plainte n’ont rien d’inédit. Il serait en tout cas erroné de vouloir les expliquer et d’en réduire la portée par les dérives de la communication politique, par les ruses des spins-doctors ou par la fascination supposée des médias pour les histoires vraies des vrais gens, les anecdotes qui font comprendre des problèmes trop compliqués pour des sujets de quelques dizaines de lignes ou de secondes. Certes, de tels calculs existent sans doute, mais ils ne permettent pas de comprendre ce qui se joue exactement dans ces plaintes et ces vies malmenées soudainement exposées au grand jour, ni dans les réponses qui leur sont apportées par des politiques parfois manifestement pris au dépourvu par ces instants dramatiques.
Il faut donc peut-être s’obliger à un bref détour historique, pour rappeler l’importance d’autres adresses au détenteur du pouvoir, qu’il s’agisse d’un roi, d’un prince, de l’Empereur, qui fonctionnèrent durablement au cours du Moyen Âge et de l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles). Car à côté des adresses collectives, des pétitions, des Gravamina que les territoires du Saint-Empire romain de Nation Germanique adressaient à l’Empereur ou à des princes de moindre importance, des cahiers de doléances qui accompagnèrent la convocation des États-Généraux à partir de la fin du Moyen Âge et qui ont connu un regain d’intérêt au cours des derniers mois à la faveur du mouvement dit des Gilets Jaunes, des requêtes personnelles au souverain ont existé : dans un très grand nombre de cas et dans des formes très proches des épisodes contemporains, elles étaient elles aussi des expressions de la souffrance personnelle et des demandes de justice.
Ces demandes, directement adressées au souverain qui se multiplièrent à partir de la fin du Moyen Âge, portaient sur des affaires judiciaires et des procès ; elles étaient avant tout des suppliques qui avaient pour objectif d’obtenir du souverain qu’il exerce ce qu’il était convenu d’appeler sa justice retenue et qu’il suspende les procédures en cours et accorde son pardon. Il n’y était donc pas question, du moins directement, du malheur des temps, de la maladie et du handicap, de la pauvreté, mais essentiellement de crimes et de délits. C’est un point essentiel.
Mais pour sauver leur vie, ceux qui s’adressaient au prince faisaient eux aussi le choix d’évoquer leur sort aussi précisément que possible, de mettre en récit leur situation et leur désespoir, de rappeler preuves à l’appui l’enchainement des faits qui les avait conduit à ne plus avoir d’espoir que dans l’intervention du souverain par-delà les lois et les juridictions ordinaires. La Chancellerie royale examinait ces demandes, vérifiait l’exactitude des faits et décidait ou non d’y apporter une réponse favorable sous la forme d’une lettre de rémission, qui stoppait les procédures en cours.
Se voir octroyer une grâce ou une aide inespérée et presque providentielle n’est pas la même chose qu’avoir des droits.
Des dizaines de milliers de lettres de rémission nous sont parvenues, qui ont fait l’objet d’enquêtes historiques célèbres sous la plume de Claude Gauvard ou Natalie Davis (Pour sauver sa vie. Récits de pardon au XVIe siècle, 1993). Elles montrent que dans ces affaires à la fois banales et inextricables, les auteurs des plaintes ne voient de solution que dans une grâce, celle que le souverain seul peut accorder. La plainte, la demande de pardon, la description intime de la souffrance et de la faute rendent possible, voire nécessaire, l’intervention directe du souverain, qui pouvait ici témoigner de sa compassion et rappeler la dimension sacrée de son pouvoir. L’octroi de la grâce s’apparentait, par certains côtés, à un miracle, comparable à d’autres manifestations de la sacralité royale comme le toucher des écrouelles, même si, au fil du temps, cette dimension religieuse du pardon s’estompa, laissant davantage de place aux préoccupations terrestres et à la bureaucratie de la monarchie administrative.
La similitude des mises en récit de la souffrance personnelle et de la demande de justice anciennes et contemporaines s’arrête pourtant là : les personnes qui se tournent vers le président, l’un ou l’une des ses ministres ou secrétaires d’État ne font pas allusion à des procédures judiciaires dans lesquelles elles auraient été reconnues coupables ; elles ne demandent pas à bénéficier de la grâce présidentielle ; aucune n’attend quelque chose comme un pardon, puisqu’elles sont avant tout des victimes.
C’est peut-être, justement, la raison de l’embarras que l’on peut parfois ressentir devant le réveil de formes un peu trop appuyées et trop mises en scène d’intervention directe des détenteurs d’autorité dans les malheurs ordinaires des hommes dont on a donné quelques exemples plus haut. Il y a à cette gêne – qui ne vient en rien des efforts déployés par les victimes pour obtenir reconnaissance de leur souffrance mais bien de la réponse politique qui leur est apportée – deux raisons.
D’une part, se voir octroyer une grâce ou une aide inespérée et presque providentielle n’est pas la même chose qu’avoir des droits, garantis, offerts à tous, exigibles par chacun et en toute occasion. On peut légitimement penser que le sort des retraités les plus modestes ou des personnes en situation de handicap, qui ont vu leur situation se détériorer, vaut mieux qu’un geste personnel, aussi précieux soit-il pour celui ou celle qui en bénéficie. L’exposition de l’émotion et de la commisération ne remplace pas la construction de politiques publiques justes, qui garantissent, notamment à travers les choix budgétaires, à tous des conditions de vie acceptables.
À l’évidence, il faut plus d’un moment d’intimité compassionnelle télévisée pour corriger les effets de choix budgétaires et fiscaux : les questions soulevées par les deux épisodes les plus marquants (le retraité ; la femme victime de violence) sont ici révélatrices, qui renvoient à quelques-uns des arbitrages très discutés de la seconde partie de l’année 2017, en matière de fiscalité des retraites (passage de la CSG de 6,6 % à 8,3 % pour les retraités au 1er janvier 2018) ou du budget du secrétariat d’État à l’égalité femmes-hommes (budget en forte baisse).
Ces interventions personnelles, par delà les corps intermédiaires illustrent la fatigue des rouages démocratiques.
On peut, d’autre part, rappeler que les différentes adresses au souverain propres aux sociétés d’Ancien Régime prenaient leur sens dans des formes très particulières d’organisation des pouvoirs, antérieures à la naissance des régimes représentatifs modernes. Les Diètes d’Empire ou les États Généraux n’étaient pas des institutions représentatives au sens où nous entendons cette expressions aujourd’hui : elles n’émanaient pas d’un peuple considéré comme souverain, ne se réunissaient pas à dates fixes et librement (les États-Généraux en France ne sont pas réunis entre 1614 et 1789), ne détenaient pas de pouvoir législatif à proprement parler… Les adresses remplissaient dans ce cadre des fonctions précises de consultation et de fabrique du consentement.
Il n’est donc pas totalement absurde de penser que ces formes ne peuvent avoir le même sens dans des régimes démocratiques marqués par des élections régulières et compétitives, la séparation des pouvoirs, l’existence de corps intermédiaires puissants, la liberté de la presse et d’association. La détresse individuelle, la souffrance des plus démunis ne devraient-elles pas être prises en charge par des institutions, des partis ou des associations, trouver des relais collectifs capables de les faire entendre et de forcer la recherche de solutions valables pour tous ceux qui sont dans des situations comparables ?
À leur façon, les brèves dramaturgies de la découverte de la souffrance des victimes par les membres du pouvoir exécutif et les promesses d’intervention personnelles par delà, justement, les institutions et les corps intermédiaires inquiètent. Elles illustrent la fatigue des rouages démocratiques et des acteurs collectifs, la pulvérisation des situations qui semblent déjouer toute parole commune et toute mobilisation, l’inefficacité des relais à travers lesquels les citoyens peuvent ordinairement exprimer leurs attentes et leurs demandes et, plus profondément, leur désillusion qui les conduit à ne chercher de remède à leurs drames que dans un miracle : croiser, un jour, le chemin du président, du ministre, du secrétaire d’État et que la dureté, voire l’horreur, de leur sort émeuve au point de mériter quelques minutes d’attention médiatique. Ceux qui ne seront pas miraculés attendront des jours meilleurs.