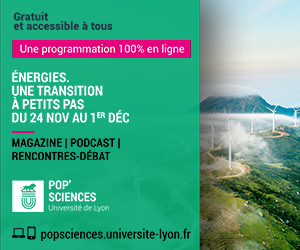Professer le faux : il faut brûler l’histoire coloniale – sur le postcolonial (2/3)
Ce qui est en débat, ici, face à la tribune « Les bonimenteurs du postcolonial business en quête de respectabilité académique » publiée dans L’Express, signée par Laurent Bouvet, Pierre-André Taguieff et d’autres, c’est le jeu constant entre le vrai et le faux que pratiquent les six auteurs pour dénigrer les études postcoloniales, leur dénier toute légitimité scientifique et les amalgamer à l’engagement militant des « décoloniaux ». En gros, pour prétendre qu’il ne faut surtout pas regarder en face le passé colonial et pronostiquer que ce passé est dangereux pour cette « jeunesse » issue des immigrations de l’ex-empire.
Pour avoir raison sur le fond, on manipule la forme, on mélange les sujets et on attaque les personnes, dans la pure tradition du maccarthysme. Les attaques personnelles contre des chercheurs, sans tenir compte des effets sur leurs vies privée et professionnelle, d’une violence indigne ? Aucune importance à leurs yeux, l’important c’est de dénigrer ceux qui veulent regarder autrement le passé colonial et accompagner la République dans ce travail de construction d’un récit commun. L’utilisation de faux et de textes polémiques comme des preuves ? Qu’importe.
En fin de compte, se pose une série de questions face à de telles méthodes. A-t-on le droit de falsifier la vérité pour défendre ses idées ? A-t-on le droit de s’attaquer à une personne, à son travail, à son parcours, à sa carrière pour le décrédibiliser et en fin de compte le marginaliser socialement, intellectuellement et universitairement ? Cette violence est-elle acceptable au nom du débat d’idée ? Elle ne l’est pas pour nous, sans doute parce que nous n’avons jamais, en trente ans d’engagements scientifiques, vu de telles attaques envers des universitaires. Mais cette méthode semble opportune aux signataires.
Habituellement, ceux qui sont visés décident de se taire, pétrifiés par de telles attaques, espérant pieusement qu’elles s’éteindront d’elles-mêmes. Notre choix est différent. Nous refusons leurs oukazes, leurs méthodes, dignes des plus grandes heures de la chasse aux sorcières aux États-Unis ou des procès de l’Inquisition. Nous ne voulons pas que notre travail sur le passé colonial soit réduit à de telles polémiques ou à de telles caricatures. Il est donc essentiel de dénoncer de telles pratiques…
De manière ironique, l’article d’Amandine Hirou dans L’Express – qui a servi de rampe de lancement pour la tribune – et la tribune s’inscrivent dans le « nouvel Express » que viennent de lancer en fanfare Alain Weil et Éric Chol dans leur édito commun de la nouvelle maquette. L’article est d’ailleurs annoncé dans un bandeau sur tous les kiosques de France et de Navarre[1]. Le PDG et directeur de la rédaction prétendent se placer dans une fidélité à Jean-Jacques Servan-Schreiber (un des symboles de l’anticolonialisme à une époque où il était bien difficile d’affirmer cette position…), de « dire la vérité telle que nous la voyons ».
Soyons honnêtes, avec une telle « enquête » et une telle « tribune » on est bien loin de la vérité… et JJSS (Jean-Jacques Servan-Schreiber) doit se retourner dans sa tombe en voyant de tels héritiers et de telles héritières, dans les colonnes de ce qui fut un grand journal contre la guerre d’Algérie. Et, de toute évidence, les auteurs attaqués vont attendre longtemps un droit de réponse dans les colonnes de L’Express (après avoir été interviewé par la journaliste de L’Express, Nicolas Bancel en a fait la demande plusieurs fois, sans obtenir aucune réponse). Preuve, là aussi, d’une déontologie qui n’est plus dans la tradition de l’hebdomadaire.
Mais cela, c’est une autre histoire, une autre époque, et désormais seule prime la volonté de blesser et de travestir la vérité pour atteindre ses buts. Seuls comptent les abonnements à trouver, et la prise en considération d’un lectorat qui bascule de plus en plus dans la peur de l’autre, de l’islam ou la hantise de la « repentance coloniale ». Pour répondre à ces objectifs, tout semble désormais permis. Terrible héritage pour JJSS !
Des preuves introuvables
Suivons la méthode de nos pamphlétaires. En premier lieu, on s’attaque à un livre et à un colloque, tenu le 3 décembre 2019 au CNAM (sur le thème des sexualités dans les espaces coloniaux). Précisons qu’aucun des signataires n’était présent et que, sans la journaliste de L’Express, ils n’en auraient jamais eu connaissance. Puis, on s’attaque à des chercheurs, comme Olivier Le Cour Grandmaison et Françoise Vergès. Petite précision : Françoise Vergès n’était ni au colloque que les auteurs de la tribune dénoncent et critiquent, ni dans l’ouvrage de CNRS Éditions en lien avec ce colloque, Sexualités, identités & corps colonisés (avec une postface de Leïla Slimani), attaqué également par les auteurs de la tribune.
Pour les cosignataires, l’ouvrage publié par CNRS Éditions n’est que « le miroir du gauchisme culturel décolonial… » Belle manière de résumer le travail de dix coordinateurs et coordinatrices de l’ouvrage, et celui des quarante contributeurs de l’ouvrage. Olivier Le Cour Grandmaison est, lui, présent dans le livre et est intervenu au colloque (comme dans l’un des cinq autres colloques précédents sur la question de la violence sexuelle aux colonies organisés depuis novembre 2018) et sa contribution a été exemplaire et renseignée pour comprendre les liens entre métissage, hygiénisme et colonialisme.
Il est ironique de voir des attaques contre un colloque dont ils ne savent rien, et qui a été soutenu par de nombreuses institutions, en partenariat avec la revue L’Histoire, et au sein duquel des chercheurs réputés comme Pascal Ory, Sophie Bessis ou Georges Vigarello sont intervenus. Mais qu’importe, il faut faire du bruit et hurler au scandale.
Au-delà des attaques contre les livres, les colloques et les chercheurs, on découvre les attaques contre le Groupe de recherche Achac, organisateur du colloque et partenaire de l’ouvrage publié par CNRS Éditions. Une règle d’or, toujours s’attaquer à un symbole. À cet égard, c’est l’un des co-directeurs de ce groupe de recherche qui est visé en premier lieu et doit être abattu (Pascal Blanchard, un des co-auteurs du présent texte). C’est, là aussi, assez logique puisque Pascal Blanchard est le porte-parole du Groupe de recherche Achac et sa figure médiatique depuis plus de vingt ans.
La machine est lancée, et il faut faire fort, comme avec l’affiche de la FCPE détournée récemment par Laurent Bouvet, qui y fait figurer de faux islamistes pour interdire aux mamans voilées les sorties scolaires. L’important est de faire du bruit, toujours. Et après les réactions contre ses provocations, Laurent Bouvet va bien entendu, une nouvelle fois, se plaindre qu’il est victime d’un « déchaînement » contre lui. Que les gens ne comprennent pas les « parodies » et que les « musulmans manquent d’humour ». Mais il est rodé. Il sait au fond qu’il peut faire mal, puisque pour lui c’est « celui qui crie le plus qui gagne » sur les réseaux sociaux (comme il le déclare au Monde dans un portrait qui lui est consacré par le quotidien). En outre, tout cela prépare la sortie de son livre en juin 2020 – Le péril identitaire –, dont le pitch résume la démarche de l’auteur : « Colonialisme, sexisme, racisme, islamophobie : pas une semaine ne passe sans qu’une polémique de nature identitaire ne vienne mettre en cause notre pays, ses institutions ou son histoire. […] C’est cette histoire que raconte Laurent Bouvet : elle naît en Europe, s’épanouit aux États-Unis et nous revient aujourd’hui, mettant en péril l’universalisme républicain. »
Pour poursuivre leur stigmatisation, les auteurs de la tribune présentent les auteurs du livre publié par CNRS Éditions comme les héritiers dévots de plusieurs fondateurs des études postcoloniales (Frantz Fanon, Aimé Césaire, Edward W. Said, Homi K. Bhabha, Gayatri Spivak…) qui adorent produire, selon eux, « à toutes les sauces » des « marchandises les plus diverses ». Il faut ensuite prouver que ce travail de recherche n’a pas de valeur. Les directeurs de publication du livre ne feraient donc pas de la recherche, ni même des livres, ou des colloques scientifiques. Non, ils fabriqueraient des « marchandises » affirment-ils. Comme les fondateurs des postcolonial studies : de simples marchandises écrites par Césaire, Spivak ou Fanon, auteurs que l’on peut certes critiquer, mais qui pèsent incommensurablement plus lourd que beaucoup d’autres chercheurs dans l’histoire des sciences sociales. Passons.
Enfin, les auteurs de la tribune nous assènent la « vérité » : « Tous les théoriciens du postcolonialisme postulent que, dans les sociétés postcoloniales, l’héritage du colonialisme, expression de la “domination blanche”, est à la fois vivant et structurant. » C’est, malheureusement, un peu plus complexe. Il est dommage qu’ils n’aient pas pris le temps de lire les articles de Jacques Pouchepadass (qui critique les études postcoloniales tout en analysant les apports de ce courant) ou un ouvrage récent publié par l’un des deux auteurs de ce texte[2], où justement sont expliquées les multiples interprétations qui traversent ce courant, beaucoup de chercheurs y critiquant d’ailleurs la systématicité d’une « théorie globale » qui ferait de la colonisation la matrice unique de notre contemporanéité. Les auteurs de la tribune auraient aussi découvert la critique des limites du postcolonialisme dans ses articulations avec d’autres courants – historiographiques notamment – qui infirment la caricature présentée dans leur tribune.
De même, entre autres affirmations sans nuance, les auteurs de la tribune présentent comme un dogme pour ceux qui travaillent dans une perspective postcoloniale « que les identités raciales sont placées au premier plan, marginalisant tous les autres aspects de la vie sociale et culturelle ». Eh bien non, pour de nombreux chercheurs proches de ce courant, c’est un des éléments de l’analyse, qui côtoie la question sociale (qui est pour nous essentielle), les dynamiques politiques, la multiplicité des appartenances, la question du genre, etc., que ces auteurs croisent dans une optique intersectionnelle.
Mais c’est là une question que les auteurs n’ont pas les moyens d’analyser par manque de références et de volonté, alors pourquoi s’embarrasser de nuances ? On met dans le même sac tous les chercheurs d’un courant pourtant extrêmement divers, et le tour est joué…
Pour finir, il ne reste plus qu’à tuer la bête immonde : « Les études postcoloniales forment ainsi une nébuleuse plutôt qu’une école de pensée ou un champ de recherches défini par sa méthodologie, sa conceptualité spécifique et un corps d’hypothèses. » Ils bricolent ces pauvres postcoloniaux, ils ne sont pas « scientifiques », n’ont pas de « méthodologie ». Paroles d’experts… À ce stade, il eut mieux valu reprendre mot pour mot les critiques de Jean-François Bayard ou de Romain Bertrand – nous ne les partageons pas, même si certaines visent juste, mais sont le fruit d’auteurs qui, eux, maîtrisent leur sujet et restent au moins ouvert au débat tout en développant un véritable argumentaire.
Au final, on reste sidéré que des chercheurs et des universitaires puissent insulter le travail de « collègues » sans la moindre nuance, ni retenue et sans avoir lu les travaux visés. Mais, ce n’est pas terminé, ils vont encore aller plus loin.
Les nouveaux censeurs
Venant de Pierre-André Taguieff, dont la plupart des ouvrages appréhendent la « race » et le racisme – certes pas dans l’espace colonial qu’il ne connaît pas ou mal, comme il l’expliquait dans un dossier de Hommes & Migrations il y a plus de vingt ans[3] –, le reproche d’inclure la question de la « race » et du racisme dans les recherches sur le passé colonial est plutôt cocasse.
Les chercheurs attaqués intègrent ces paramètres (la « race » et le racisme) dans leurs travaux, sans en faire pour autant un dogme. Ils s’autorisent certes à questionner les héritages de l’Empire, y compris le rôle de la colonisation dans la construction du racisme (que Pierre-André Taguieff serait bien inspiré d’étudier pour comprendre son propre sujet) scientifique ou « populaire », l’anticolonialisme, la trajectoire des États postcoloniaux, les effets postcoloniaux des systèmes économiques impériaux, etc.
Ce n’est pas parce que Pierre-André Taguieff fait de la « race » un sujet d’étude majeur dans ses travaux qu’il est accusé de vouloir faire entrer la « race » au CNRS, ni d’être raciste ; pas plus que Laurent Bouvet n’est dénoncé, à la suite de ses attaques contre les « islamistes », de généraliser l’assertion à l’ensemble des musulmans dans ses travaux… Pourquoi alors attaquer les chercheurs qui s’intéressent à ce sujet et faire croire qu’ils partagent les points de vue des décoloniaux radicaux ? Parce qu’ils travaillent sur le rôle des discours sur les « races » aux colonies, sur le colonialisme, sur la violence sur les corps, sur les zoos humains, sur les discriminations contemporaines, sur les immigrations postcoloniales, ils seraient eux-mêmes des racialistes ? C’est absurde.
Pour les six auteurs de la tribune, parce que des chercheurs observent les innombrables violences commises durant la colonisation, notamment sur le corps de femmes colonisées (et dans tous les empires) et qu’ils envisagent ses prolongements postcoloniaux, ces sujets porteraient atteinte à l’unité de la Nation, à l’universalisme, à la République et à ses valeurs ? Nous nageons ici en pleine confusion entre idéologie et recherches historiques…
Ainsi, selon eux, même si le passé colonial doit être analysé, cela ne peut être comme le font les chercheurs postcoloniaux, car, par définition, ils ne respecteraient pas les « normes de la recherche scientifique », normes jugées ici par des experts comme le montre la « méthodologie » de leur tribune… Bien entendu, les six pamphlétaires n’expliquent pas ce qui ne serait pas respecté par les chercheurs postcoloniaux et leurs amis. Trop compliqué à expliquer : le lecteur de L’Express et de Valeurs actuelles doit se fier à cette seule affirmation.
Car pour eux, les auteurs du livre publié par CNRS Éditions et les participants au colloque du 3 décembre 2019 au CNAM ne seraient que les « cousins postcolonialistes » des « idéologues décoloniaux ou indigénistes » qui veulent « acquérir une respectabilité académique ». Même Alain Policar conteste ce point de vue. Dans un article récent et critique, « L’inquiétant retour de la race » (juillet 2019), il précisait qu’il s’opposait aux décoloniaux qui veulent imposer une pensée racialiste, des « tentatives qui sont scientifiquement illégitimes » à ses yeux (et aux nôtres d’ailleurs), mais il reconnaissait qu’il fallait désormais « reconnaître que les études postcoloniales ont posé des questions injustement négligées ».
Les signataires feraient bien, aussi, de lire le passionnant ouvrage d’Antoine Lilti (EHESS), L’héritage des Lumières (Gallimard/Seuil, 2019), peu soupçonnable d’être un indigéniste acharné, et qui montre le caractère divers des Lumières et des interprétations critiques de celles-ci par les postcolonial studies, indiquant que ces dernières ont, « malgré leur hétérogénéité et parfois leurs excès, puissamment contribué à renouveler la recherche en sciences humaines ».
Par ailleurs, il est faux également d’affirmer qu’une recherche de respectabilité ou de postes serait la motivation des participants au colloque tenu au CNAM ou au livre édité par CNRS Éditions. Il suffit par exemple de se pencher sur les titres et grades universitaires de ceux qui ont dirigé celui-ci : professeurs des Universités à Paris, à Aix-Marseille, à Genève ou à Lausanne, directeur de recherche émérite au CNRS et ancien président du conseil scientifique du CNRS, membres de plusieurs laboratoires de recherche au LCP à Paris ou à l’Urmis à Nice, professeurs à UCLA en Californie ou à l’Université Vanderbilt dans le Tennessee… Pas réellement le profil de déclassés de l’Université ou du monde de la recherche. Mais les auteurs de la tribune n’ont même pas pris la peine de lire les biographies à la fin de l’ouvrage. Ce n’est pas grave, car les auteurs de ladite tribune n’imaginent pas un instant que le public ira vérifier…
En outre, les auteurs de la tribune manipulent les informations les plus banales pour donner le sentiment qu’ils démontent tout un système. Ce n’est pas une « association », comme leur tribune le précise, qui a édité le livre à CNRS Éditions[4] – « on est en droit de s’étonner que la direction de CNRS Éditions ait accepté de publier et de promouvoir un ouvrage émanant d’une association » écrivent-ils –, mais un collectif de dix auteurs et auteures (qui sont d’ailleurs en couverture du livre, à l’image de nos deux noms… et pas le Groupe de recherche Achac), et ce livre a seulement été édité en partenariat avec le Groupe de recherche Achac – comme c’est le cas de nombreux ouvrages de ce type –, ainsi qu’avec toutes les universités partenaires de ce programme de recherche commencé il y a plus de cinq ans.
Il est d’ailleurs assez logique que le Groupe de recherche Achac soit partenaire de cette édition, car il est le co-organisateur du colloque du 3 décembre 2019, mais aussi le co-organisateur des cinq colloques précédents avec leurs partenaires, à l’Université de Columbia-Paris, au Musée national de l’histoire de l’immigration, à l’Université de Genève, à UCLA à Los Angeles, à l’Université de Lausanne et enfin au CNAM. Colloques dont sont issus les textes de l’ouvrage. CQFD.
De fait, pour des projets d’une telle ampleur, étalés sur cinq années – un programme qui va se prolonger encore sur cinq années avec des éditions étrangères et des colloques dans le monde entier –, en lien avec plus d’une centaine de chercheurs et contributeurs, plusieurs éditeurs, une vingtaine d’universités et groupes/équipes de recherche, l’idée centrale est d’avoir un organisme pivot et, à cet égard, le Groupe de recherche Achac joue un rôle de coordination. Ce qu’ils reprochent à ce groupe de recherche, en fait, c’est son dynamisme, ses réseaux internationaux. En gros, ils reprochent à une équipe de travailler !
Abattre « l’ennemi »
Alors que toute recherche postcoloniale est selon eux sans légitimité, sans fondement, vérolée par les idéologues décoloniaux et ne produisant que des recherches non-conformes aux « règles académiques »[5], il faut aussi abattre maintenant l’un des organismes les plus actifs sur la question coloniale depuis 30 ans, le Groupe de recherche Achac. On commence par le présenter comme un « leader », qui imposerait son hégémonie.
C’est vraiment trop d’honneur fait à ce collectif, qui a déjà travaillé avec plus de six cents chercheurs présents aux quatre coins du monde, qui se rassemblent sur des projet précis – à découvrir sur le site www.achac.com –, que de le présenter comme un « leader ». En réalité, le Groupe de recherche Achac n’est pas plus le leader de ces études en France, marquées justement par le travail de multiples individualités, qu’il n’est d’ailleurs en phase avec les décoloniaux racisés qui gravitent autour des Indigènes de la République, au regard de multiples attaques dont il a été l’objet en provenance de ce courant. En outre, cette équipe n’est en rien fondée sur l’appartenance de ces chercheurs au courant des postcolonial studies, mais sur leurs compétences académiques dans tel ou tel domaine que ce collectif se propose d’explorer.
Car bien entendu, à aucun moment, les pamphlétaires ne rappellent que les fondateurs du Groupe de recherche Achac ont critiqué immédiatement Les Indigènes de la République à leur création, il y a 15 ans déjà : ils étaient d’ailleurs les premiers à le faire, le 16 mars 2005, dans Le Monde et à dénoncer les raccourcis et les excès de ce manifeste dans une tribune (« Comment en finir avec la fracture coloniale »), alors qu’à l’époque aucun des signataires de la tribune n’avait même compris ce qui se passait. Pour le savoir, ils auraient dû lire la note sur les « décoloniaux »[6] de Gilles Clavreul – proche de Laurent Bouvet d’ailleurs, et actif au sein du Printemps républicain –, proposée il y a deux ans à la Fondation Jean-Jaurès, dans laquelle il évoque d’ailleurs cette opposition ancienne et fondatrice du Groupe de recherche Achac contre les Indigènes de la République (désormais parti politique, le PIR).
Pour aller jusqu’au bout de l’amalgame, les signataires publient une citation d’Houria Bouteldja, qui s’affirme, par son origine et sa religion, proche du terroriste Mohamed Merah. Les propos délirants de l’animatrice des Indigènes de la République devraient donc être rapprochés des universitaires qui travaillent selon certaines des perspectives postcoloniales (puisqu’ils sont « cousins ») ! Autrement dit, travailler sur la (post)colonie = Indigènes de la République = terroristes ! C’est un peu comme si nous affirmions que Pierre-André Taguieff s’étant affirmé comme un ultra-républicain, donc proche d’un certain nationalisme, nous en déduisions : nationalisme = fascisme = politique de terreur. Cette « méthode » est une honte.
En vérité, la vision réactionnaire des auteurs de la tribune de L’Express n’a rien à envier aux radicaux décoloniaux racisés proches des Indigènes de la République qui, il y a un an, voulaient eux aussi interdire des champs de recherches du Groupe de recherche Achac – à l’occasion précisément de l’ouvrage Sexe, race & colonies (La Découverte), présenté par les deux camps comme « pornographique » –, au nom du fait que ce territoire de recherche devait leur être réservé et qu’il ne fallait pas montrer les images de la domination sexuelle aux colonies (voir à cet égard notre texte dans The Conversation). Tribunes, textes polémiques[7], insultes issues du mouvement décolonial le plus radical (à l’image de Cases rebelles) se sont succédés ainsi durant plusieurs mois pour asséner que cet ouvrage était illégitime (notamment parce que les directeurs de l’ouvrage étaient « blancs » et « blanches »[8]), sans jamais rappeler la diversité géographique et culturelle des quatre-vingt-dix-sept contributeurs du livre. Voici maintenant le tour des ultra-républicains militants d’attaquer ce livre, avec les mêmes méthodes, les mêmes arguments.
Avec de tels oukases, qu’ils viennent des militants racisés et de leurs alliés ou des ultra-républicains militants et de l’ultra-droite, de deux pôles de radicalité en fait, on prépare une belle société de guerre identitaire. Car avec ces ultra-républicains qui basculent vers une radicalité identitaire, la République est vraiment en danger. Et surtout, on veut empêcher que des chercheurs puissent trouver une voie médiane entre l’aveuglement sur le passé et la systématisation – évidemment caricaturale – de ses effets contemporains.
D’une certaine manière, lorsque des chercheurs se retrouvent au centre d’un échiquier dont les extrêmes sont occupés par de tels idéologues – décoloniaux et ultra-républicains/ultra-droite –, ils sont en droit de penser qu’ils sont proches de la « vérité ».
Éloge de l’incompétence
Mais l’idée, surtout, pour les Taguieff et consorts, est de nuire à une équipe qui travaille sur des sujets qui leur déplaisent, ce qui à leurs yeux est inacceptable. Pour prouver que le dernier livre que nous avons publié n’a aucune valeur scientifique, il faut démontrer que tous nos livres précédents – plus de soixante… – sont également sans valeur scientifique. Dès lors, ils s’attaquent aux ouvrages majeurs associés au Groupe de recherche Achac, en premier lieu Zoos humains, publié en 2002.
De la part de « vigies du sérail scientifique », on s’attend donc à une analyse serrée des textes de l’ouvrage, de questions posées sur les aires géographiques envisagées ou les bornes chronologiques, les typologies proposées, les références bibliographiques, etc. On attend bien sûr que les signataires situent leurs critiques dans la dynamique des travaux, plusieurs ouvrages sur le sujet ayant été publiés, témoignant des progrès de la recherche. En fait, rien de tout cela. Ils n’ont tout simplement pas lu les livres.
À défaut, on s’attend au moins à ce que les auteurs répertorient les nombreux comptes-rendus de lecture publiés dans les revues scientifiques ou grand public et en fassent la synthèse critique. Ils ne le font pas. Trop compliqué, trop de travail, trop fatiguant. Malgré une méconnaissance totale des travaux et débats qu’ont suscités ces ouvrages, il faut pourtant prouver que ce travail n’a pas de valeur.
Comment faire ? Facile : on exhume une très ancienne critique (2002) de Claude Blanckaert qui ne concernait que l’introduction du premier ouvrage (où il nous était reproché de n’avoir « pas su cerner, ou problématiser, [notre] objet d’enquête »), et le tour est joué. C’est simple la critique universitaire finalement ! Ne partageant pas les analyses des directeurs de la publication, la critique de Claude Blanckaert était scientifique, argumentée et sans injures. Elle est donc légitime, et méthodologiquement aux antipodes du « travail » réalisé par les signataires. Elle s’inscrit dans le débat d’idée normal dans le champ académique, ce dont nous sommes très très loin avec la tribune publiée dans L’Express.
Mais ce que les auteurs de la tribune ne disent pas, c’est qu’une décennie plus tard ce même Claude Blanckaert fera appel à Pascal Blanchard pour un article sur les zoos humains dans son ouvrage sur la Vénus hottentote (La Vénus hottentote : Entre Barnum et Muséum, Publications scientifiques du Muséum, 2013), ce qui témoigne de l’économie régulée des controverses scientifiques, qui autorise des chercheurs ne partageant pas la même analyse à publier dans un même ouvrage. De cela, les six auteurs de la tribune ne disent rien car toute leur « démonstration » tomberait à l’eau.
Ils ne précisent pas plus que ce livre est né d’un colloque à Marseille en 2000 et est issu d’un réseau thématique du CNRS : le GDR 2322 dirigé par Gilles Boëtsch, un anthropobiologiste spécialiste de la question des « races ». Directeur de recherches au CNRS émérite – à la différence de Pierre-André Taguieff, aujourd’hui à la retraite, et qui n’est pas émérite et n’est rattaché à aucune équipe scientifique – et, comble de l’ironie, Gilles Boëtsch a aussi été Président du conseil scientifique du CNRS. Alors, ils esquivent et les auteurs de la tribune ne font surtout pas référence à cette généalogie.
Ce qu’ils ne disent pas non plus c’est que l’ouvrage et ses déclinaisons successives ont rassemblé près de 80 chercheurs au plan international, qu’il a été traduit en quatre langues et a suscité d’innombrables recherches historiques. Que ce travail met à jour une véritable configuration historique, puisque le phénomène des exhibitions ethniques a touché tout l’Occident et au-delà pendant plus d’un siècle, mobilisant des centaines de millions de visiteurs, indiquant clairement que ces spectacles ethniques ont contribué à construire le racisme. Mais tout cela ne compte pas… Pas plus que l’organisation d’une exposition au Musée du quai Branly en 2011-2012 (primée meilleure exposition de l’année 2012 en France), deux films sur Arte (primés) et des dizaines de conférences et colloques en France et à l’étranger.
Autre livre qui est dénoncé : Les Années trente sont de retour chez Flammarion en 2014. Un livre sans aucune valeur scientifique à leurs yeux, qui ne permet pas selon la bande des six de « comprendre les crises du présent ». Au-delà de cette assertion, il est amusant, là aussi, d’observer la manière dont les signataires tronquent la vérité. Ils prétendent que le livre a été écrit par « Pascal Blanchard et Yvan Gastaut », car, ne voulant pas se fâcher avec les deux journalistes co-auteurs, ils évitent de les citer. Il s’agit, pour ce livre à quatre mains, de Renaud Dély et Claude Askolovitch. Il faut bien défendre et protéger ses passages futurs dans les médias et éviter de se mettre à dos deux journalistes reconnus, co-auteurs du livre. Il faut dire que le jugement de la bande des six, sur un livre qu’ils n’ont là aussi sans doute pas lu, est sans nuance : « C’est ainsi qu’ils croient pouvoir analyser les dynamiques nationalistes et populistes contemporaines. Pensée magique, pensée paresseuse aussi, et non point approche scientifique. » On comprend mieux pourquoi, ils n’avaient pas donné les noms des deux autres co-auteurs ! Prudence et vigilance s’imposent ici pour ces adeptes des médias et des réseaux sociaux.
Ensuite, ils s’attaquent à l’ouvrage Sexe, race & colonies, qui a mobilisé une centaine de chercheurs en 2018 et porte sur l’exploitation sexuelle des esclaves et des colonisés, et la prolongation de cette exploitation dans le temps postcolonial[9]. Pour eux, ce travail se réduit à de la « pornographie ». Comme ils n’ont évidemment pas lu les textes – trop long, trop fatiguant –, aucune critique argumentée ne peut en conséquence être développée (alors que de nombreux points auraient pourtant pu être abordés, car le livre, comme tout livre, n’est pas parfait). Ils se contentent de reprendre ce que les décoloniaux radicaux ont écrit sur le livre[10], y compris les plus simplistes caricatures, prenant de facto le contre-pied des débats qu’a suscités l’ouvrage, marqués par de nombreuses critiques positives dans les médias[11]. Ironique…
De fait, l’objet de cet ouvrage est inintéressant pour eux. Mettre autant d’énergie à nier d’importantes questions historiques a quelque chose d’effarant. Car, si les mouvements décoloniaux radicaux qui nous critiquent sans cesse ramènent tout à la période coloniale, les auteurs de la tribune font le contraire : ils nient en bloc toute influence de l’histoire coloniale, comme si celle-ci n’avait strictement aucune influence sur la période postcoloniale. Sorte de point aveugle… Pour autant, leurs conclusions sont les mêmes que celles des décoloniaux radicaux : il faut dénoncer ce livre. Ah que le monde est merveilleux lorsque les extrêmes de tout bord sont en phase pour stigmatiser les livres, les idées et la liberté de porter un regard sur le passé. Trop « blanc » pour les uns, trop « postcolonial » pour les autres, leur regard sur le monde est biaisé par leur tropisme racialiste qui les empêchent, tous, de penser en fin de compte la diversité du monde.
Enfin, pour finir, ils décident de rejeter totalement l’ouvrage que nous venons de publier avec huit autres collègues et cinquante contributeurs à CNRS Éditions, Sexualités, identités & corps colonisés – qui est pour les auteurs de la tribune, non pas un livre, mais « le miroir du gauchisme culturel décolonial sévissant dans certains milieux intellectuels et quelques campus universitaires »… « Critique » sévère, mais là encore sur quoi s’appuie-t-elle ? Sur rien, puisque comme à leur habitude les signataires n’ont pas lu le livre (de même, d’ailleurs qu’aucun d’entre eux n’a participé au colloque tenu au CNAM, le 3 décembre 2019, nous l’avons vu). Mais, encore une fois, à quoi bon lire les livres et les articles des chercheurs ? La cinquantaine d’auteurs de l’ouvrage, français et étrangers, quasiment tous en poste à l’Université ou dans des organismes de recherche français ou étrangers (les biographies sont indiquées en fin d’ouvrage, encore faudrait-il l’ouvrir…), sont donc tous des « gauchistes décoloniaux ».
On ne sait si on doit rire ou pleurer d’une telle débauche d’inepties. Mais à force d’accumulation, d’insultes… ils espèrent que le public sera convaincu.
Grands témoins
Pour que l’on ne puisse pas les accuser de rejeter en bloc tous les travaux sur la colonisation, le « racisme » ou l’esclavage, et ne pas donner le sentiment de jeter le bébé avec l’eau du bain, ils signalent quelques travaux sur la colonisation, respectueux à leurs yeux de la démarche scientifique, et notamment ceux de Patrick Weil (ils se connaissent avec Laurent Bouvet et ont même publié ensemble plusieurs articles et tribunes). Manque de chance, Patrick Weil a également contribué à un ouvrage aux Éditions La Découverte – qu’ont notamment dirigé les deux auteurs de ce texte, aux côtés de plusieurs collègues –, Ruptures postcoloniales en 2010.
Ils citent ensuite Romuald Fonkoua. Mais, là aussi, leur faible connaissance – pour utiliser un euphémisme – des ouvrages publiés leur a fait omettre le fait qu’il a, lui aussi, contribué à un autre ouvrage majeur du Groupe de recherche Achac, La France noire en 2011 aux côtés d’une vingtaine d’auteurs (dont Catherine Coquery-Vidrovitch, Marcel Dorigny, François Durpaire, Yvan Gastaut, Dieudonné Gnammankou, Sandrine Lemaire, Achille Mbembe, Élikia M’Bokolo, Pap Ndiaye, Frédéric Pineau, Alain Ruscio, Daniel Soutif, Tyler Stovall, Françoise Vergès, Pascal Blanchard, Sylvie Chalaye, Éric Deroo, Mahamet Timera… et avec une préface d’Alain Mabanckou).
Ah oui, ils ont aussi en réserve une chercheuse sortie de leur liste de notes : Emmanuelle Sibeud. Son article contre les postcoloniales restant sans conteste sa plus notable référence à ce jour (« Post-Colonial et Colonial Studies : enjeux et débats » dans la Revue d’histoire moderne & contemporaine en 2004-2005), publiée au moment où nous publions un ouvrage – étonnamment peu critiqué par les auteurs de la tribune… alors que c’est sans doute le plus « postcolonial » de tous nos livres – La Fracture coloniale[12]. Un ouvrage avec une vingtaine d’auteurs majeurs qui évoquent les nouveaux territoires de la question (post)coloniale. Pour les opposants à ce livre, et notamment Emmanuelle Sibeud ou les signataires de la tribune de L’Express, cet « ouvrage-manifeste » – comme ils le caractérisent – se résume en une phrase lacunaire : « Tout s’explique selon eux par des survivances et des résurgences. »
Là aussi, l’analyse est un peu courte. La vingtaine d’auteurs (dont Benjamin Stora, Benoît Falaize ou Michel Wieviorka) expliquaient, dès 2005, que la France devait regarder en face et sans tabou le passé colonial et ses héritages, qui risquent, sinon, de provoquer des effets de fracturation dans la société. Quinze ans après, la situation de la société française et ses crises sociales, politiques et identitaires à répétition font penser que les animateurs de cet ouvrage avaient été un peu visionnaires. Cela explique sans doute pourquoi ce livre, depuis 2005, est devenu une référence (et qu’il a été traduit aux États-Unis[13]). De fait, dès sa sortie, ce fut un succès, capable de porter un regard différent sur la crise des quartiers populaires de l’automne 2005. Mais, en effet, Emmanuelle Sibeud (de l’Université Paris 8) a tout à fait le droit de penser et de regarder de manière différente le passé colonial[14] et ses héritages dans le présent.
À l’issue de l’examen de ce beau panel de grands témoins, et de preuves irréfutables, on reconnaîtra que les auteurs de la tribune auraient pu trouver mieux. Travailler un peu plus. Mais travailler demande du temps et l’urgence politique commande. Le travail a donc été bâclé, pour arriver au final à ce qu’il faut bien appeler un pamphlet. Qu’importe, les réseaux d’extrême droite, les sites antimusulmans et Valeurs actuelles en tête ne feront pas de détail, et vont reprendre tout cela sans le vérifier… pour confondre allégrement études postcoloniales et décoloniaux radicaux, chercheurs sur le passé colonial et militants activistes. Tout cela dans un contexte où le Président de la République a engagé un travail critique sur le passé colonial et a, dans plusieurs déclarations, souligné qu’un nouveau regard devait désormais être posé sur ce passé.
C’est la panique chez les tenants d’une vision immuable de l’Empire pour qui tout regard critique sur le passé colonial est comme une digue qui s’effondre. Mais il faut questionner leurs « angoisses » et motivations. Dans un dernier texte de ce triptyque, « La radicalisation du débat public » (le troisième et dernier de notre série), nous nous attacherons donc aux motivations politiques et idéologiques qui ont manifestement guidé les six cosignataires, la tribune faisant suite à plusieurs autres tribunes publiées en France dans le même esprit depuis 18 mois : on pense notamment à celle de Marianne, « L’offensive des obsédés de la race, du sexe, du genre, de l’identité », le 11 avril 2019, qui reprend des éléments de l’article de L’Obs « Les “décoloniaux” à l’assaut des universités » du 30 novembre 2018 dans la même veine que la tribune collective « Le décolonialisme, une stratégie hégémonique : l’appel de 80 intellectuels », dans Le Point le 28 novembre 2018 ; deux textes qui font suite à un texte publié par FigaroVox « Comment le racialisme indigéniste gangrène l’Université », le 7 septembre 2018.
À chaque fois, l’objectif était de s’attaquer aux décoloniaux radicaux et leurs actions, la nouveauté dans la tribune de L’Express de décembre 2019 est d’associer les chercheurs issus ou influencés par les études postcoloniales et les militants décoloniaux radicalisés[15].