Parcoursup, une réforme conservatrice ?
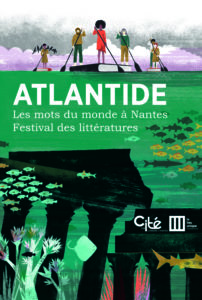
Associer la réforme de l’université imposée à marche forcée par Emmanuel Macron à la peur du changement semble ne pas aller de soi. L’actuel président de la République n’est-il pas l’initiateur d’un nouveau parti politique appelé « En Marche ! » ? Lui et les membres du gouvernement ne présentent-ils pas le dispositif Parcoursup comme un moyen de « fluidifier » l’entrée des bacheliers dans l’enseignement supérieur, de donner une « nouvelle dynamique » à l’orientation ? Peut-être.
Mais ces éléments de langage ne résistent pas bien longtemps à l’analyse. L’étude de la réforme mise en place et du système argumentatif censé la justifier en donne une tout autre image. D’une part, cette réforme n’a rien d’une rupture avec celles menées par les gouvernements précédents, et ne s’appuie nullement sur de nouvelles conceptions ou de nouveaux arguments. D’autre part, les effets de Parcoursup, du moins tels que l’on peut en juger au regard des recherches réalisées en sciences sociales sur les mécanismes d’orientation et de sélection dans le supérieur, semblent bien plutôt devoir être de l’ordre de la rigidification des parcours et du renforcement des inégalités que de la fluidification ou de la redynamisation.
Précisons. Le projet de loi sur l’Orientation et la réussite des étudiants (ORE), dans lequel s’inscrit le nouveau dispositif Parcoursup, se fonde sur trois constats (dont on montrera le caractère fallacieux) : la désorientation des étudiants, les dysfonctionnements d’APB et l’échec des étudiants à l’université. Pour répondre à ces différents maux, la réforme introduit un renforcement de l’accompagnement à l’orientation (professeur principal supplémentaire, vœux des lycéens visés par les conseils de classe, temps consacrés à l’orientation rallongés), une individualisation de la gestion de l’orientation (nouvelle plate-forme de vœux, lycéens informés directement sur leur smartphone) et une sélection à l’entrée de l’université (capacités d’accueil pour toutes les licences, formalisation d’« attendus », appréciation et classement des candidatures).
Les enquêtes sociologiques montrent qu’au seuil du baccalauréat les projets d’orientation des lycéens sont relativement bien disciplinés et conformes à leurs caractéristiques scolaires et sociales.
Le premier des topoï autour desquels se construit la justification de l’actuelle réforme est donc celui de la « désorientation » des bacheliers. Une nouvelle fois, cette croyance n’est pas nouvelle. Le gouvernement précédent a, par exemple, pour la même raison, cherché à imposer des quotas de bacheliers technologiques en IUT (Institut universitaire de technologie) et de bacheliers professionnels en STS (Section de technicien supérieur). Or, contre toutes apparences, cet idéal de cohérence dans les choix d’orientation et de continuité dans les parcours ne fait en réalité que prolonger et instituer une segmentation des orientations post-bac déjà bien à l’œuvre dans les aspirations et dans les pratiques effectives des élèves.
L’enseignement supérieur se présente ainsi aujourd’hui comme un espace fortement ségrégué, où les classes préparatoires aux grandes écoles n’accueillent que 7,2 % d’enfants d’ouvriers contre 23,7 % en STS. À l’inverse, les premières comptent 51,7 % d’enfants de cadres supérieurs, contre 15,9 % dans les secondes. Et, contrairement à ce que laissent entendre de récents propos présidentiels, l’université n’est déjà pas la solution pour tout le monde, puisque les enfants d’ouvriers n’y représentent que 10 % des étudiants, contre 18 % de l’ensemble des bacheliers et, à l’inverse, les enfants de cadres supérieurs y constituent 34 % des étudiants, contre 26 % de l’ensemble des bacheliers. Les bacheliers professionnels y sont rares (6 % en L1 contre un tiers en STS) et les bacheliers technologiques largement minoritaires (15 % en L1 contre 50 % en STS). Cela rappelle par ailleurs que le caractère sélectif d’une formation n’implique pas nécessairement le recrutement des « meilleurs » et/ou des plus « favorisés ». Pour ne prendre qu’un exemple, les écoles du travail social, dont l’entrée se fait par concours, accueillent près de 20 % d’ouvriers, 33 % de bacheliers technologiques et 10 % de bacheliers professionnels.
APB et Parcoursup partagent le fait d’être des outils pensés par et pour les milieux sociaux les plus favorisés et risquent donc de produire la désorientation des moins favorisés là où il était censé la réduire.
Les enquêtes sociologiques montrent donc qu’au seuil du baccalauréat, les projets d’orientation des lycéens sont relativement bien disciplinés et conformes à leurs caractéristiques scolaires et sociales. Plus précisément, si l’on entre dans la logique des pratiques d’orientation des bacheliers, il apparaît que l’on ne peut réduire le raisonnement à une opposition entre des élèves à projet et des élèves désorientés. Nos recherches permettent d’établir que la très grande majorité des bacheliers appuient leur choix d’orientation sur de bonnes raisons (selon les cas : projet professionnel, passion pour une discipline, stratégie d’orientation ou de réorientation au sein de l’offre d’enseignement…).
En revanche, et c’est tout le problème, les différentes manières dont les bacheliers construisent leur choix d’orientation, parce qu’elles varient fortement selon les profils scolaires et sociaux, ne se trouvent pas toujours en affinité avec la logique de gestion des parcours portée par APB et reprise par Parcoursup. Car, loin d’être de simples supports techniques à la formulation des vœux, ces deux interfaces ne sont pas idéologiquement neutres. Elles ont été pensées à partir d’une conception bien précise de ce qu’est un élève « normal », soit selon le modèle d’un acteur omniscient et rationnel, c’est-à-dire d’un individu stratège, disposant de toutes les informations mais aussi de toutes les ressources pour formuler ses choix. Surtout, ces logiciels portent une vision individualiste de l’orientation qui n’a rien d’évident lorsque l’on considère avec attention les manières de faire des lycéens.
Les recherches sur l’entrée des bacheliers de classe populaire dans l’enseignement supérieur mettent en évidence l’importance du collectif et de la solidarité entre pairs dans la prise de décision, l’éloge de la conformité contre le principe de la distinction. Dès lors, face à une application qui isole les individus dans la construction de leur projet, qui désynchronise les temps de réponse des formations d’accueil et les temps de décision des élèves, et, plus largement, face à une réforme qui vise à accentuer les singularités individuelles, à déconstruire les espaces et les temps communs de réflexion sur l’avenir, les élèves des classes populaires ont toutes les chances de se retrouver en décalage. Le langage des vœux tel qu’il est exigé par APB et à fortiori par Parcoursup, ne correspond pas au langage des projets scolaires et professionnels des lycéens les plus éloignés de la culture scolaire. En d’autres termes, APB et Parcoursup partagent le fait d’être des outils pensés par et pour les milieux sociaux les plus favorisés, des outils, par conséquents, qui risquent de produire la désorientation des moins favorisés là où il était censé la réduire.
S’arrêter au seul décompte des taux de passages, c’est ainsi réduire le rôle de l’université à celui d’une instance de certification, et oublier ses fonctions multiples de socialisation, de formation, de préparation.
Le ministère le martèle : 60 % des étudiants de première année de licence ne passent pas en deuxième année. Tel est le fait qui justifie selon lui que l’on mette l’université au régime sélectif car c’est son caractère ouvert, l’absence de sélection, qui expliquerait ce taux. Mais est-ce si clair ? Le ministère semble, ici encore, faire un usage bien sélectif, et toujours décontextualisé, des chiffres. Tout d’abord, on observe un taux similaire de 60 % d’échec pour les étudiants dans les écoles supérieures spécialisées de l’enseignement supérieur, que sont les écoles de commerce, les écoles d’art, les écoles d’ingénieurs, etc., accessibles directement après le baccalauréat, et toutes sélectives. Plus encore, peut-être, en classe préparatoire aux grandes écoles littéraires, le taux d’abandon à l’issue de la première année dépasse les 40 %. Pour autant, leur public est fortement trié scolairement et socialement, et jamais il n’a été question à leur sujet d’un « gâchis humain » comme c’est le cas pour l’abandon à l’université.
Il semble ensuite essentiel de ne pas s’arrêter aux seuls « taux » de passage en deuxième année. Par exemple, derrière le pourcentage « admirable » de 74 % de réussite en fin de première année de STS, se cache celui, moins avouable, de 50 % d’échec pour les bacheliers professionnels. Or, si ce taux reste bien plus faible que celui observé à l’université pour ces mêmes bacheliers, il n’en reste pas moins qu’il concerne un nombre bien plus important de personnes : 25 000 échecs en STS contre un peu plus de 14 000 à l’université pour 2016.
Il faut enfin rappeler que les 60 % d’échec en première année à l’université recouvrent en réalité des situations tout à fait incomparables : soit environ 25 % de redoublements dans la même filière, 10 % de réorientations vers une autre filière universitaire et 25 % de non-réinscriptions à l’université. Or, ces derniers 25 % recouvrent dans leur grande majorité des réorientations réussies vers des filières hors université. Et nombre de ces dernières n’auraient sans doute été possibles sans le passage par la première année de licence. S’arrêter au seul décompte des taux de passages, c’est ainsi réduire le rôle de l’université à celui d’une instance de certification, et oublier qu’elle constitue également un espace de socialisation, de formation, de préparation, qui permet à de nombreux étudiants d’affiner leur projet professionnel, de préparer les concours d’entrée dans une autre filière (écoles spécialisées), de découvrir une discipline et de se constituer une culture générale, de se familiariser avec la vie étudiante et d’ouvrir son espace des possibles.
Qui plus est, cette fonction et ces usages multiples de l’université ne sont pas nouveaux. Les taux d’abandon à l’issue d’une première année universitaire étaient similaires dans les années 1950 et sont relativement constants depuis. L’abandon à l’université ne doit donc pas être compris comme un phénomène contemporain, qui pourrait être imputable au nouveau profil des étudiants (davantage d’étudiants d’origine populaire et moins de bacheliers généraux, voire à une baisse générale du niveau de tous les bacheliers) mais comme un processus structurel.
Il est bon à cet égard de rappeler la récurrence, décennie après décennie, des discours exposant la conviction que l’enseignement supérieur « c’était mieux avant ». Ainsi, en 1949 déjà, Jean Bérard se désolait dans deux articles parus dans Le Monde du niveau des étudiants inscrits en propédeutique d’histoire : « Mais le plus fort est sans doute la copie de ce candidat qui réussit à écrire en tout et pour tout une trentaine de lignes sans citer un seul nom propre, pas même celui de Périclès, ni mentionner aucun fait. Qu’un sujet tel que celui qui était proposé n’ait fait surgir le moindre souvenir, ni éveillé la moindre réaction intelligente dans le cerveau d’un étudiant bachelier qui se sent une vocation d’historien, c’est un fait qui laisse songeur. Car rappelons que nos candidats sont tous bacheliers. Que sont donc les élèves qui échouent au baccalauréat ? »
La flexibilité que permet le caractère non sélectif des filières universitaires rend possibles les essais et les constructions de parcours plus ou moins probables en dehors de toute imposition a priori d’avenirs prédéfinis en fonction du passé scolaire.
À l’opposé de la logique des filières sélectives que l’on nous propose d’universaliser aujourd’hui, et en rupture avec l’image fallacieuse que l’on nous en propose généralement, l’université apparaît dans les faits comme un espace singulier de libre circulation au sein de l’enseignement supérieur. De ce fait, elle offre une expérience unique aux étudiants qui la traversent. Malgré ses limites et les difficultés bien réelles qu’elle rencontre, et que nous n’ignorons pas, mais aussi l’abandon symbolique et financier dont elle est l’objet, elle continue à jouer un rôle essentiel de régulation des parcours et d’expérimentation de soi. La flexibilité que permet (justement) le caractère non sélectif des filières universitaires rend possibles les essais et les constructions de parcours plus ou moins probables en dehors de toute imposition a priori d’avenirs prédéfinis en fonction du passé scolaire.
Voilà donc le fait le plus souvent oublié dans de très nombreuses prises de position vis-à-vis de l’enseignement supérieur : un parcours d’études se construit et se construit progressivement. Ce qui implique la possibilité de l’erreur, de l’hésitation, de la bifurcation, de l’augmentation progressive de l’engagement ou au contraire du désengagement scolaire. Tout cela n’est ni linéaire, ni joué une fois pour toutes dès le secondaire, comme le voudraient nos « responsables » politiques. Or c’est bien tout cela que propose de faire disparaître le dispositif Parcoursup et le caractère désormais sélectif de l’entrée à l’université qu’il implique.
Amor fati d’autant plus regrettable qu’elle ne concerne pas les personnes qui proposent ces solutions et leur famille mais bien « les autres », les étudiants d’origine populaire.
Cela su, la politique de « contrôle à la frontière » que constitue Parcoursup pose problème. Face à un désajustement général entre formation dans le secondaire et choix d’orientation dans le supérieur, on pourrait comprendre la nécessité d’un effort de réajustement. Mais vouloir réduire au maximum, pour ne pas dire faire disparaître, des choix d’orientation qui restent, comme on vient de le voir, très minoritaires, c’est exclure d’emblée et sans appel toute velléité de reprise en main de son parcours, tout espoir de rebattre les cartes, ou même simplement d’expérimenter un temps la possibilité d’un autre avenir. C’est ainsi et, de fait, imposer que tout destin scolaire se scelle dès le secondaire, ou plus tôt encore, et qu’une fois le supérieur atteint (s’il l’est) tout soit déjà joué.
Amor fati d’autant plus regrettable qu’elle ne concerne pas les personnes qui proposent ces solutions et leur famille mais bien « les autres », les étudiants d’origine populaire. L’introduction d’attendus régissant l’accès en licence poursuit une même logique : en contribuant à sélectionner ceux qui disposent déjà des savoirs et des savoir-être spécifiques à une discipline, c’est toute la fonction d’apprentissage et de formation de l’université qui risque d’être déniée, au profit d’une simple fonction de signalisation.
Le projet de loi ORE est donc une simple « solution » de gestionnaire, bien dans l’air du temps, qui non seulement s’appuie sur une conception fausse et maintenant ancienne du fonctionnement universitaire, mais constitue aussi un rejet inquiet de tout ce qui n’est pas linéaire, prévisible et ordonné une fois pour toutes. Ce qui n’est, par ailleurs, rien d’autre qu’une remise en cause du projet de démocratisation de l’enseignement supérieur.
